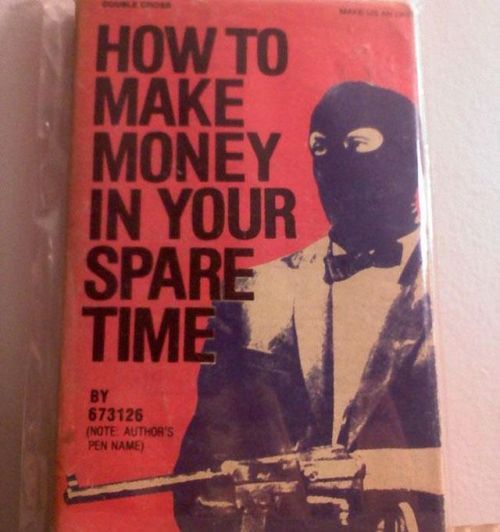Marc-Antoine Pencolé : Vous avez récemment publié Feminism, labour and digital media: the digital housewife ((Jarrett Kylie, Feminism, labour and digital media: the digital housewife, New-York, Routledge, 2016. Un chapitre du livre a été traduit en français et publié dans le numéro 13 de la revue Poli)), où vous essayez de donner à la prolifération de recherches empiriques sur les technologies numériques une assise théorique, dans le marxisme postopéraïste et les théories du digital labour d’une part, et dans le féminisme d’autre part. Qu’est-ce qui vous a semblé décisif dans la contribution des deux premiers ? Pourquoi devrions-nous mettre l’économie politique – et même plus particulièrement le concept de travail – au centre de notre compréhension des médiations numériques ?
Kylie Jarrett : Il est nécessaire de mettre l’économie politique au centre de notre compréhension des médiations numériques parce que cela nous permet de dénaturaliser la situation particulière de l’Internet contemporain, et plus spécifiquement du Web. Quand je raconte à mes élèves de licence qu’à l’origine, les chercheurs et les usagers d’Internet débattaient pour savoir s’il fallait ou non commercialiser l’Internet, ils sont pour la plupart tout simplement étonnés, et un peu amusés. Pour eux, il n’y a pas d’autre réalité possible que celle des plateformes propriétaires fermées qui constituent toute leur expérience du numérique aujourd’hui. Détailler la nature de cette activité de commercialisation, la soumettre à la critique, et concevoir comment cela pourrait être autrement, tout cela est essentiel à mon travail d’enseignante, mais aussi de chercheuse.
Dans ma recherche, l’oeuvre du marxisme autonomiste, et la manière dont des gens comme Tiziana Terranova ((Terranova Tiziana, “Free labor: producing culture for the digital economy.” Social Text 18 (2): 33-58, 2000.)) l’ont utilisé pour interpréter l’économie des médias numériques, m’ont offert un vocabulaire bien utile pour décrire les différents types de relations d’échange que j’avais pu observer depuis que j’ai commencé à étudier, dans mon mémoire de licence, le travail fourni en ligne par les fans de X-Files. Les interactions sociales sur ces sites de fans peuvent certes être lues comme des formes de résistance des utilisateurs aux impératifs idéologiques de l’émission et à la marchandisation de la culture, mais j’étais plus intéressée à comprendre comment, malgré tout ceci, ils participaient aussi en fin de compte à la création de valeur pour des entités commerciales associées aux producteurs de la série. Pour comprendre un tel phénomène, il fallait être en mesure de concevoir l’activité des utilisateurs du numérique comme une forme de travail génératrice de survaleur. Le phénomène n’a cessé de prendre de l’ampleur, à mesure que l’appétit sans limite des plateformes de médias sociaux les pousse à solliciter toujours plus de contributions des utilisateurs, et que les réseaux numériques pénètrent toujours plus profond dans le tissu culturel et social.
Néanmoins, plus généralement, la pensée autonomiste est extrêmement utile pour expliquer la nature du capitalisme de la fin du XXe et du début du XXIe siècles, après que la gouvernance, l’économie et les politiques néolibérales se sont tranquillement imposées comme la nouvelle hégémonie mondiale, et que le travail a été transformé par les changements technologiques et culturels. L’idée de l’usine sociale (même si j’ai quelques difficultés à l’appliquer) est importante pour comprendre le contexte actuel où l’on voit les formes de travail les plus valorisées se concentrer sur les dimensions cognitives, communicationnelles et affectives, saturant ainsi les subjectivités de possibilités d’expropriation par le capital. Ces changements ont pour effet de déplacer le champ de bataille de l’intérieur de l’usine proprement dite vers l’espace du loisir, de la production de soi et des relations interpersonnelles, ce qui renouvelle la pertinence et l’intérêt politique des théories liées à la relative autonomie des travailleurs, à la manière de ce qui a été développé par la pensée opéraïste.
Le travail absolument novateur d’auteures opéraïstes comme Mariarosa Dalla Costa et Selma James, Leopoldina Fortunati ou encore Silvia Federici ((Dalla Costa Mariarosa et Selma James (éd.), Le pouvoir des femmes et la subversion sociale, Genève, Librairie Adversaire, 1973 ; Fortunati Leopoldina, The Arcane of Reproduction: Housework, Prostitution, Labour and Capital, Hilary Creek (trad.), Autonomedia, New-York, 1995, Federici Silvia, Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive, Senonevero et Julien Guazzini (trad.), Genève-Paris-Marseille, Entremonde -Senonevero, 2014.)) est resté largement ignoré et marginalisé au sein même de l’opéraïsme. Dans quelle mesure un tel aveuglement a-t-il finalement fragilisé les thèses du travail immatériel ou du digital labour ?
Il y a clairement un point aveugle dans les formes dominantes de la recherche quant aux travaux réalisés par les femmes, les universitaires queer ou racisés, qui aboutit à un affaiblissement de notre compréhension de la pensée critique. Dans le cas du digital labour, ça ne vient pas seulement de l’histoire compliquée de l’intersection du marxisme et du féminisme, mais des recherches sur l’Internet en général où on n’a cessé de ré-inventer la roue. La marginalisation des théoriciennes féministes et de la pensée des conditions du travail domestique en particulier a conduit à affirmer, sans véritables fondements, la nouveauté des situations contemporaines de précarité ou de brouillage des frontières de la vie et du travail – c’est notamment ce qui me pose problème avec la mobilisation de la notion d’usine sociale. En retour, cela signifie qu’on a négligé les modèles et critiques de ces formes de travail qui existaient déjà, et dont certains étaient tout-à-fait valables – les théories matérialistes du travail domestique, par exemple –, pour au contraire réinventer toute la critique.
Mise à part la violence symbolique remarquable exercée sur les universitaires et militantes féministes, cette élision a eu pour conséquence le rétrécissement du spectre de la critique disponible pour interpréter et agir, ce qui, en définitive, est néfaste pour les politiques anti-capitalistes. Notre incapacité à reconnaître les conditions dans lesquelles les personnes qui ne sont pas des hommes, blancs, cis, hétéro, ont toujours travaillé fait que nous avons été incapables d’apprendre de ce que Rema Hammami ((Hammami Rema, “Precarious Politics: The Activism of “Bodies That Count” (Aligning with Those That Don’t) in Palestine’s Colonial Frontier”, in Judith Butler, Zeynep Gambetti, and Leticia Sabsay (dir.), Vulnerability in Resistance, pp. 167-190, Durham, Duke University Press, 2016.)) nomme la « survie subalterne » et de son cortège de subversions tactiques et structurelles. Il apparaît donc crucial de centraliser ces perspectives, pas seulement parce qu’elles fournissent des cadres pertinents et utiles pour comprendre les conditions de travail contemporaines, mais parce qu’elles peuvent largement contribuer aux luttes.
La discussion des frontières entre travail et loisir, production et consommation, travail productif et improductif, ou encore travail libre et aliéné, a été ravivée récemment, précisément parce qu’avec les réseaux numériques, le capital s’est vu offrir la possibilité de bénéficier librement de l’activité ludique et spontanée des utilisateurs. Est-ce que donc vous diriez, et en quel sens, que notre activité en ligne est productive tout en étant libre ? Ou que les réseaux ont complètement fait s’effondrer ces frontières ?
Je ne dirais pas que les réseaux numériques ont fait s’effondrer ces frontières, car ce que nous apprend l’histoire critique du travail domestique et de la formation des subjectivités au sein de la division genrée, sexuelle et raciale du travail, c’est que de telles distinctions ont toujours été illusoires. Pour les femmes et les personnes racisées, il n’y a jamais eu d’espace qui ne soit fondamentalement constitué par les manières qu’a eu le capitalisme d’incorporer les logiques patriarcales et racistes. Même la subjectivité individuelle est fondamentalement articulée en lien avec ces relations de pouvoir ; donc depuis un point de vue critique féministe ou queer, ces distinctions entre travail et loisir ne tiennent pas.
Cependant, ce que les technologies des réseaux numériques ont accompli, c’est de rendre cet effondrement plus manifeste, et sans doute plus normatif. Je note en passant dans le livre qu’on a le sentiment que l’exploitation du travail immatériel n’a été « inventée » que quand elle est sortie de la cuisine pour débarquer sur Internet – c’est-à-dire quand ça a commencé à concerner des hommes blancs, de classe moyenne, cis, hétéro et valides. Ces hommes sont bien sûr eux aussi fondamentalement constitués, en tant que sujets, par le mode d’accumulation capitaliste, particulièrement en ce que la masculinité et la blanchité sont fondamentalement liées au travail, mais la position privilégiée de la masculinité blanche dans le capitalisme autorisait jusqu’alors à penser le soi comme extérieur au capital. L’omniprésence de réseaux numérique qui exigent ouvertement l’effondrement de la distinction du travail et du loisir rend la dimension capitaliste de cette subjectivation de plus en plus difficile à ignorer.
Cela dit, il y a bien quelque chose de nouveau dans les mécanismes de capture associés aux réseaux numériques. La numérisation tend à abstraire l’inaliénable en intension comme en extension – c’est-à-dire qu’elle tend à le rendre quantifiable et mesurables – d’une manière qui affecte la forme de l’expropriation. On peut penser ici à la façon dont des technologies de la quantification, comme les dispositifs de mesure de soi, tentent par exemple d’évaluer l’humeur par le rythme cardiaque, fournissant ainsi un ensemble de mesures de la subjectivité, qui participent ensuite de la gestion de soi, voire de la gestion de la force de travail dans l’entreprise, comme on peut le constater dans l’étude de Phoebe Moore ((Moore Phoebe V., The quantified self in precarity: work, technology and what counts, Abingdon, Oxon, Routledge, 2018.)).
Il est néanmoins important de reconnaître que cela ne signifie pas que les technologies numériques capturent véritablement l’humeur, la subjectivité ou l’affect. Elles ne peuvent capturer qu’une version appauvrie de ces dimensions inaliénables du soi, en basant leurs inférence sur l’extériorisation de processus qui par essence sont intérieurs. Etant donné que le capitalisme se fiche de comprendre « vraiment » qui vous êtes, et qu’il ne va mobiliser que l’image qu’il a de vous sans se soucier de sa véracité, il n’est pas totalement en mesure de capturer ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C’est là que la relative autonomie des travailleurs se connecte à nouveau aux réseaux numériques. Notre activité médiée numériquement reste libre en cela qu’elle produit des affects insaisissables, des activités riches de sens, des relations et des échanges étrangers au marché, et ce même si elle est prise dans une logique capitaliste. C’est d’ailleurs aussi une caractéristique du rapport du travail domestique au capital, et une des raisons pour lesquelles le travail domestique peut constituer un modèle utile pour penser ce travail.
Qui est cette « digital housewife », cette « femme au foyer numérique » ? Et en quoi est-elle, ou est-il, spécifiquement numérique ? Les théories de la reproduction sociale ont démontré que l’autovalorisation du capital reste largement tributaire d’un second circuit consistant en la reproduction de la force de travail elle-même, et qui exige une quantité considérable de travail : la prise en charge matérielle des corvées domestiques, le soin apporté aux enfants et aux personnes âgées, le soutien émotionnel et affectif, etc. En quoi cela implique les technologies numériques en particulier ? Quelle relation le travail domestique « numérique » entretient-il avec le reste du travail reproductif ? Est-ce que celui-là diffère en quelque façon de celui-ci ?
Il serait absurde, et aussi probablement injurieux, de rabattre les aspects les plus physiques, pénibles et souvent dégradants du travail domestique matériel et affectif sur le genre d’affaires qui se déroulent sur les plateformes de médias sociaux dont je me préoccupe dans mon livre. C’est notamment la contrainte structurelle et parfois violente, associée au travail domestique non-payé, qui fait défaut dans l’usage de ces plateformes. Ce sont des activités radicalement différentes du point de vue de leur importance, tant économiquement que socialement.
La femme au foyer numérique, par conséquent, ne correspond pas directement à l’activité matérielle du travail domestique, mais est utilisée comme une analogie pour indiquer comment le type de travail mis en œuvre par les utilisateurs de médias numériques a la même relation structurelle au capitalisme que le travail domestique – indispensable à la création de survaleur, mais aussi capable de générer des produits inaliénables, non-marchands. Cette hybridité et cette multiplicité sont caractéristiques de tout type d’activité reproductive. Comme nous le rappelle Silvia Federici dans Point zéro: propagation de la révolution : travail ménager, reproduction sociale, combat féministe ((Federici Silvia, Point zéro: propagation de la révolution : travail ménager, reproduction sociale, combat féministe, trad. Bonis O., Tissot D., Donnemarie-Dontilly, Éditions iXe, 2016.)), le travail reproductif est toujours en tension, car la manière dont nous produisons et reproduisons les corps et les consciences dans le capitalisme est à la fois dans et en dehors du marché, menaçant toujours de déborder au-delà de celui-ci. C’est en cela que consiste son potentiel de transformation, et c’est, je l’espère, la conclusion la plus large que l’on puisse tirer de mon étude d’un ensemble étroitement défini d’activités relativement frivoles telles que l’utilisation des plateformes de médias sociaux.
Les interactions sociales numériquement médiées seraient donc une instanciation de ces activités « hybrides », comme vous les nommez, libres et pleines de sens, et pourtant aussi exploitées, comme l’est le travail domestique. Mais ce dernier, potentiellement doué de sens en effet, semble être également une activité laborieuse qui réclame un gros investissement en temps, activité que chacune et chacun, s’il en avait les moyens, pourrait raisonnablement vouloir déléguer à des nourrices, des traiteurs, des pressings, des femmes de ménage et autres travailleurs et travailleuses domestiques. De plus, la reconnaissance de ces activités comme relevant d’un véritable travail, a été l’objet de luttes politiques. Pensez-vous que les relations numériques aussi soient de quelque manière vécues et contestées en tant que relations de travail ?
La contestation est inhérente à tout travail reproductif, ce qui inclut le travail de consommation – les Cultural Studies nous l’ont enseigné depuis déjà longtemps. Sur les réseaux numériques, on peut le voir avec les stratégies de déconnexion décrites par Ben Light ((Light Ben, Disconnecting with social networking sites, Basingstoke (Hampshire), Palgrave Macmillan, 2014.)) qui permettent à première vue aux utilisateurs de gérer les situations d’éclatement du contexte ((N.d.T. : La notion de « context collapse », qui vient de l’anthropologie anglo-saxonne des usages du numérique, et qu’on peut traduire par « éclatement du contexte », recouvre la possibilité inhérentes aux communications via les réseaux sociaux numériques que le message publié soit finalement reçu par un public beaucoup plus large que celui auquel il était initialement destiné, qu’il glisse hors de son contexte d’énonciation, et que son sens échappe donc à la personne qui en est l’auteure.)), mais qui fonctionnent en réalité comme des stratégies d’esquive du travail. Les gens utilisent régulièrement des bloqueurs de publicités et des routeurs anonymisants, ou jouent avec les systèmes de capture de données du Web commercial en y insérant de fausses informations, ce qui contribue à saboter l’exploitation continue de leur activité en ligne. Quant à savoir si de tels actes peuvent être conceptualisés comme des luttes au sein de relations de travail, c’est une autre question, à laquelle je ne peux pas répondre. Cependant, leur reconnaissance active pourrait bien ne pas être absolument requise pour qu’ils soient efficaces à réduire l’exploitation des utilisateurs.
La campagne « Des salaires pour Facebook » est une autre façon d’articuler la lutte, et qui plus est explicitement liée aux relations de travail. S’inspirant ouvertement des principes qui ont animé les campagnes féministes « Des salaires pour le travail domestique » dans les années 1970 ((Sur « Wages for Housework », voir TOUPIN Louise, « Le salaire au travail ménager, 1972-1977 : retour sur un courant féministe évanoui », Recherches féministes, 29 (1), 2016, pp. 179-198)), son manifeste propose moins de chercher une compensation pour le travail réalisé pour le compte de Facebook, comme son nom pourrait le laisser croire, mais plutôt de démystifier la centralité des entreprises capitalistes dans le tissu social et de rechercher l’augmentation de la capacité d’agir qui vient avec la formalisation du contrat de travail. Je ne suis pas sure qu’il suscite une large adhésion, mais il signale au moins la prise de conscience croissante de l’expropriation des données des utilisateurs par le capital, pensée en termes de relations de travail.
Mais quand on parle de contestation, il est vraiment important de préciser à quel type d’interactions numériques on fait référence. L’idée de digital labour, ou de travail médié par des plateformes numériques, va de l’exploitation du travail de production d’un tweet par un employé de classe moyenne et plutôt aisé au combat mené par les chauffeurs d’Uber ou les travailleurs de TaskRabbit pour obtenir un salaire minimum. Les luttes, et leurs enjeux, ne se situent pas à la même échelle, et n’ont pas la même importance, ni un lien aussi clair aux relations de travail. Je suis plus intéressée aujourd’hui par les formes de luttes qui accompagnent ce second type d’interactions, ces activités de travail qui sont exploitées de façon plus matérielle, et autour desquelles se développent des pratiques politiques fascinantes. La récente qualification légale des chauffeurs d’Uber comme des employés dans quelques Etats a été une victoire importante pour les travailleurs, mais on peut aussi, grâce à l’étude de Julie Yujie Chen ((Chen Julie Yujie, « Thrown under the bus and outrunning it! The logic of Didi and taxi drivers’ labour and activism in the on-demand economy », New Media & Society, Online First, 2017.)) sur les conducteurs chinois, découvrir d’autres formes de luttes qui impliquent le détournement des dispositifs technologiques pour mieux s’organiser. Je dirais donc qu’il y a suffisamment de preuves de l’existence de relations numériques concentrées dans l’activité politique du travail vivant.
Quels pourraient être les possibles débouchés pratiques – en termes de luttes politiques, justement – de la lecture des réseaux numériques à travers la figure conceptuelle de la femme au foyer numérique ?
C’est quelque chose sur lequel je travaille encore. J’ai écrit ce livre essentiellement par frustration de voir la pensée féministe marginalisée dans les discussions sur le travail des utilisateurs, ce qui explique qu’il soit vraiment très étroitement ciblé. Depuis sa publication, j’ai cependant eu la satisfaction de voir qu’il a été mobilisé dans une grande variété de discussions politiques ; ce qui m’a permis de réfléchir aux implications plus larges de la femme au foyer numérique, ou plus précisément, de la centralisation de la reproduction sociale.
Une ligne de pensée qui émerge lorsque l’on explore le travail reproductif comme un travail, c’est la considération de chaînes de valeur plus longues dans notre critique du capital. Souvent, le point d’ancrage de la lutte ou l’objet central de la critique économique, c’est un point singulier dans la chaîne de valeur, traditionnellement celui qui implique la production d’une marchandise. La lutte pour l’égalité salariale est une de ces luttes. Cela laisse de côté de nombreux autres terrains d’intervention dans l’infrastructure capitaliste, comme par exemple la production de soi dans des contextes domestiques, en dehors du cadre critique qui nous explique comment transformer ou renverser le capitalisme. Le but, ce n’est pas de nier l’importance de la lutte des travailleurs contre le capitalisme au sein de contextes institutionnels formels, mais plutôt de comprendre qu’elle doit nécessairement aussi s’accompagner d’une transformation de ce système d’exploitation du point de vue de sa reproduction. Si, comme le soutiennent Nick Srnicek et Alex Williams ((Srnicek Nick and Alex Williams, Inventing the future: postcapitalism and a world without work (2nde éd.), London, Verso, 2016.)), nous avons besoin d’un projet contre-hégémonique pour concurrencer l’économie de plateformes, il est alors essentiel d’inclure dans notre perspective ces sites que l’on ne reconnaît pas a priori comme des plateformes de travail, mais où la rationalité économique est la norme et a des effets concrets. Ceux-ci sont des sites de reproduction sociale qui, pour en revenir à Federici, constituent le point zéro de l’action politique.
Comme cela a été mis en avant par de nombreuses contributrices de l’excellent Social Reproduction Theory édité par Tithi Bhattacharya ((Bhattacharya Tithi (éd.), Social reproduction theory remapping class, recentring oppression, London, Pluto Press, 2017.)), prêter à la reproduction sociale l’attention qu’elle mérite a aussi des conséquences sur la composition technique et politique de la classe, permettant ainsi tisser des liens de solidarité sur une base qui n’est pas uniquement celle de la relation structurelle au travail salarié. L’inclusion de ce qu’on pourrait appeler (parfois pour les dénigrer) « politiques de l’identité » (ou « identity politics ») au sein de la lutte des classes – en reconnaissant que les oppressions liées au genre, à la race, à l’orientation sexuelle, à la validité ou au sexe, font partie intégrante de la totalité qu’est le capitalisme, avec leur propres histoires, trajectoires et résistances – permettrait d’envisager des alliances et des formes d’action collective nouvelles, qui pourraient ainsi se déployer sur toute une variété de terrains, y compris là où le capitalisme contemporain exploite les différences et les rapports de pouvoir qui leurs sont associés. Ces points de solidarité pourraient ne pas être uniques et immuables ; en effet toutes ces autres dimensions de l’assujettissement économique recouvrent, dépassent, ou sapent certains présupposés traditionnels relatifs à la texture de l’exploitation capitaliste, ce qui, sur le plan politique, peut avoir pour effet de multiplier les points de contact. Néanmoins, leur articulation, et la négociation de celle-ci au fil de l’évolution du paysage politique, vont encourager des luttes qui ne se contentent pas de reproduire les différentes oppressions mises en œuvre par le capitalisme. Ceci devrait être le but de toute forme de résistance, et il devient impératif de mettre les sphères de la reproduction au centre de l’analyse.
Entretien réalisé et traduit de l’anglais par Marc-Antoine Pencolé