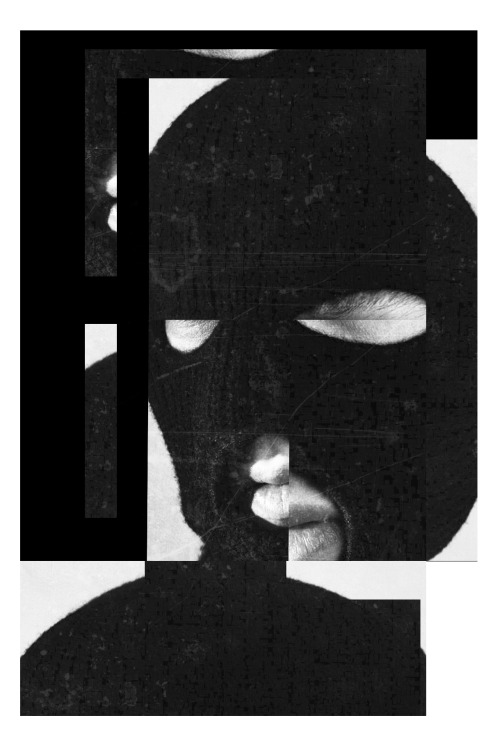L’apport de cet article aux analyses critiques du terrorisme consiste en une présentation et comparaison de deux approches de la sécurité intérieure aux États-Unis ((Créé le 27 novembre 2002 par le Homeland Security Act (Loi sur la sécurité intérieure), le United States Department of Homeland Security (département de la Sécurité intérieure) compte 8 missions principales parmi lesquelles la prévention des actes de terrorisme figure au premier rang. Il regroupe sous une même tutelle administrative 22 agences fédérales jusqu’alors distribuées au sein de divers départements et agences de l’administration. La « sécurité intérieure » se réfère ici au département de la Sécurité intérieure et à l’ensemble des dispositifs, savoirs et processus de contrôle qui lui sont liés (N.D.T).)) : premièrement, l’approche en termes d’état d’exception, dérivée de Carl Schmitt et introduite au sein des débats contemporains via sa reconceptualisation par Georgio Agamben, et deuxièmement, une approche stratégique-relationnelle élaborée à partir de la théorie de l’État de Nicos Poulantzas et Bob Jessop.
Dans les deux premières sections, j’esquisse à grands traits l’approche en termes d’état d’exception et montre en quoi les développements récents de la sécurité intérieure résonnent avec celle-ci tout en la contredisant aussi par certains aspects. Je procède ensuite à une évaluation critique de l’approche d’Agamben que j’estime être conceptuellement fragile et analytiquement limitée pour comprendre l’antiterrorisme. Dans les trois sections restantes, je présente quelques aspects clefs d’une approche stratégique-relationnelle alternative et suggère un cadre plus pertinent pour appréhender l’antiterrorisme. Mais résumons d’abord mon argument.
Dans État d’exception (2003), Georgio Agamben procède à un réexamen fondamental d’un débat des années 1920 – partiellement implicite, partiellement explicite – entre Walter Benjamin et Carl Schmitt afin de défendre sa propre thèse sur le pouvoir politique formulée dans Homo Sacer (1998). Ce faisant, il fournit un cadre conceptuel qui résonne puissamment avec la vague de mesures antiterroristes post-11 septembre. Pour Agamben, la politique en Occident est devenue un état d’exception permanent nous réduisant (à commencer par les détenus de Guantanamo) à la vie nue. Cette analyse a été largement mobilisée, dans une myriade de variations, pour rendre compte du pouvoir politique sous l’antiterrorisme. Ainsi, par exemple, le rapport vie nue/souverain est utilisé pour re-conceptualiser les politiques frontalières (Vaughan-Williams, 2009) et appréhender les subjectivités résultant de la gestion de la crise financière (Brassett et Vaughan-Williams, 2010). Le camp – l’interface privilégié du pouvoir souverain et de la vie nue – devient le paradigme de la vie sociale et de la culture (Diken et Lausten, 2005). L’état d’exception permanent constitue la nouvelle configuration de pouvoir global (Hardt et Negri, 2004, p. 7), le résultat de la restructuration du monde (Callinicos, 2003, p. 6), la matrice d’un « contre-droit » (Ericson, 2007, p. 26-35) ou un terme synonyme de déclin de la démocratie libérale et de l’État de droit ainsi que de l’avènement de pouvoirs coercitifs arbitraires (Schurman, 2002 ; Bunyan, 2005 ; Michael-Matsas, 2005, p. 222–248 ; Whyte, 2005 ; Paye 2007) ((Pour une revue critique de quelques-unes de ces positions, voir Neocleous (2006).)).
Dans cet article, j’affirme que, malgré des correspondances fortes entre l’hypothèse d’Agamben et des aspects clefs de la politique anti-terroriste, la thèse de l’état d’exception ne peut pas fournir une interprétation adéquate de la politique contemporaine. « L’exception permanente » a pour prémisse une compréhension de la politique comme effet structurel des interactions entre le pouvoir souverain et la vie nue. Cet effet est essentiellement inaliénable à travers l’histoire (occidentale). Il reste le même quels que soient l’identité de celui qui occupe chaque position structurelle (vie nue, souverain), le contexte dans lequel se joue leur relation et les buts et significations qui la sous-tendent et l’orientent. Cette réduction de la politique à une condition éternelle et singulière la vide de son contenu, lui ôte ses formes socio-historiques spécifiques et, de ce fait, la rend impossible. L’analyse d’Agamben occulte ainsi des questions clefs attenant aux pratiques, processus, raisons et objectifs qui caractérisent la sécurité intérieure.
Afin de remettre la politique au centre de l’analyse et de fournir un cadre pour traiter de (ou du moins poser) ces questions, je propose une approche stratégique-relationnelle de la sécurité intérieure. J’avance l’argument selon lequel cette dernière constitue une reconfiguration de l’étatisme autoritaire, une forme étatique constituée pour gérer l’état de crise permanent caractérisant les sociétés capitalistes. « L’exception permanente » versus « la crise permanente » : les deux formulations semblent similaires. Mais ce léger changement de vocabulaire indique un basculement conceptuel plus large. L’analyse se déplace de celle de pures essences à celle de conjonctures socio-historiques spécifiques, les considérations théoriques basculent des structures vers les rapports sociaux et la base méthodologique est transférée du droit et du langage aux dynamiques sociales. En résumé, notre approche envisage l’antiterrorisme dans sa spécificité sociale et historique permettant ainsi une compréhension plus riche de la reconfiguration du pouvoir politique qu’il génère.
La thèse de l’exception
L’exception, telle qu’elle est exposée de manière paradigmatique par Schmitt (1985), se matérialise dans une situation d’urgence existentielle et constitue le moment où la politique normale cesse d’avoir cours. L’ordre légal et constitutionnel qui régule quotidiennement la politique ne convient plus pour faire face aux enjeux présents. Il est alors suspendu au profit de l’acteur le plus puissant et le plus résolu – le souverain – qui peut décider et agir comme il l’entend.
Le souverain est l’acteur dont la prérogative consiste à décider de l’existence effective de l’exception. Il ne s’agit pas (nécessairement) de l’entité qui crée le droit mais de celle qui dispose du pouvoir de suspendre le droit. Le souverain est un acteur singulier et unitaire qui, dans l’exception, concentre tout le pouvoir. Il annule ce faisant la pluralité des pouvoirs au sein de l’État libéral et fait ressortir la singularité inhérente à la logique même du pouvoir (Kondylis, 1994, p. 128-131). L’action du souverain ne repose plus sur le droit mais sur la force. Comme les évènements et dynamiques sociales ne sont plus médiatisés par l’ordre légal, l’exception constitue un moment de guerre ouverte au cours duquel l’antagonisme force/contre-force devient la seule détermination de l’action. L’intervention violente du souverain dans le cadre de l’exception prépare le terrain – voire créé un précédent – pour l’émergence d’une nouvelle normalité juridico-politique qui sera éventuellement établie après l’exception. Le spectre de l’exception anticipée détermine le contenu et les caractéristiques de la normalité juridico-politique. Par conséquent, l’exception n’est pas seulement un moment d’authentique création légale et politique mais constitue l’acte constitutif même de la normalité et prime par conséquent sur celle-ci (Kondylis, 1994, 126 ; Mills, 2008, 61-62).
Schmitt a rapidement restreint le potentiel radical de son analyse de l’exception en la réintroduisant dans l’ordre légal. Même s’il suspend le droit, l’état d’exception ne signifie pas l’anomie ou le chaos. La décision qui submerge l’ordre légal reste contenue au sein d’un cadre juridique. Son imprédictibilité même est prévue par ce dernier et, en retour, génère la normalité qui donne à la loi sa validité (Schmitt, 1985, p. 12-13 ; Agamben, 1998, p. 17-9, 2005, p. 36). De même, le souverain qui suspend et réinitialise l’ordre légal constitue une créature de ce dernier. L’ordre juridique détermine quelle personne ou institution assumera la décision et agira au sein de l’exception. Le souverain est un pouvoir juridiquement établi. Au cours de l’exception, il peut totalement suspendre l’ordre juridique mais non les règles fondamentales de l’ordre social (Kondylis, 1994, p. 156-157 ; Norris, 2005, p. 58). L’étatisme de Schmitt et son identification exclusive de la politique à l’État, du moins dans ses écrits antérieurs à la seconde guerre mondiale, lui permettent de localiser le souverain simultanément au sein et à l’extérieur de l’ordre juridique. Alors que le droit est suspendu par l’État, ce dernier subsiste et cherche à se sauvegarder. L’État constitue ainsi l’élément qui différencie l’exception du chaos (Kondylis, 1994, p. 162).
Sur cette base, Agamben procède à un double mouvement. D’abord, dans la lignée de Schmitt, il interprète l’exception et le souverain comme des concepts-limites appartenant à la fois à l’ordre juridique et se situant au-delà de ce dernier. Ces deux concepts sont mutuellement constitutifs. L’exception et le souverain émergent ensemble : la première désigne – ou révèle – le second comme force suprême capable de décider et d’agir au-delà des confins de l’ordre juridique tandis que le souverain peut non seulement intervenir sans restrictions au sein de l’exception mais dispose de la capacité même de la déclencher.
Agamben complète ce couplage conceptuel entre un sujet (le souverain) et une situation (l’état d’exception) en introduisant un autre concept : homo sacer, l’individu réduit à la vie nue. Agamben récupère cette figure des marges du droit romain originel au sein duquel elle renvoie à un type particulier de criminel exilé. L’homo sacer ne peut être sacrifié. En revanche n’importe quel membre de la communauté a le droit de l’assassiner sans être poursuivi pour homicide. Cette figure de celui qui ne peut être tué par la force politique organisée de la société mais dont la vie se trouve laissée à la discrétion des membres de la société constitue un autre concept-limite situé à la fois au sein et au-delà de la loi. Non protégé par le droit, l’homo sacer constitue l’objet du pouvoir dont la capacité à agir au-delà de toute contrainte légale est permise par le droit. Il existe une analogie étroite entre les deux entités : le pouvoir souverain met la vie à nu en lui ôtant ses médiations juridiques, et, simultanément, la vie nue fonde le pouvoir souverain en tant que tel dans la mesure où elle est son objet. Le pouvoir souverain et la vie nue se constituent mutuellement dans un même mouvement. Le souverain et l’homo sacer sont des concepts opposés mais homogènes (Agamben, 1998 ; Mills, 2008, p. 72 ; Murray, 2010, p. 64-65). Agamben établit ainsi le rapport mutuellement constitutif entre les deux subjectivités (homo sacer et souverain) et voit en lui le cœur de tous les rapports de pouvoir de la civilisation occidentale (Agamben, 1998, p. 8-9 ; Mills, p. 64-65). L’état d’exception forme alors le contexte situationnel qui est produit par ce rapport de pouvoir et qui simultanément le réalise. L’argument clef d’Agamben est que ce rapport constitue le « centre » dissimulé du « pouvoir », la « structure politique fondamentale » secrète (Agamben, 1998, p. 20, 2005, p. 86).
Jusqu’ici, Agamben reproduit le schéma schmittien de l’interrelation entre concept-limites permettant de saisir le sens véritable du pouvoir. L’introduction de la vie nue en tant qu’objet constitutif de ce pouvoir complémente mais ne remet pas en question cette construction. En effet, l’Ennemi de Schmitt, particulièrement sous les traits du Partisan, qui « connait et accepte sa condition d’ennemi existant hors du bien, du droit et de l’honneur » peut être considéré sous un prisme agambenien comme une créature de la vie nue (Schmitt, 2007, p. 11, p. 30).
Agamben dépasse cependant l’univers schmittien en affirmant la possibilité de l’état d’urgence « réel » existant totalement au-delà de l’ordre juridique. Dans la lignée de Benjamin, il récupère le potentiel radical de la violence (« divine ») de l’exception comme création ex-nihilo d’un nouvel ordre social (Benjamin, 1986, p. 52-64 ; Agamben, 2005). Il renoue en d’autre termes avec les implications radicales de l’exception que Schmitt s’était évertué à supprimer en la construisant comme concept-limite (Kondylis, 1994, p. 156-162).
Pourtant, malgré l’affirmation de la possibilité d’une exception révolutionnaire qui détruirait le souverain comme possibilité politique ultime, l’analyse de la politique contemporaine par Agamben reste confinée au schéma schmittien. L’exception prolifère dans tous les espaces de la vie sociale et cette expansion (topologique) la constitue comme (chronologiquement) permanente : l’exception est devenue la norme. La fondation du politique sur l’opposition entre le droit et la violence pure se voit dépassée. Le droit est drainé de son contenu et de sa signification et, pendant que les médiations légales se retirent, l’essence véritable du pouvoir en tant que puissance souveraine se révèle. Privés de nos médiations juridico-politiques, nous sommes tous réduit à la vie nue. Même s’il constitue une tendance toujours présente, cet état d’exception permanent atteint un nouveau stade de concrétisation sous la forme de la politique antiterroriste (en particulier américaine) post-11 septembre (Agamben, 2005). Dans la section suivante, je traite dans les grandes lignes de la pertinence de la thèse de l’exception permanente pour penser les réalités de la politique antiterroriste américaine.
La sécurité intérieure comme état d’exception
Les mesures antiterroristes, ainsi que celles visant à gérer la crise économique en cours, se caractérisent par une abondance d’éléments exceptionnels. Pour commencer, la législation antiterroriste a rejeté le judiciaire hors des enquêtes « terroristes » (i.e criminelles). Elle a transformé le maintien de l’ordre en une activité de prévention fondée sur le renseignement, dissocié la surveillance de la suspicion du crime, séparé la sentence punitive de la commission effective de l’acte illégal et a conduit à la prolifération de lois vagues, élastiques et subjectives notamment en ce qui concerne le crime au cœur de l’antiterrorisme, « le terrorisme intérieur », ainsi que la catégorie clef de la politique économique, « les actifs financiers ». Ces tendances combinées réduisent la loi à un simple instrument de mise en œuvre d’objectifs politiques (voir Paye, 2007, ch. 5-6 ; Donohue, 2008, p. 233-272 ; Boukalas, 13-40, p. 222).
Cet instrument est saisi par le souverain, ici l’exécutif fédéral et la Maison Blanche en particulier. Une fois le judiciaire marginalisé, l’exécutif se retrouve seul en charge d’un vaste appareil de maintien de l’ordre centralisé et l’appareil de renseignement, devenant de plus en plus omniscient, est ramené sous le contrôle direct du président. Les clauses légales vagues et mal définies donnent un pouvoir discrétionnaire total à l’exécutif pour sélectionner les cibles et agir comme l’entend son personnel dirigeant. L’exécutif a ainsi obtenu : a) des pouvoirs pour légiférer (loi de stabilisation économique d’urgence de 2008, EESA), b) son propre système juridique parallèle fondé sur la catégorie spéciale d’ « ennemi combattant » dans lequel il désigne le criminel et met en place un régime de détention, de jugement et de punition qui ne repose sur aucune loi et c) la capacité à assassiner les individus qu’il sélectionne (Samples, 2010 ; Roach, 2011, p. 208-210, p. 229-231). Il semblerait en effet que le retrait du droit révèle la puissance du souverain.
Cette puissance s’exerce avec intensité sur toute la population. La législation antiterroriste se montre extrêmement innovante dans sa capacité à étendre la culpabilité par association. En plus de la dissociation entre la peine et l’acte criminel, un vaste ensemble d’ « associés » peut être soumis à des mesures pénales du moment que le secrétaire d’État ou le procureur général en décident. Dans la mesure où le pouvoir policier cherche à sanctionner le crime avant qu’il ne se produise, la population entière est prise, du fait des criminels potentiels se terrant en elle, dans un gigantesque filet de renseignement. Ceci implique que la présomption de culpabilité devient de facto valable pour tous. Par ailleurs, le traitement légal réservé aux catégories criminelles spéciales exemplifié par Guantanamo est remodelé afin de s’appliquer à tous (depuis la loi d’autorisation de défense nationale de 2012). C’est à partir de cette catégorie clef de l’antiterrorisme que le souverain affirme son monopole sur la politique en criminalisant l’ « influence » politique excessive de la population sur le gouvernement. En bref, le retrait du droit signifie non seulement l’avènement d’une puissance souveraine sans bornes mais aussi celle d’une subjectivité qui n’est plus protégée par les médiations légales (voir ACLU, 2012 ; Belandis, 2004, p. 279-281 ; Boukalas, ch.5-6 ; Mattelart, 2010).
Il semblerait que l’antiterrorisme déchaine la triade état d’exception/pouvoir souverain/vie nue dans son intensité maximale. Quatorze ans après le 11 septembre et cinq ans depuis le déclenchement de la crise économique, on peut clairement affirmer que les pouvoirs d’ « urgence » sont devenus permanents. Ils sont en train de s’étendre, de s’intensifier et de se métastaser de la politique sécuritaire à la politique économique. Au cours de ce court début de siècle, les situations d’ « urgence » majeure de tel ou tel type semblent se précipiter et s’intensifier. La thèse de l’exception permanente qui s’étend à toutes les sphères de la vie sociale et créé la nouvelle norme sociale paraît être totalement confirmée.
Il subsiste cependant des aspects de la sécurité intérieure qui ne rentrent pas aisément dans le schéma de l’exception. Pour commencer, la plupart des modalités du pouvoir « souverain » et non-régulé sur l’individu étaient déjà présentes et inscrites dans l’ordre juridique bien avant la vague antiterroriste actuelle. Par exemple, le principe de « culpabilité par association » fut inséré dans le droit via la loi sur l’antiterrorisme et la peine de mort de 1996. La dissociation de la surveillance et de la suspicion criminelle fut introduite par la loi sur la surveillance du renseignement étranger de 1978 (FISA) qui visait à réguler des pratiques mises en œuvre depuis des décennies. Ces deux principes mirent à mal la présomption d’innocence et leur mise en pratique fut laissée à la discrétion du personnel à la tête de l’exécutif.
L’antiterrorisme systématise et intensifie ces modalités et, fait décisif, les étend. Initialement, elles définissaient les relations entre l’État et certaines catégories « spéciales » de la population (l’espion, l’étranger et le « terroriste international »). Le premier pouvaient négocier voire refuser aux secondes les protections légales normalement accordées à la communauté citoyenne. L’antiterrorisme étend l’application de ces modalités à l’ensemble de la population. Avec Agamben, nous pouvons affirmer que la norme de la catégorie exceptionnelle – la vie nue – devient la norme de tous.
Cependant, cette expansion se déploie sur un mode incrémental et organique. Elle s’accompagne de révisions, de résistances, de retraits et d’affinements. Ce procédé s’apparente d’avantage à une nappe juridique étendue pour couvrir de nouvelles parties ou l’ensemble du corps social ou à un effet de cliquet. Des pouvoirs coercitifs immenses sont ainsi introduits afin d’être appliqués à des fractions juridiquement et politiquement marginales de la population pour ensuite être étendus à tout le monde pendant que de nouveaux pouvoirs plus intenses sont élaborés pour la catégorie spéciale avant d’être de nouveau étendus à l’ensemble de la population et ainsi de suite. Dans tous les cas, nous sommes loin d’être confrontés à la force fantasmagorique de la décision souveraine qui ébranle et refonde radicalement l’ordre juridique existant.
En réalité, même s’il a connu des reconfigurations majeures, allant principalement dans la direction exposée plus haut, l’ordre juridique ne fut à aucun moment suspendu. Même si l’administration Bush présenta effectivement les évènements du 11 septembre comme un moment d’urgence existentielle, elle se montra fort réticente au fait d’être perçue comme un gouvernement « agissant avec résolution et fermeté ». Aucune section de la constitution ne fut suspendue ou contournée. Immédiatement mobilisé pour conférer des pouvoirs écrasants et arbitraires à l’exécutif, le Congrès s’exécuta promptement. De ce point de vue, l’ensemble du corps législatif antiterroriste produit dans la foulée du 11 septembre dément juridiquement et politiquement la thèse du décisionnisme et de la concentration de tous les pouvoirs par une unique entité qui prendrait les commandes dans l’exception. Le « souverain » cherche bien plutôt à s’octroyer un pouvoir discrétionnaire à partir du droit et à l’inscrire au sein de celui-ci via la mobilisation intense du législatif et, occasionnellement, du judiciaire.
Même les pratiques les plus excessives entreprises par l’administration Bush et Obama (par exemple, les assassinats extra-juridiques) sont défendues en termes légaux en tant que pouvoirs octroyés par le Congrès (dans la loi sur l’autorisation de l’usage de la force militaire de 2001). La surveillance des communications par l’Agence Nationale de la Sécurité (NSA) du Pentagone est autorisée par un mandat de la cour secrète FISA. Même dans un cas emblématique de pratique exceptionnelle comme Guantanamo, l’absence du droit est compensée par un labyrinthe de régulations extra-, quasi- et pseudo-légales (Johns, 2005). Celles-ci furent initialement élaborées par la Maison Blanche et le Pentagone mais au fil des triangulations répétées entre les trois branches elles ont fini par entrer dans le corps principal du code juridique (Roach, 2011, p. 200-211). Pour faire court, l’invocation de l’urgence ne mène pas à un déferlement décisionniste mais à un « obligationnisme » particulier en vertu duquel l’exécutif affirme être contraint à agir. Son action est alors immédiatement codifiée, mise en procédure et légalisée. La décision est niée, de même que la responsabilité qu’elle porte avec elle (Johns, 2005).
Struttura nuda
Dans l’analyse de la politique antiterroriste et, plus largement, des modalités contemporaines du pouvoir, c’est, d’avantage que les contradictions factuelles mentionnées plus haut, la faiblesse théorique de la thèse de l’exception qu’il convient de souligner.
En affirmant potentiellement le primat de la politique sur le droit et en reconnaissant le politique comme la source de la loi, la thèse de l’exception dirige notre attention vers la violence qui sous-tend l’ordre juridique et suggère un certain arbitraire dans les fondements de la vie sociale. Elle constitue par conséquent un contrepoint bienvenu au déni par la jurisprudence anglo-saxonne de l’arbitraire du droit, de son caractère politique et de sa fondation ultime sur la force ainsi que de sa dépendance à l’égard de cette dernière. À partir de là, les problèmes s’enchainent et s’accumulent en ce qui concerne sa compréhension du politique et du droit, son utilité analytique et sa validité théorique.
Premièrement, en ce qui concerne la politique, la construction schmittienne du souverain comme corps singulier incorporant organiquement et exprimant l’intégralité d’un « peuple » pré-politique est hautement idéaliste et, de fait, mythologique. De plus, le politique est réduit au polémique soit la distinction ami/ennemi (Schmitt, 1988, 1923, p. 38-44, p. 49, 1996, p. 16-32, 2004 ; Papacharalambous, 2009, p. 21, p. 27-29). Si pour Schmitt la politique se trouve appauvrie par l’absorption du social au sein l’État, ce qui génère « le Politique », le social est tout simplement absent chez Agamben. Pour ce dernier, la politique consiste en la gestion par le souverain de la vie nue, une vie extraite de tout rapport social. Similairement, toute politique significative (le Politique ?) consiste en l’affirmation anomique de la vie comme fait radical, contre et au-delà des médiations, rapports et significations sociales. Placer une vie désocialisée au centre de la politique revient à rendre cette dernière totalement autonome vis-à-vis de la société et la réduit à la simple existence (Huysmans, 2008, p. 174-180 ; Seymour, 2013). Son caractère de procès antagoniste ayant pour enjeu l’institution de la vie collective est nié, non seulement parce qu’en l’absence du social, la politique n’a pas d’objet, mais aussi parce que la vie nue annule la possibilité même de l’antagonisme et de la lutte. Cette dernière est seulement concevable dans le contexte de rapports, significations, formes et médiations socio-historiques spécifiques. La vie nue ne peut pas lutter. Voir une telle lutte dans les résistances de personnes « vivant nues », concentrées dans des camps, et cousant leurs lèvres et paupières revient à occulter le sens donné à cet acte, celui que d’autres lui assignent et le fait que c’est cette dynamique des significations sociales qui transforme cet acte, ainsi que tout autre, en une geste politique (Huysmans, 2008, p. 177). En résumé, vider la politique de son caractère social en nie la possibilité même.
Deuxièmement, la distinction normalité-exception s’avère moins nette qu’elle ne parait. Le souverain – i.e le concept-limite qui conduit de la normalité à l’exception – semble d’avantage inséré dans la loi que ne le supposent Schmitt et Agamben. Non seulement le souverain se voit-il conférer la capacité à agir dans l’exception par le droit dans la mesure où sa conduite est strictement orientée vers la préservation de l’ordre social et normatif, mais ses exigences, pouvoirs et actions doivent en outre s’enraciner dans le droit pour ne pas rester suspendus et sans conséquences. Cela n’a rien de particulièrement exceptionnel. Le droit n’est pas un texte fini et gelé mais constitue plutôt un processus dynamique de détermination et de décision. Il s’élabore continuellement au travers du rapport à ce qui est extérieur à son contenu, via l’incorporation de son extérieur infini (Fitzpatrick, 2005, p. 61-63).
Ce qui caractérise l’antiterrorisme est non seulement le besoin irrépressible qu’a l’exécutif fédéral américain de légiférer même sur ses pouvoirs les plus arbitraires mais aussi la réaction des plus grands juristes constitutionnalistes américains à la politique antiterroriste. Qu’ils proposent une séparation drastique des pouvoirs d’urgence de l’ordre constitutionnel afin de maintenir l’intégralité de ce dernier (Gross, 2003), défendent l’incorporation de procédures d’urgence détaillées dans la constitution afin d’éviter des abus (Ackerman, 2006) ou suggèrent de repenser de manière radicale l’intégralité de la structure institutionnelle en charge de la gestion des situations d’urgence (Scheuerman, 2002), ces juristes démontrent que la loi se (re)créé constamment en s’inspirant de ses externalités. Dans le cas présent, l’externalité dont la loi s’inspire est sa suspension même dans l’exception.
Troisièmement, les arguments précédents remettent en question l’utilité conceptuelle même de l’exception. Ici, l’expansion incessante des pouvoirs exceptionnels afin d’envelopper une gamme encore plus large de phénomènes sociaux (de la guerre et de l’insurrection populaire aux conflits du travail, aux crimes politiques, aux crises économiques et de nouveau à l’insurrection populaire) et leur réintroduction dans le corps principal du droit ont brouillé de manière significative la distinction entre la norme et l’exception (Scheurman, 2000 ; Neocleous, 2006).
Un paradoxe conceptuel émerge par ailleurs. Si la suspension de la norme est incluse dans le droit et autorise un agent politique consacré à agir dans un cadre d’exception, il s’ensuit que la suspension de l’ordre juridique établi est inscrite dans ce même ordre juridique. Ainsi, ce dernier reste valable pendant sa suspension : en suspendant l’ordre juridique, l’exception le maintient. Réciproquement, c’est seulement dans la mesure où l’ordre juridique établi se maintient dans l’exception que cette dernière peut être conçue juridiquement. Ainsi, le concept d’état d’exception permanent devient absurde : il impliquerait la construction d’un ordre juridique et d’une jurisprudence (accompagnées d’un système légal, d’une constitution, etc.) sur la base de l’exception. Un tel ordre juridique ne consisterait en rien d’autre qu’en l’affirmation qu’il peut être suspendu à n’importe quel moment. De la même façon, sa jurisprudence conclurait qu’il n’y a pas besoin de distinguer strictement la norme de l’exception et que les concepts légaux comme la jurisprudence sont par conséquent superflus (Kondylis, 1994, p. 138-141).
Quatrièmement, il convient de s’attarder sur la notion de « vie nue ». En extrayant l’homo sacer comme forme de vie archétypique qui est par le droit exclu du droit, Agamben semble avoir négligé sa signification dans le droit romain originel. L’homo sacer est déjà sacrifié. Son destin se trouve par conséquent pleinement inscrit et régulé par le droit (Fitzpatrick, 2005, p. 51-52). En faisant de la vie nue de l’homo sacer « le premier paradigme de la sphère politique occidentale », Agamben ignore sa disparition du droit depuis la fin de l’Empire romain. Il établit des liens ténus avec la condition du fils vis-à-vis du père dans le droit romain tardif ou avec le principe de l’habeas corpus dans l’Angleterre médiévale et néglige ainsi le fait que ces formes étaient pleinement et totalement intégrées au droit (Agamben, 1998, p. 87-89, p. 123 ; Fitzpatrick, 2005, p. 54-56).
En plus d’être mal construite sur le plan conceptuel, la notion de vie nue est difficile à saisir dans la mesure où il s’agit d’une essence extensive et indifférente aux formes, ce qui rend sa démarcation improbable (Fitzpatrick, 2005, p. 65). Si elle semble précaire dans les confins du droit, elle devient impossible en dehors de ceux-ci. La seul façon de fonder la vie nue en tant que non subjectivité, complètement passive vis-à-vis du pouvoir souverain et dépouillée de tous rapports, médiations et appartenances politiques et sociales est de nier le politique et le social (Laclau, 2007, p. 14-16 ; Negri, 2007, p. 75 ; Mills, 2008, p. 90-92 ; Neal, 2010, p. 123). La remise en question de la notion de vie nue déstabilise aussi celle du pouvoir souverain dans la mesure où la première constitue l’objet de la seconde. En fait, compte tenu du caractère mutuellement constitutif de la vie nue, du pouvoir souverain et de l’état d’exception, la constellation politique d’Agamben semble douteuse.
Cinquièmement, chez Agamben, la norme reste non-théorisée. Contrairement à Schmitt qui avance son analyse de l’exception en tandem avec une analyse de l’État capitaliste et du droit libéral, Agamben ne s’intéresse quasiment pas à la norme. Cette dernière est dénuée de tout contenu, elle constitue une jambe de bois pour faire tenir la thèse de l’exception. L’absence de théorisation de la norme affecte la notion de l’exception : nous ne savons jamais à quoi l’exception fait exception. Elle devient un signifiant flottant capable d’adopter n’importe quel contenu substantiel. Nous voyons par exemple, qu’à l’époque romaine, l’exception (iustititum) signifiait que le Sénat autorisait les citoyens à faire tout ce qu’ils considéraient comme étant nécessaire pour sauver la République (Agamben, 2005, p. 41). Dans l’Amérique post-11 septembre, l’exception signifie la mise en quarantaine et l’occupation de l’espace public par les forces armées de l’État. Le même concept de l’exception s’applique ainsi à deux réalités opposées. Ces deux situations exceptionnelles sont diamétralement opposées l’une à l’autre car elles constituent des exceptions à des normes juridico-politiques différentes. L’exception définit peut-être la norme mais l’inverse est tout aussi vrai. La question se pose de savoir dans quelle mesure un concept peut s’avérer crédible lorsqu’il n’existe qu’en opposition à un autre qui n’est jamais défini ou décrit.
Sixièmement, le vide substantiel de ce concept clef est la répercussion au niveau conceptuel du fondamentalisme structurel d’Agamben, un retour de bâton épistémologique. Sa méthode consiste en un travail d’excavation reconstructive à l’intérieur de structures (la loi, le langage) visant à localiser les moments originaires de concepts qui, de manière assez lâche et semi-consciente, déterminent la vie sociale à travers l’histoire (Agamben, 2009). Il vide systématiquement ses catégories et concepts de leur contenu socio-historique, cherchant ainsi à les rendre éternels, toujours et à jamais valables (Papachalalambous, 2009, p. 105). Sa « correction » du traitement foucaldien de la biopolitique l’illustre bien : une analyse socio-historique ne suffit plus, le pouvoir étant « toujours » biopolitique (Agamben, 1998, p. 11). Le triptyque vie nue/pouvoir souverain/état d’exception ne se réfère à aucun rapport ou processus social. Il s’agit d’un effet structurel, d’un jeu logique au sein de structures nues (voir Rasch, 2007, p. 92-94). En découvrant (ou construisant) l’origine d’un concept, Agamben le pose comme transhistoriquement valable (Laclau, 2007, p. 11) – en particulier si l’origine du concept se situe dans la « vie pré-sociale » (sic !) comme c’est le cas avec la vie nue (Agamben, 1998, p. 104).
Pourtant, la spécificité historique ne risque pas seulement de diverger du concept mais aussi de l’ébranler. C’est le cas avec le « souverain » dans le cadre juridico-politique féodal, qui, malgré l’appellation « souverain absolu », renvoyait à une figure aux compétences extrêmement limitées et strictement définies et qui ne pouvait absolument pas fonder le droit et encore moins les principes fondamentaux de l’ordre social (Kondylis, 1994, p. 171-172).
Plus important encore, quand le concept de la norme se trouve vidé de son contenu social, le jeu des homologies structurelles ne fonctionne plus. Parce que la norme n’est rien d’autre que du contenu socio-historique spécifique, elle ne peut exister comme structure nue. Sans le contenu, la norme n’existe qu’en tant que corollaire de l’exception. Mais cette dernière était censée tirer son contenu de son rapport à la norme. Si la norme est vide alors l’exception l’est aussi. Comment distinguer les deux ? En regardant certaines structures, le langage et le droit. Mais celles-ci ne sont pas traitées comme des pratiques sociales dynamiques et des champs d’antagonismes contestées (à la manière de Gramsci par exemple) mais comme des structures fossilisées. On se retrouve avec une norme ravalée à un concept juridique continu et abstrait avec lequel l’exception rompt juridiquement. La théorisation de l’exception a pour prémisse la fétichisation de l’ordre juridique.
Septièmement, le concept de l’exception envisagé comme une rupture avec l’ordre juridique et combiné à une conception du politique comme violence souveraine risque de ré-instituer l’illusion libérale d’un droit (la norme) qui existerait séparément de la politique et serait dénué de violence. Il obscurcit ainsi l’existence concrète du droit : une organisation particulière (et politique) du terrain, des objets et des modalités de la violence (Poulantzas, 1978 ; Neocleous, 2006, p. 76-77, p. 91-92). La vision agambenienne de l’exception risque en d’autres termes de défaire ce que le concept d’ « état d’exception » cherche à saisir.
Ce danger est surtout présent chez Schmitt car pour Agamben, l’état d’exception constitue bien plus qu’une plateforme pour critiquer le libéralisme. Il est supposé révéler l’essence du pouvoir, sa forme originaire et sa structure cachée, encapsulée dans les rapports entre le pouvoir souverain et la vie nue (Agamben, 1998, p. 9, p. 26, p. 84, 2005, p. 86, 2011, p. 245 ; Norris, 2005, p. 59-61, p. 64, p. 72 ; Mills, 2008, p. 65 ; Murray, 2010, p. 262). Cette essence est imperméable au temps et à la société. Agamben ignore l’existence du droit et de la politique en tant que phénomènes sociaux afin de produire une analytique du pur pouvoir. L’erreur constitutive de la thèse de l’exception consiste en la juxtaposition d’un « souverain » anthropomorphique agissant de sa propre volonté et de son propre accord et d’un « individu » atomisé et arraché aux ensembles de significations, liens et rapports sociaux dans lesquels il existe (Whyte et al., 2010, p. 148). Une fois extraits de leurs dynamiques, structures et pratiques sociales, le droit, l’État et l’individu forment des pseudo-entités et les analyses de leurs interrelations « normales » ou « exceptionnels » deviennent des caricatures.
Huitièmement, la pertinence analytique de l’analyse agambenienne du pouvoir pour penser la politique moderne est incertaine. La thèse d’Agamben ne nous permet pas mais nous contraint à examiner la république romaine, l’Allemagne nazie et la sécurité intérieure américaine (et littéralement tout ce qui se situe entre ces périodes) avec les mêmes outils analytiques. En effet, à strictement parler, ces différentes périodes relèvent de la même chose et ne peuvent être différenciées que par le degré de révélation de la vraie nature du pouvoir dans chaque cas (voir Scheuerman, 2006, p. 69). En désengageant son argumentation d’un ancrage dans la spécificité historique, Agamben nous prive de la capacité à nous pencher sur les raisons pour lesquelles et les modalités à travers lesquelles l’état d’exception est enclenché. Dans tous les cas, le bios est réduit à la vie nue sur laquelle le souverain exerce sa violence.
Il en résulte une aporie profonde quand la thèse de l’exception se confronte à l’actualité, y compris celle de la sécurité intérieure. Par exemple, alors que la décision est prise par le souverain, nous ignorons qui est le souverain. Quand bien même son identité serait spécifiée par la loi, il n’existe pas de garantie que l’entité en question détermine effectivement l’action. Que se passe-t-il par exemple si la mobilisation de l’exception par le souverain génère un coup d’État de l’armée contre son chef suprême ? S’agit-il là d’une exception au sein de l’exception ou d’un déplacement du lieu du pouvoir souverain ? Dans ce second cas, à quel moment ce déplacement cesse-t-il et comment pouvons-nous déterminer qu’il a effectivement pris fin ? Plus important encore, le président des États-Unis est-il « souverain » ? La branche exécutive (ou ses forces armées) qu’il préside constitue-t-elle une entité singulière, unitaire ? Le président doit-il dépasser, réprimer et réconcilier les divisions et les antagonismes internes de l’exécutif ? Quelle est la portée de la décision souveraine ? Tout le monde est-il affecté à égalité par celle-ci ? Par ailleurs, le souverain est-il un sujet doté d’une volonté et d’intérêts propres ou est-il lié aux antagonismes et aux intérêts qui caractérisent plus largement la société ? Dans le premier cas, qu’est-ce qui motive le souverain ? Cette motivation est-elle la même pour tous les souverains de tous temps ? Dans le second cas, serait-ce possible que le souverain agisse pour le compte de « puissants » opérant à l’ombre des institutions ? Le caractère de leur intérêts influencerait-t-il les modalités, l’intensité, l’extensivité, la durée et le but de l’exception et son déclenchement même ? Une exception déclarée par un souverain « capturée » par de grandes compagnies pétrolières serait-t-elle la même qu’une exception « capturée » par des professeurs des écoles ? (Et pourquoi le premier scénario semble-t-il plus plausible que le second ?). De plus, même si elle était concevable, la réduction à la vie nue (l’arrachement de l’individu à ses médiations légales et à sa capacité politique) constitue-t-elle le moment où le pouvoir souverain se forme ou celui où ce dernier s’effondre (Boukalas, 2012a, p. 292-293) ? Enfin, pourquoi la normalité existe-t-elle tout court ? Pourquoi le porteur d’un pouvoir énorme ne l’utilise-t-il qu’occasionnellement ? (Colatrella, 2011).
La capacité de la thèse de l’exception à apporter une réponse à ces interrogations paraît incertaine. Il semblerait qu’en faisant abstraction du contenu social et historique de ses concepts, Agamben ne soit pas en mesure de fournir des structures que l’on pourrait alimenter d’une réalité socio-historique spécifique. Au contraire, le contenu socio-historique ébranle ces structures vides : le prix de l’essentialisme est l’imperméabilité à toute réalité historique.
L’État et le droit de la société – une approche stratégique-relationnelle
Une tentative de penser les modalités contemporaines du pouvoir politique, particulièrement telles qu’elles sont reconfigurées par la politique antiterroriste, pourrait sans doute avoir comme fondement des positions épistémologiques opposées à l’essentialisme. Il s’agirait de conceptualiser le droit, la politique et leur interrelation comme des phénomènes sociaux dynamiques déterminés par, et conditionnant, les rapports d’antagonisme social dans des conjonctures historiques spécifiques. Il en résulterait une conception du pouvoir en termes d’articulations historiquement variables de rapports sociaux plutôt que comme un effet structurel anhistorique. Une telle position conceptualiserait la norme et l’exception relativement à des configurations différentes du pouvoir social. À cet effet, je propose une approche « stratégique relationnelle » (ASR) de l’État et du droit. Le basculement conceptuel impliqué par l’ASR engendre une mutation terminologique : on passe du souverain à la forme-État, de la vie nue aux dynamiques sociales, de l’exception à la crise et de l’état d’exception à l’étatisme autoritaire.
L’ASR conceptualise l’État non pas comme une subjectivité souveraine dotée d’une volonté et d’un pouvoir propre mais comme un rapport social. L’État est le résultat de dynamiques sociales, il constitue le terrain où celles-ci se jouent ainsi qu’une forme d’agentivité importante au sein de cet espace. L’État est créé par l’antagonisme social. Ses institutions permettent la reproduction de la domination de certaines forces sociales sur d’autres. Il ne possède pas le pouvoir. Le pouvoir d’État est plutôt une condensation de dynamiques sociales médiatisées par des institutions étatiques. Ainsi, l’État forme un terrain inégal d’antagonisme social. Les forces sociales luttent pour la définition du pouvoir d’État en capturant, ajustant, influençant, abolissant et créant des institutions étatiques. Par ailleurs, l’État constitue un agent clef dans l’antagonisme social. Il sélectionne, combine et appuie les stratégies de certaines forces sociales au sein du pouvoir d’État (et en exclut et désorganise d’autres). Son agentivité ne vise pas à sécuriser son propre intérêt ou à promouvoir sa propre puissance mais à soutenir les forces sociales qui sont représentées de manière prédominante au sein de ses institutions (pour des présentations plus détaillées de l’ASR de l’État, voir Poulantzas, 1978, p. 191-367 ; Jessop, 1990, 2008).
De façon similaire, une approche stratégique-relationnelle envisage le droit comme un rapport social. Le système juridique assure la reproduction durable et relativement pacifique de la domination de certaines forces sur d’autres. Le contenu du droit est une double codification de dynamiques sociales : ces dernières sont médiatisées d’abord à travers la matérialité institutionnelle de l’État et une deuxième fois via le système juridique. Ceci fait du droit un terrain et un enjeu de l’antagonisme social ainsi qu’un vecteur clef de l’intervention étatique au sein de celui-ci. De plus, le droit est créé par l’État et fournit le cadre fondateur de son institutionalité, de son pouvoir (ainsi que des limites de celui-ci) et de ses rapports avec la société, par-delà son cadre institutionnel. Ainsi, le droit constitue une codification particulière de dynamiques non seulement sociales mais aussi étatiques (Boukalas, 2014, ch. 2).
Même une présentation aussi elliptique de l’ASR, destinée surtout à marquer notre distance vis-à-vis de la perspective d’Agamben, peut nous aider à reposer la question de l’exception. La capacité de l’État à repousser les limites du système juridique, faisait ainsi advenir la question de l’exception, résulte de son rapport au droit dans la mesure où il constitue son producteur et exécutant principal. Il peut négocier, contourner, amender, suspendre ou abolir le droit car il le produit et l’implémente. Ce faisant, l’État n’est ni une chose (un effet structurel comme chez Agamben) ni un sujet (le souverain, comme chez Schmitt) mais une articulation particulière et une agentivité au sein de dynamiques sociales. La déclaration ou non par le souverain de l’état d’exception, le contexte, le contenu, l’intensité, la durée et les buts du moment exceptionnel ainsi que le soutien, la tolérance et la résistance de différentes forces sociales qui déterminent le succès des mesures exceptionnelles : tout cela dépend des configurations socio-historiques entre forces sociales et de la manière dont elle sont représentées au sein de l’État.
Similairement, plutôt que de figurer comme pendant sous-théorisé de l’exception, la normalité constitue une configuration stable de forces sociales ainsi que le cadre de la reproduction et de l’évolution ordonnée de cette dernière. Sous cet angle, l’exception constitue précisément le moment où l’antagonisme social ne peut plus être contenu dans ses expressions institutionnalisées que sont l’État et le droit, soit parce que la conflictualité est trop aiguë soit parce que les institutions politiques sont trop rigides. Ainsi, plutôt que de constituer un moment de re-création de l’ordre social, l’exception signifie au contraire la défense acharnée par l’État de cet ordre face à la menace posée par la population (voir Kondylis, 1994, p. 16 ; Laclau, 2007, p. 157-158, p. 175).
La nature de la menace et de l’ordre, le seuil à partir duquel l’ordre social se trouve « menacé », tout cela est socio-historiquement spécifique. La notion de crise pourrait ici fournir une correctif à la notion ouvertement abstraite et structuraliste de l’exception. D’abord, la crise peut être spécifiée en ce qui concerne ses formes. La crise politique, en particulier, peut prendre (et combiner) la forme d’une crise de l’État, de la légitimité, de la représentation, de la légalité, etc. Prendre cela en compte nous permet de situer d’avantage la discussion générale autour de l’ « exception ». Ensuite et surtout, la crise est l’œuvre de forces sociales. Même si toute organisation sociale, économique et politique contient ses tendances à la crise, cette dernière n’éclate pas à moins que l’antagonisme social ne transforme ces tendances en actualité (Poulantzas, 1976a). Dans ce contexte, le problème du rapport de la norme et de l’exception se transforme en interrogation sur les formes normales ou exceptionnelles de l’État et sur les formes juridiques qui y sont associées.
Les formes de l’État – normales et exceptionnelles
L’étaticité, soit le concept et le processus de constitution d’un État, implique une division radicale du travail politique : la capacité formelle, fruit d’un accord collectif ou bien imposée, à instituer, organiser, diriger et administrer la vie sociale est extraite de la société et monopolisée par un système institutionnel particulier, l’État (Castoriadis, 1983).
Par-delà cette caractéristique spécifiante, une discussion autour (ou une théorie) de l’État « en général » aurait peu de sens, compte tenu du fait qu’elle se référerait simultanément à l’empire perse, à l’Espagne du XIVe siècle ou la Suède du XXe.. Ces derniers constituent en effet tous des États. Une typologie des États en fonction du rapport social principal sur lequel ils reposent et qu’ils ont pour fonction de reproduire, nous aiderait à faire ressortir leur caractère distinct respectif. La discussion porterait alors sur des types d’État, l’État féodal, le despotisme oriental, la théocratie, l’empire, la monarchie absolue, etc. (Poulantzas, 1973, p. 142-167). Ici, je traite des États-Unis contemporains en tant qu’État capitaliste, un type spécifié par son institution sur la base de la séparation de la politique et de l’économie et orienté vers l’organisation de formes sociales et politiques afin que l’accumulation du capital soit garantie (Poulantzas, 1973, p. 355-358, 1978, p. 37-42 ; Jessop, 1990, 2002, p. 187-152 ; Neocleous, 2000, p. 190-194).
Cependant, l’identification d’un type d’État ne permet pas totalement de traiter de tout État donné dans un moment historique spécifique. Les types sont expansifs dans le temps et l’espace (dans un perspective centrée uniquement sur le type, la Hollande du XVIIIe et la Malaisie du XXIe seraient traitées comme des équivalents puisqu’elles appartiennent toutes les deux au type capitaliste) et ne se présentent jamais dans une forme pure. Des restes de types historiques précédents peuvent être préservés et s’avérer nécessaires pour la constitution du type présent. Par ailleurs, des États spécifiques peuvent appartenir à plusieurs types : un État patriarcal peut aussi être capitaliste (par exemple, l’Arabie Saoudite), un État capitaliste peut aussi être racial (par exemple, l’apartheid en Afrique du Sud), etc. (Poulantzas, 1973, p. 108-109 ; Koch et al., 2011, p. 70-73).
Ainsi, quand l’on se penche sur des États spécifiques, la question de leur type passe au second plan et celle de leur forme devient centrale. Le terme de forme-État se réfère ici à l’articulation historique spécifique du rapport entre l’appareil d’État et le pouvoir étatique, entre la structure et la stratégie étatique et entre l’État et la société située « en dehors » de ses institutions (Jessop, 1990, ch. 2 ; Boukalas, 2014, p. 252-261).
En ce qui concerne l’État de type capitaliste, on peut distinguer deux formes : normale (par exemple, la forme libérale-parlementaire ou administrative-sociale) et exceptionnelle (par exemple, le fascisme ou les dictatures militaires). Les formes normales se caractérisent par la séparation de l’État et de la société civile d’une part et la séparation des pouvoirs au sein de l’État d’autre part. Les rapports entre les différentes branches de l’État d’un côté et entre l’État et la société civile de l’autre sont régulés par la loi. La société civile intervient (i.e les forces sociales canalisent leurs demandes) dans l’État à travers des vecteurs institutionnels comme les partis, les syndicats, les lobbys, les ONG et consorts. Cet arrangement rend les formes normales stables, élastiques et capables de s’accommoder de configurations changeantes au sein des forces sociales (Poulantzas, 1973, p. 229-252, p. 296-303).
Par contraste, les formes exceptionnelles rompent, à des degrés différents, la séparation des pouvoirs et concentrent le pouvoir d’État dans les mains de l’exécutif – le militaire, la police et/ou les sommets de l’administration. Elles perturbent la séparation de l’État et de la société civile et (à travers l’incorporation et la répression) soumettent cette dernière au contrôle étatique. Ainsi, les formes exceptionnelles tendent à exercer le pouvoir non seulement au travers du droit mais aussi des décrets exécutifs. Les formes exceptionnelles s’enclenchent quand l’intensité de l’antagonisme social ne peut plus être contenue dans les canaux institutionnels existants, ce qui menace la continuation de l’ordre capitaliste. Elles suppriment l’antagonisme social et par conséquent ne peuvent pas s’accommoder des changements au sein de la configuration des forces entre fractions du capital ou entre ces dernières et les classes subalternes. Cela rend les formes exceptionnelles instables et enclines à la crise. Quand des changements significatifs dans la configuration des forces ont lieu (nécessairement) en dehors de l’État, ce dernier, une fois sa capacité coercitive dépassée par la situation, se brise. Cela génère un moment d’indétermination radicale qui peut menacer la continuation de la domination capitaliste et, par conséquent, le caractère capitaliste de l’État (Poulantzas, 1974, p. 313-329, 1976a).
Même à un niveau aussi général, la discussion autour des types et des formes de l’État conduit à reconfigurer le débat autour de l’exception, principalement en nous orientant vers l’analyse de la norme i.e de ce à quoi l’exception fait exception. Une telle perspective met en avant la pluralité des modes d’organisation du pouvoir politique, chacun étant caractérisé par ses configurations exceptionnelles propres. Il en ressort que l’exception à un mode d’organisation politique (par exemple, la république romaine) a peu en commun avec l’exception à un autre (par exemple, la sécurité intérieure aux États-Unis). De plus, l’insistance sur cette pluralité de constellations de pouvoir résultant d’une combinaison de formes (normales et exceptionnelles) de plusieurs types d’État s’oppose à la réduction des modalités du pouvoir à une dichotomie unique et transhistorique norme/exception.
La question est maintenant de savoir si les États-Unis contemporains constituent une forme-État exceptionnelle-dictatoriale ou normale-démocratique. Il est difficile d’affirmer que les États-Unis sont actuellement une dictature. Les institutions de la démocratie politique maintiennent leur forme et continuent de fonctionner normalement. Il n’y a pas de tentative d’annuler la démocratie mais plutôt de la transformer vers des formes plus oligarchiques. Ce projet est entrepris par les deux partis dominants et résulte d’un consensus politique et non d’un antagonisme aigu. En outre, il n’y pas de faillite des partis et réseaux politiques existants dans leur travail de représentation de la classe dominante (Poulantzas, 1974, p. 122-123 ; Belandis, 2004, p. 71-88).
Pourtant, il semble également difficile de négliger le durcissement autoritaire de l’État dans toutes les sphères d’activités, des pouvoirs juridiques aux représentations politiques, des modalités du maintien de l’ordre à la construction de plateformes citoyennes et de la restructuration institutionnelle à l’écrasement de l’opposition sociale. Ces tendances anti-démocratiques sont persistantes et systématiques.
Il semblerait que nous soyons confrontés à une forme-État hybride. Cela nous amène à traiter de l’étatisme autoritaire.
L’étatisme autoritaire – phase I et II
Le terme étatisme autoritaire (EA) fut élaboré par Nicos Poulantzas à la fin des années 1970 pour rendre compte des changements au sein de l’État providence keynésien visant à contrer sa crise. La tendance générale de cette mutation – et les caractéristiques qui spécifient la forme ES – consiste en un contrôle étatique étendu et intensifié de la vie sociale, combiné à une restriction des libertés démocratiques et, de façon plus générale, de la capacité de la population à influencer le pouvoir d’État. L’étatisme autoritaire est une forme normale de l’État capitaliste, qui, cependant, incorpore, combine et rend permanents plusieurs éléments autoritaires (Poulantzas, 1978, p. 203-204, p. 209).
Dans la première phase (initiée dans les années 1970), l’EA est marqué par un transfert de pouvoir du législatif vers l’exécutif et sa concentration aux plus hauts sommets de ce dernier de sorte que les fonctions de gouvernement se trouvent monopolisées par le président ou le cabinet. Le déclin du législatif est en partie responsable de l’érosion d’un cadre juridique stable, abstrait et universel ainsi que de la prolifération de législations ad- et post hoc et de prérogatives exécutives. Avec le déclin des parlements, l’élaboration de la stratégie et la décision politique ont de plus en lieu au sein d’un réseau de pouvoir parallèle et caché, formé de multiples forums qui transcendent les différentes branches étatiques et contournent les canaux formels de la représentation au sein de l’État. De plus, le rôle des partis politiques est renversé : de plateformes dans laquelle les membres de la société pouvaient suggérer et même imposer des politiques aux instances dirigeantes, ils se transforment en courroies de transmission relayant les décisions des dirigeants auprès des membres de la société. Ce renversement se combine à l’avènement des médias de masse qui deviennent le mécanisme idéologique prédominant. À mesure que les parlements et les partis déclinent, on assiste à une inflation de l’administration qui s’impose comme le site clef de l’élaboration des politiques et de l’antagonisme social. La bureaucratisation de la politique implique un changement de la légitimité étatique qui repose maintenant sur une base bureaucratique, au détriment de notions « d’intérêt général ». Finalement, la coercition se durcit. Le pouvoir policier a maintenant pour objet premier la « mentalité » de l’individu et « la cible du contrôle bascule de l’acte criminel à la situation criminogène, du cas pathologique aux environnements pathogéniques ». La prévention devient ainsi une stratégie du maintien de l’ordre. En outre, un arsenal juridique, martial et administratif se met en place afin d’empêcher les luttes populaires. Il reste « caché » et « en réserve » et n’est mobilisé que contre les manifestations d’antagonisme aiguës (Poulantzas 1976b, p. 321-322, 1978, p. 186, p. 210, p. 217-241 ; voir aussi Jessop 1985, p. 285-287, 2011, p. 48-51).
La période des années 1980 à 1990 est marquée par une contre-attaque capitaliste soutenue, conduite par la finance et se déployant sur la base d’une plateforme idéologico-politique néolibérale. L’autoritarisme étatique reste la plateforme dominante mais il est réajusté de manière significative afin d’accommoder et de promouvoir l’équilibre changeant des forces sociales : il entre dans sa seconde phase. La stratégie principale de l’État se construit maintenant autour de l’idée du « workfare » ((Le terme difficilement traduisible de « workfare » désigne à la fois un ensemble de programmes sociaux et l’idéologie qui les légitime. Kinsky définit le workfare de la manière suivante : « Les programmes de workfare posent comme principe que les bénéficiaires de l’aide sociale doivent travailler pour toucher une allocation mensuelle ». Le workfare « vise à restreindre le nombre d’allocataires de l’aide sociale ou au mieux à conditionner l’accès à celle-ci à un travail dévalorisé, ce qui en fait davantage un programme anti-assistance qu’un aménagement de celle-ci. En outre, le recours au travail des allocataires du workfare a largement participé aux entreprises de flexibilisation et de dégradation des conditions de travail du salariat américain. Loin de chercher à établir des passerelles entre le welfare et le salariat, le workfare attaque simultanément ces deux institutions de l’État social. » (Kinsky, 2009, p.1) (N.D.T).)). Sur la base d’une conceptualisation du travailleur comme coût de production (plutôt que comme une source de revendications), une concentration drastique de la richesse sociale s’effectue via la stagnation des salaires et des retraites, le dépouillement de la protection juridique des employés, la flexibilisation temporaire et à temps partiel, la taxation régressive et la restriction de la protection sociale. Les syndicats sont exclus des forums de la détermination politique, laissant le capital comme seul interlocuteur de l’État. Dans ce contexte, de garant de l’aide sociale et instigateur de la demande générale, l’État se transforme en coordinateur d’une économie privatisée et en exécuteur de la dérégulation.
Par ailleurs, l’échelle nationale cesse de constituer le site prédominant de la stratégie politique et économique. Par conséquent, l’État doit initier, orchestrer, légitimer et répondre aux développements au sein de et par-delà différentes échelles d’activité socio-politique (locale, régionale, nationale et internationale). La coordination de la politique au niveau de et entre ses échelles est prise en charge par des mécanismes de gouvernance publics-privés (le « réseau parallèle ») aux dépens des chaines de commandement hiérarchiques (Jessop, 2002). Le maintien de l’ordre se modifie aussi. De plus en plus déterminé par des corps de gouvernance, sa principale mission devient de sauvegarder le capital présent dans l’espace public (Garland, 2002). Enfin, cette phase est marquée par le retrait du « droit d’État ». Cela signifie la levée des protections légales pour les citoyens et les travailleurs face au workfarisme galopant (Handler, 2004, p. 48-54, p. 58-59, p. 76-78 ; Sommerlad, 2004, 2008) et s’exprime dans la capacité accrue du grand capital transnational à produire sa propre loi, à s’instituer et à réguler ses affaires (Teubner, 1997 ; Scheurman, 1999, 2001 ; Likosky 2003).
La sécurité intérieure – l’étatisme autoritaire, phase III
Au tournant du siècle, cet arrangement entrait en crise. La stratégie néolibérale fut soumise à une pression populaire sévère dans les pays capitalistes du centre (Kelin, 2002, p. 3-40) car le mode d’accumulation fondé sur les investissements directs à l’étranger et les fusions qui étaient le moteur de l’économie tout au long des années 1990 avaient atteint l’épuisement. Les valeurs boursières firent un plongeon et un marché criblé de dettes se dirigeait vers un crash global (Panitch, 2000, p. 27-30 ; Brenner, 2009).
Au cours de cette séquence, aux États-Unis, les secteurs de l’armement et de l’énergie capturèrent la Maison Blanche et cherchèrent à éviter le crash en mettant en place un mode alternatif d’accumulation fondé sur la stagflation. Ce mode, en dehors de la débauche intra-capitale qui le caractérisait, impliquait une attaque frontale sur les intérêts matériels de la population (Nitzan & Bichler, 2009, p. 362-397). Le 11 septembre fut utilisé pour galvaniser le soutien à la fois de la population et des fractions capitalistes rivales en faveur d’un ensemble de politiques sous-tendant la nouvelle stratégie d’accumulation. Afin d’atténuer les effets néfastes de ce mode d’accumulation sur la population, cette dernière fut poussée à une dépendance accrue à la consommation à crédit.
Ce réalignement résulte de mutations de la forme-État et signale une troisième phase de l’EA. Ce nouveau moment consiste en une intensification radicale de l’exclusion politique de la population, combinée à une expansion drastique du contrôle coercitif étatique sur la société. Elle se cristallise autour de plusieurs grandes tendances. Le rythme délibératif et la logique du pouvoir législatif est sévèrement interrompu (en particulier, avec le vote de lois fondamentales comme le Patriot Act de 2001 ou l’EESA de 2008), de sorte qu’il fonctionne souvent comme un comité spécial de l’exécutif. Il en résulte des lois vagues, flexibles et mal définies qui lèvent systématiquement les limitations du pouvoir exécutif à la fois dans le contexte des investigations criminelles et de la politique économique. Le judiciaire perd le contrôle sur la police et cesse de superviser les enquêtes. Le respect des procédures est compromis et la charge de la preuve renversée au profit de la culpabilité par association. La catégorie criminelle au cœur de l’antiterrorisme (le « terrorisme intérieur »), subjective et déterminée par la motivation politique de l’acteur, constitue un élément crucial de ce bouleversement. De plus, on assiste à tournant préventif dans le droit criminel qui cherche à poursuivre le crime avant qu’il n’ait lieu.
Cette évolution laisse non seulement l’État de droit en lambeaux mais entérine aussi la fin de la logique et fonction spécifique du système juridique. Le droit devient un simple instrument utilisé par l’administration dans la poursuite de ces objectifs politiques. En ce sens, le régime pseudo-légal et dominé par l’exécutif de Guantanamo constitue l’acmé du déraillement systématique du système légal. Ce régime semble s’étendre à l’ensemble de la communauté citoyenne (Paye, 2007, ch. 5-6 ; Buckel et al., 2011, p. 164-165 ; Boukalas, 2014, p. 54-57). Le tournant préventif, combiné à un découplement de l’enquête criminelle et de la suspicion, signifie que tout le monde peut être suspecté de crimes non commis.
L’exercice du pouvoir policier se fonde de plus en plus sur le renseignement qui devient total et cherche à envelopper toutes les interactions entre individus (Donohue, 2008, p. 285 ; Treverton, 2011, p. 233-266 ; Boukalas, 2012a, p. 134-167). La surveillance généralisée des communications et de l’usage d’Internet de toute la population n’est pas un « abus » mais une occurrence systémique. Par ailleurs, le mécanisme du pouvoir policier se restructure. Le FBI se transforme d’agence policière en agence de renseignement, pendant que l’appareil de renseignement de plus en plus névralgique est centralisé et passe sous le contrôle direct du président. De manière similaire, à travers la mise en place du département de la sécurité intérieure, le vaste appareil policier sub-national (au niveau des États et local) est inséré dans le réseau du renseignement et mis sous contrôle fédéral (Boukalas, 2014, ch. 8-9).
La nature politique du terrorisme fait de l’activité politique populaire une cible première à la fois pour l’appareil de police national et sub-national. Elle est lourdement surveillée, soumise à un harcèlement sans fin, infiltrée et réprimée. Sa pénalisation s’intensifie constamment et les pouvoirs policiers pour la contrer sont étendus. Après les partis et les syndicats, la rue est maintenant fermée pour la politique populaire.
En outre, on assiste à un changement dans le mode de légitimation du pouvoir d’État qui se fonde maintenant sur l’expertise (supposée) en matière de sécurité. Contrairement à l’expertise économique, partagée dans une certaine mesure par le public et qui peut par conséquent faire l’objet de débats, l’expertise sécuritaire est secrète, faisant de la légitimité une question de foi (Boukalas, 2012a, p. 291-292). Dans ce cadre, le rapport sécurité-population se voit remodelé. Il devient maintenant avant tout coercitif. La conceptualisation de chaque citoyen comme un suspect de crimes non commis inscrit l’ensemble des rapports État/population dans un méta-rapport de police. Cela signifie une importance croissante de la police au sein des mécanismes étatiques ainsi que sa politisation accrue : elle cible la mobilisation politique populaire, elle est contrôlée par les sommets de l’exécutif et elle définit les rapports État/population. Par ailleurs, l’État met en place des plateformes de participation citoyennes à la sécurité intérieure (le programme Citizen Corps) à l’intérieur desquelles le participant est conditionné à travailler au sein de hiérarchies strictes (où il est invariablement situé en bas de l’échelle), sans salaire, assurance ou protections et droits sociaux (Boukalas, 2012b).
Dans cet État de la sécurité intérieure, le workfarisme – l’attaque sur les intérêts matériels de la population – continue sans relâche. Le volontaire de la sécurité intérieure est conditionné en tant que sujet du workfare et le travailleur est conceptualisé comme une menace potentielle, ce qui permet de le dévaluer d’avantage. En effet, la période d’émergence de la sécurité intérieure coïncide avec une vague d’attaques sur les intérêts matériels de la population. Par contraste, le réseau de pouvoir parallèle État-capital (par exemple, « les comités consultatifs ») est légalisé et reconnu comme la structure d’élaboration politique principale. Elle est protégée du contrôle populaire (et même parlementaire). Cependant, la création de tels réseaux reste la prérogative de l’exécutif. Une marge d’action plus grande lui est octroyée pour protéger certains capitaux de poursuite criminelles à travers leur désignation d’ « infrastructure critique » et pour distribuer des contrats et des fonds de sauvetage comme il l’entend aux entités privés qu’il sélectionne (Loi sur la sécurité intérieure de 2003 ; 2008 EESA). Il semble que la vie nue soit merveilleuse pour le capital.
Nous assistons non seulement à une résurgence de l’étatisme à l’ancienne qui absorbe la machinerie de gouvernement mais, en outre, l’échelle nationale redevient prédominante. Les stratégies sécuritaires et économiques se mettent en place avec l’échelle nationale pour horizon ultime même si elles impliquent une activité au-delà. Prise dans son ensemble, la sécurité intérieure constitue une reconfiguration de la forme-État qui autorise une action exécutive ultra rapide et arbitraire à la fois en matière économique et sécuritaire et qui établit une méga machine pour prévenir, réprimer et écraser l’antagonisme social. La sécurité intérieure est le blindage de l’État capitaliste face à la crise actuelle et à venir. Elle garantit une gestion sécurisée de la crise tout en exacerbant les conditions qui la causent : l’exclusion politique et la dépossession matérielle de la société.
Par contraste, le capital dominant fait quasiment de l’État son affaire privé. En outre, la configuration présente du mécanisme étatique semble parfaitement capable de réguler l’antagonisme intra-capital. Ceci se manifesta dans le transfert fluide de la domination du secteur des armements et de l’énergie vers celui la finance depuis 2008. Ce basculement impliquait un changement dans la prédominance des mécanismes étatiques passant du département de la Justice et du Pentagone au Trésor et à la Fed. Il semblerait par conséquent que la nature hybride de l’EA prenne maintenant la forme d’un double édifice politique : un État-démocratique normal pour le capital dominant et un État exceptionnel-dictatorial pour le reste. En prenant en considération la signification sociale des formes exceptionnelles, nous voyons que le déferlement du « pouvoir souverain » est aussi le signe du caractère limitée et instable de l’hégémonie sociale.
Conclusion
À partir de deux trajectoires différentes, notre aperçu de la sécurité intérieure semble arriver à deux conclusions similaires : un état d’exception permanent pour Agamben et un double édifice politique gérant la crise permanente (actuelle et anticipée) du point de vue de l’ASR. Cette convergence est frappante et implique une compréhension similaire de l’actualité du pouvoir politique. Pourtant, mis à part le fait de partager un intérêt commun et marqué pour la configuration actuelle du pouvoir, cette similarité est trompeuse. Pour commencer, il n’existe pas de notion du pouvoir « contemporain » chez Agamben. Le pouvoir est essentiellement toujours le même – un effet du rapport structurel entre la vie nue et le souverain. Ce qui varie est le degré de révélation du pouvoir, et celui-ci atteindrait dorénavant des proportions apocalyptiques. Au contraire, l’ASR prend soin de distinguer les formes de pouvoir dans leur temporalité respective, comme nous l’avons vu à travers notre examen des types, formes et phases de l’État. Agamben cherche à définir la nature éternelle du pouvoir tandis que l’ASR cherche à comprendre les conjonctures historiques. Là se situe la différence clef entre les deux perspectives.
La réintroduction de l’histoire signifie aussi le retour du social comme champ analytique. Alors que le concept du social brille spectaculairement par son absence chez Agamben, il constitue le fondement épistémologique de l’ASR. Ainsi le souverain se dissout-il ici dans l’État et le droit conçus comme des rapports sociaux créés par des dynamiques sociales. Par ailleurs, ré-instituer l’histoire et la société en objets d’analyse implique le retour de la politique et de l’antagonisme social. Oublié dans la structure du pouvoir souverain et de la vie nue, l’antagonisme social constitue la dynamique clef que l’ASR cherche à capturer. Cela se manifeste dans le basculement analytique de l’ « exception » vers la crise appréhendée en tant que dynamique sociale et dans l’exposition des forces sociales (le capital dominant et ses secteurs, les mouvements populaires) comme des acteurs clefs dans la reconfiguration du « pouvoir ». Il en ressort que l’EA constitue un signe de faiblesse du présent ordre social.
Finalement, alors que l’approche agambenienne semble condamnée à ricocher d’un niveau d’abstraction très élevé au particularisme, dégageant des correspondances éparses entre l’essence éternelle du pouvoir et certaines micro-pratiques et artefacts, l’ASR nous invite à explorer l’espace entre l’abstraction élevée et la particularité. En se concentrant sur le contexte des dynamiques socio-historiques, elle se montre capable de déchiffrer la convergence de « lignes de force générales », exprimées (dans la mesure où elles sont discernables) dans les orientations stratégiques du pouvoir d’État. Elle permet ainsi une compréhension riche des manières dont les motivations, les pratiques, les stratégies et les significations se combinent afin de produire des conjonctures spécifiques.
On pourrait certes défendre l’argument selon lequel l’étatisme autoritaire est une instanciation de l’état d’exception qui n’est pas contraire à celui-ci mais l’affirme plutôt. Mais, dans la mesure où nous sommes confrontés à des phénomènes sociaux actuels et non pas aux révélations des arcanes de la divinité du pouvoir, cela importe-t-il vraiment ? L’approche stratégique-relationnelle place la société et ses rapports dynamiques au cœur de l’analyse plutôt que dans le non-lieu entre la vie nue et Béhémoth. Cela devrait suffire à distinguer la théorie sociale de la théologie politique.
Article initialement paru sous le titre « No exceptions: authoritarian statism. Agamben, Poulantzas and homeland security » dans Critical Studies on Terrorism, 7 ; 1, p. 112-130.
Traduit de l’anglais par Memphis Krickeberg et publié avec l’aimable autorisation de l’auteur et de Taylor & Francis Ltd.
Bibliographie
Ackerman B., Before the Next Attack, New Haven, CT, Yale University Press, 2006.
ACLU (American Civil Liberties Union), « Indefinite Detention, Endless Worldwide War and the 2012 National Defense Authorisation Act », 2012.
Agamben G., Homo Sacer : Sovereign Power and Bare Life, Stanford, CA, Stanford University Press, 1998.
Agamben G., State of Exception, Chicago, IL, Chicago University Press, 2005.
Agamben G., « Philosophical Archaeology », Law Critique 20, 2009, p. 211–231.
Agamben G., The Kingdom and the Glory : For a Theological Genealogy of Economy and Government, Stanford, CA, Stanford University Press, 2011.
Belandis D., In Search of the Internal Enemy [en grec ], Athènes, Proskinio, 2004.
Benjamin W., « Critique of Violence » in Reflections : Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, édité par P. Demetz, New York, Random House. [1921] 1986.
Boukalas C., « Government by Experts : Counterterrorism Intelligence and Democratic Retreat », Critical Studies on Terrorism 5 (2), 2012a, p. 277–296.
Boukalas C., Homeland Security, Its Law and Its State – A Design of Power for the 21st Century, Abingdon, Routledge, 2012.
Boukalas C., « US Citizen Corps : Pastoral Citizenship and Authoritarian Statism » Situations, 4 (2), 2012b, p.117–140.
Brassett, V. & N. Vaughan-Williams, « Crisis in Governance : Sub-Prime, the Traumatic Event, and Bare Life », Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation, University of Warwick (Working Papers No. 268), 2012a.
Brenner R., « What Is Good for Goldman Sachs Is Good for America – The Origins of the Current Crisis », prologue de la traduction espagnole de R. Brenner, Economic of Global Turbulence. Londres, Verso, 2006.
Buckel S., « The Juridical Condensation of Relations of Forces : Nicos Poulantzas and Law » in Reading Poulantzas, édité par A. Gallas, L. Bretthauer, J. Kannankulam, et I. Stutzle, Pontypool, Merlin Press, 2011.
Bunyan T., « The Exceptional and the Draconian Become the Norm » Statewatch Report, mars 2005.
Callinicos, A., The New Mandarins of American Power : The Bush Administration’s Plans for the World, Cambridge, Polity Press, 2003.
Castoriadis C., « The Greek Polis and the Creation of Democracy » in The Castoriadis Reader, édité par D. A. Curtis. Oxford, Blackwell, 1983.
Colatrella S., « Nothing Exceptional : Against Agamben », Journal for Critical Education Policy Studies 9 (1), 2011, p. 97–125.
Diken B. et C. B. Lausten, The Culture of Exception : Sociology Facing the Camp, Abington, Routledge, 2005.
Donohue L. K., The Cost of Counterterrorism, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
Ericson R.V., Crime in an Insecure World. Cambridge, Polity Press, 2007.
Fitzpatrick P., « Bare Sovereignty : Homo Sacer and the Insistence of Law » in Politics, Metaphysics and Death – Essays on Agamben’s Homo Sacer, édité par A. Norris. Durham, NC, Duke University Press, 2005.
Garland D., The Culture of Control, Oxford, Oxford University Press, 2002.
Gross O., « Chaos and Rules : Should Responses to Violent Crises Always Be Constitutional ? », The Yale Law Journal 112, 2003, p. 1011-1134.
Handler J. F., Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
Hardt M. & A. Negri, Multitude : War and Democracy in the Age of Empire, New York, Penguin, 2004.
Huysmans, J., « The Jargon of Exception – On Schmitt, Agamben and the Absence of Political Society », International Political Sociology 2, 2008.
Jessop B., Nicos Poulantzas : Marxist Theory and Political Strategy, Londres, Macmillan, 1985.
Jessop B, State Theory, Cambridge, Polity Press, 1990.
Jessop B., The Future of the Capitalist State, Cambridge, Polity Press, 2002.
Jessop B., State Power : A Strategic-Relational Approach, Cambridge, Polity Press, 2008.
Jessop B., « Poulantzas’s State, Power, Socialism as a Modern Classic » in Reading Poulantzas, édité par A. Gallas, L. Bretthauer, J. Kannankulam et I. Stutzle, Pontypool, Merlin Press, 2011.
Johns F., « Guantanamo Bay and the Annihilation of the Exception », European Journal of International Law, 16 (4), 2005, p. 613–635.
Kelin N., Fences and Windows, Londres, HarperCollins, 2002.
Koch M., « Poulantzas’s Class Analysis » in Reading Poulantzas, édité par A. Gallas, L. Bretthauer, J. Kannankulam et I. Stutzle, Pontypool, Merlin Press, 2011.
Kondylis P., « Épilogue » [en grec] in Political Theology, édité par C. Schmitt, Athènes, Leviathan, 1994.
Krinsky John, « Le workfare. Néolibéralisme et contrats de travail dans le secteur public aux États-Unis », Les notes de l’Institut Européen du Salariat, n°8, 2009.
Laclau E., « Bare Life or Social Indeterminacy ? » in Giorgio Agamben : Sovereignty and Life, édité par M. Calarco et S. DeCaroli, Stanford, CA, Stanford University Press, 2007.
Likosky M. B., « Compound Corporations : The Public Law Foundations of Lex Mercatoria », Non-State Actors and International Law 3, p. 251–281, 2003.
Mattelart A., The Globalisation of Surveillance, Cambridge, Polity Press, 2010.
Michael-Matsas S., « Capitalist Decline, Nation State, and State of Emergency », Critique 33, (1), 2005, p. 49–59.
Mills C., The Philosophy of Agamben, Stocksfield, Acumen, 2008.
Murray A., Giorgio Agamben. Abington, Routledge, 2010.
Neal A. W, Exceptionalism and the Politics of Counter-Terrorism, Abington, Routledge, 2010.
Negri, A., « Giorgio Agamben : The Discreet Taste of the Dialectic », in Giorgio Agamben : Sovereignty and Life, édité par M. Calarco and S. DeCaroli, Stanford, CA, Stanford University Press, 2007.
Neocleous M., The Fabrication of Social Order : A Critical Theory of Police Power, Londres, Pluto Press, 2010.
Neocleous M., « The Problem with Normality : Taking Exception to “Permanent Emergency” » Alternatives : Global, Local, Political 31, 2006, p. 191–213.
Nitzan J. & S. Bichler, Capital as Power, Abington, Routledge, 2009.
Norris A. 2005, « The Exemplary Exception : Philosophical and Political Decisions in Giorgio Agamben’s Homo Sacer » in Politics, Metaphysics and Death – Essays on Agamben’s Homo Sacer édité par A. Norris, Durham, NC, Duke University Press, 2005.
Panitch L., « The New Imperial State », New Left Review 2, 2000, p. 5–20.
Papacharalambous C., « God, the Sovereign, and the Law : The Resurgence of Carl Schmitt » [en grec] in On the Three Kinds of Legal Thought, édité par C. Schmitt. Athènes, Papazisis, 2009.
Paye J.-C., Global War on Liberty, New York, Telos, 2007.
Poulantzas N., Political Power and Social Classes, Londres, NLB, 1973.
Poulantzas N., Fascism and Dictatorship, Londres, NLB, 1974.
Poulantzas N. 1976a. « The Political Crisis and the Crisis of the State », in The Poulantzas Reader, édité par J. Martin. Londres, Verso , 2008.
Poulantzas N., The Crisis of Dictatorships, Londres, NLB, 1976b.
Poulantzas N., State, Power, Socialism, Londres, NLB, 1978.
Rasch W., « From Sovereign Ban to Banning Sovereignty », in Giorgio Agamben : Sovereignty and Life, édité par M. Calarco et S. DeCaroli, Stanford, CA, Stanford University Press, 2007.
Roach K, The 9/11 Effect, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
Samples J, « Lawless Policy – TARP as Congressional Failure », Policy Analysis No. 660. Washington, DC, CATO Institute, 2010.
Scheuerman W. E, éEconomic Globalization and the Rule of Law », Constellations 6 (1), 1999, p. 3–25.
Scheuerman W. E., « The Economic State of Emergency », Cardozo Law Review 21, 2000, p. 1890.
Scheuerman W. E., « Reflexive Law and the Challenges of Globalization », Journal of Political Philosophy, 9 (1), 2001, p.81–102.
Scheuerman W. E., « Rethinking Crisis Government », Constellations 9 (4), 2002, p. 492–505.
Scheuerman W. E., « Survey Article : Emergency Powers and the Rule of Law After 9/11 », Journal of Political Philosophy 14 (1), 2006, p. 61–84.
Schmitt C., Political Theology : Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Cambridge, MA, MIT Press, [1985] 1922.
Schmitt C., The Crisis of Parliamentary Democracy, Cambridge, MA, MIT Press, [1923] 1988.
Schmitt C., The Concept of the Political, Chicago, IL, Chicago University Press, [1932] 1996.
Schmitt C., Legality and Legitimacy, Durham, NC, Duke University Press, [1932] 2004.
Schmitt C., Theory of the Partisan, New York, Telos, [1963] 2007.
Schurman F. « Emergency Powers – The New Paradigm in Democratic America », New California Media, 2002.
Seymour D., « The Purgatory of the Camp : Political Emancipation and the Emancipation of the Political », in Giorgio Agamben : Legal, Political, and Philosophical Perspectives, édité par T. Frost, Abington, Routledge, 2013.
Sommerlad H., « Some Reflections on the Relationship between Citizenship, Access to Justice, and the Reform of Legal Aid », Journal of Law and Society 31 (3), 2004, p.345–368.
Sommerlad H., « Reflections on the Reconfiguration of Access to Justice », International Journal of the Legal Profession, 13 (3), 2008.
Teubner G., « Global Bukowina : Legal Pluralism in the World Society » in Global Law Without a State, édité par G. Teubner, Aldershot, Dartmouth, 1997.
Treverton G., Intelligence for an Age of Terror, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
Vaughan-Williams N., « The Generalised Bio-Political Border ? Re-Conceptualising the Limits of Sovereign Power », Review of International Studies 35, 2009.
Whyte D., « The Neoliberal State of Exception in Occupied Iraq » in State Crime in the Global Age, édité par W. L. Chambliss, R. Michalowski et R.C. Kramer, Portland, Willan, 2010.
Whyte, J.N., « The New Normal », Signature, 2005.