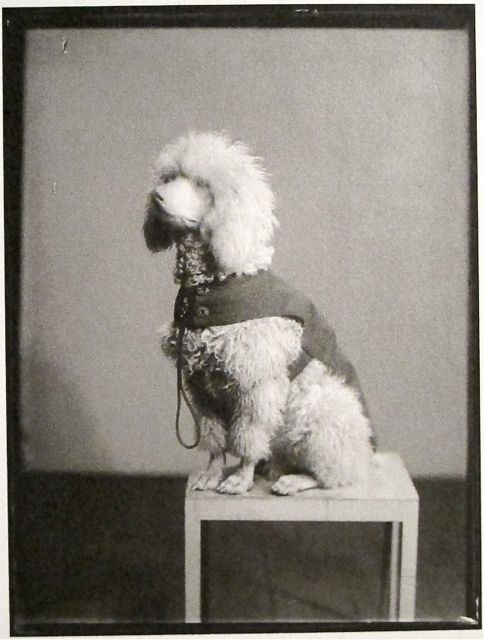Comment définiriez-vous le modernisme ?
Je définis le modernisme comme une période de l’histoire culturelle et artistique caractérisée par le développement économique inégal et combiné du capitalisme industriel. Historiquement, la culture moderniste a émergé à travers l’imbrication de quatre modes uniques et apparemment anachroniques de socialité : une société civile bourgeoise dominante, une aristocratie résiduelle, des mondes précapitalistes ou « primitifs » et une puissante alternative socialiste. Mais le modernisme ne reflète pas simplement ce moment de l’histoire, ces conditions matérielles. Les œuvres d’art que nous désignons désormais comme « modernistes » sont plutôt celles qui embrassent le potentiel novateur de la modernisation tout en résistant activement à l’entrée dans un marché mondial unique. Pour cette raison, le modernisme se trouve attiré vers ces quatre modes de socialité dans leurs interrelations contradictoires – et, surtout après 1917, vers l’État socialiste révolutionnaire en Russie. À la réflexion, ma compréhension du modernisme suit celle d’Adorno : « L’art est moderne grâce à la mimesis de ce qui est durci et aliéné. C’est ainsi, et non par la dénégation de la réalité muette, qu’il devient éloquent ». Une œuvre d’art qui refuse de reconnaître sa place dans l’histoire ou son rapport au capitalisme est condamnée à être inoffensive par sa nostalgie ou son idéalisme ; le modernisme connaît sa place dans l’histoire, mais il refuse fondamentalement de s’identifier à la modernité capitaliste, c’est justement la raison pour laquelle le modernisme trouve le communisme si séduisant. « C’est, écrit Adorno, la conscience authentique d’une époque où la possibilité réelle de l’utopie – le fait que d’après le stade des forces productives, la terre pourrait être ici et maintenant le paradis – se conjugue au paroxysme avec la possibilité de la catastrophe totale ». Émergeant de cette convergence, le modernisme se trouve porté vers l’actualité du communisme, adversaire politique et économique majeur du capitalisme : l’alternative paradisiaque à une catastrophe en cours. Comme l’écrit l’historien de l’art T.J. Clark, le modernisme « sentait que le socialisme était son ombre – qu’il était également engagé dans une lutte désespérée et probablement futile, pour imaginer la modernité autrement ».
Dans Red Modernism, vous vous intéressez particulièrement à trois auteurs étasuniens : Ezra Pound, William Carlos Williams et Louis Zukofsky. Dans quelle mesure la poésie étasunienne faisait-elle écho au communisme tel qu’il se développait en Russie ? Par quels biais le communisme russe a-t-il voyagé jusqu’à atteindre certaines productions littéraires aux États-Unis ?
Je m’intéresse à ces trois auteurs, car ils ont tous eu une carrière de poète exceptionnellement longue, chevauchant collectivement la période du modernisme et de la littérature, ainsi que les années préguerre froide du socialisme d’État en URSS. Par ailleurs, et pour des raisons irréductiblement problématiques, ces trois figures sont devenues des synonymes du modernisme en poésie, d’une manière qui prête une valeur heuristique et polémique à leur position privilégiée en tant que cas d’étude. Je m’intéresse donc à ces poètes en raison de l’énorme influence que l’on considère qu’ils ont exercée sur le développement de la poésie moderniste en Amérique et en raison de la connaissance critique que l’on a d’eux, qui a été permis par cette influence. Mais, plutôt que d’endosser implicitement le mythe d’un modernisme monumental (sans même parler de son côté masculin, de classe moyenne et blanc), mon intention est de réexaminer certains épisodes déjà familiers du développement de la poésie moderniste, précisément en raison de cette familiarité. Le but de mon focus sur Pound, Williams et Zukofsky est de démontrer la présence active du communisme dans des poèmes dans lesquels, malgré l’attention critique dont ils ont déjà bénéficié, celle-ci a souvent été négligée ou minimisée. Le fait qu’il y ait un consensus assez important sur ce qui fait de chacun de ces poètes des modernistes a permis de maximiser les retombées critiques d’un argument qui entend démontrer, à travers ces œuvres en particulier, le rôle transformateur du communisme au sein du modernisme.
Plus généralement, la poésie aux États-Unis était et reste profondément sensible au communisme. Il y a eu certains très bons travaux – par des chercheurs comme Michael Denning, Cary Nelson, Alan Wald et d’autres – qui montrent dans quelle mesure l’histoire littéraire nord-américaine a été façonnée par le communisme, le socialisme et d’autres imaginaires anticapitalistes. Ce n’est pas non plus propre à la période du modernisme : Walt Whitman comme Herman Melville ont, par exemple, écrit des poèmes sur la Commune de Paris de 1871, et nombre des poètes les plus intéressants à l’heure actuelle se retrouvent désormais autour de la maison d’édition radicale Commune Editions. Cette sensibilité n’est pas propre aux poètes s’identifiant positivement au communisme ni à ceux qui pourraient y être sympathiques. Ezra Pound, le fasciste, est l’exemple même d’un poète politiquement antipathique, mais s’engageant positivement avec le communisme. Au-delà de ce seul cas, comme je l’écris dans le premier chapitre du livre, le communisme apparaît ailleurs, catalysant la transformation esthétique, quel que soit ce en quoi les poètes eux-mêmes croyaient. Dans ce contexte, j’écris sur Wallace Stevens, Gertrude Stein et E.E. Cumings, mais mon exemple favori est l’ultraconservateur T.S. Eliot. Le célèbre poème d’Eliot de 1922, La Terre Vaine (The Waste Land), comporte une note de bas de page faisant allusion, via un anachronisme littéraire, à la Révolution russe de 1917. Bien que ce serait aller trop loin que de laisser entendre que le communisme a contribué à façonner le sens de la géographie européenne du poème, c’est exactement ce qu’a suggéré son auteur – un banquier traditionaliste – cinq ans plus tard. « La Révolution russe a rendu l’Homme conscient de la position de l’Europe occidentale », écrit Eliot en 1927. « Et cette conscience semble donner naissance à une nouvelle conscience européenne. C’est un signe porteur d’espoir ».
Comment le communisme russe à la soviétique a-t-il voyagé et s’est-il infiltré dans la production littéraire des États-Unis ? Bien qu’il existe nombre de médiations, qui sont fonction du contexte, entre des moments particuliers de l’évolution de la poésie moderniste et divers types d’enjeux communistes, je souligne dans le livre trois médiations contextuelles ou fondamentales : la première de ces médiations est la classe ouvrière (labor) et spécifiquement ses formations organisées et militantes, au sein desquelles le communisme a trouvé un allié de taille ; la seconde médiation est l’État socialiste lui-même, un véritable espace activement impliqué dans l’établissement du communisme international ; la troisième médiation est plus complexe et est liée à la technologie. J’affirme que les poètes modernistes voulaient explorer et exploiter les progrès technologiques permis par le capitalisme, tout en cherchant à éviter la subsomption capitaliste. Cette position contradictoire est l’une de celles dont les poètes reconnaissaient qu’elle était analogue au communisme – un mode de production utopique qui, par une ironie de l’histoire mondiale, n’est devenu une réalité probable qu’une fois que les forces productives du capitalisme avaient évolué à tel point qu’elles menaçaient l’histoire d’une catastrophe totale de subsomption absolue. Voyageant par des voies établies par ces trois médiations – reposant sur les ouvriers, la géopolitique et la technologie – diverses formes de communisme ont traversé les frontières de la Russie révolutionnaire pour imprégner la source des productions littéraires modernistes aux États-Unis. Là-bas, le communisme a trouvé une destination dans la culture d’avant-garde et artistique plus globalement, par des journaux, des magazines et des manifestes, et a trouvé une nouvelle expression dans la substance esthétique de la littérature.
Dans The Zukofsky Era, Ruth Jennison affirme qu’il y a eu une rupture formelle entre la première génération moderniste poundienne et la seconde génération moderniste des objectivistes. Jennison s’intéresse particulièrement à la « critique poétique de la forme marchandise » de Zukofsky – la seconde génération ayant une « trajectoire davantage matérialiste dans la poésie américaine ». Ruth Jennison revient notamment sur un échange épistolaire entre Pound et Zukofsky, de 1935, structuré autour de la nature de la marchandise. Pensez-vous également qu’une telle rupture existait entre la seconde génération d’objectivistes et l’ère Pound ?
Ruth a entièrement raison, et son livre n’a pas d’équivalent lorsqu’il s’agit de saisir l’engagement politique et poétique du modernisme de la seconde génération. Il y a, en effet, une rupture entre Pound et Zukofsky qui va plus loin qu’une question d’allégeance politique ou de conflit œdipien, avec Pound le fasciste affrontant son jeune protégé, Zukofsky, le communiste. Cette rupture provient, en effet, de questions économiques et notamment de la compréhension différente qu’avaient les deux poètes du rapport entre travail et valeur. Zukosky s’en tient à la perspective marxiste selon laquelle, sous le capitalisme, le travail est réduit à une marchandise susceptible d’être vendue, dont le caractère particulier réside dans sa capacité de valorisation – créer ou ajouter de la valeur. Pound, au contraire, embrasse le positivisme typique de l’économie bourgeoise, selon laquelle le travail ne peut être une marchandise en ce qu’il n’est pas un objet au sens le plus littéral. Voilà ce qu’écrit Pound dans cet échange :
Bougre d’imbécile / n’avez-vous pas assez de bon sens pour UTILISER UN MOT ayant une signification et pour laisser la signification adhérer à ce mot. Une marchandise est une chose matérielle ou une substance / elle a une certaine durabilité. Si vous ne dissociez pas les idées, et ne gardez pas UN TERME pour UNE catégorie de choses, vous serez toujours dans une affreuse confusion. Le travail doit se transmuer en matériau, il doit y injecter de la valeur, ou bien le rendre utilisable.
Au-delà de la reconnaissance du fait que le travail est une force créatrice, qu’il valorise en dernier ressort des matériaux bruts, Pound entend garder, conceptuellement, une distinction entre le travail et la marchandise. Ce qu’oublie cette distinction, au grand désarroi de Zukofsky, c’est que lorsqu’il s’est fait enrôler par la rémunération salariale, le travail a été acheté par les capitalistes. Marx l’explique ainsi dans le Capital :
Il faudrait que l’homme aux écus eût l’heureuse chance de découvrir au milieu de la circulation, sur le marché même, une marchandise dont la valeur usuelle possédât la vertu particulière d’être source de valeur échangeable, de sorte que la consommer serait réaliser du travail et par conséquent, créer de la valeur.
En d’autres termes, le travail de l’ouvrier est acheté par d’autres figures – la bourgeoisie ou les capitalistes – de manière à ce que l’ouvrier puisse transférer la valeur dans une autre marchandise, qui ne devient profit que lorsque le capitaliste vend celle-ci pour un plus haut prix que les coûts combinés du travail acheté et des matériaux bruts. Cette socialité est ce que les marxistes nomment « rapport de valeur ». Pound maintient, à l’inverse, une vision simpliste et contre-factuelle de la vie sociale, et des problèmes sociaux, sous le capitalisme. Zukofsky avait compris. Pound non. Zukofsky était marxiste. Pound ne l’était pas.
Dans le chapitre sur Pound, vous écrivez que son fascisme résultait de son anticapitalisme, un point qui « pour un sujet différent ou dans un contexte différent aurait pu se développer en communisme ». Pourriez-vous expliquer ce point ? Cela signifie-t-il que la poésie de Pound, même durant sa période fasciste, puisse être intéressante y compris pour des marxistes ?
On peut décrire le fascisme de Pound comme l’occultation de la possibilité communiste, la corruption idéologique du potentiel révolutionnaire. Il est de notoriété publique que, dans les années 1930, la position politique de Pound a viré vers l’extrême-droite, mais on connaît moins la manière dont il s’est retrouvé là. Pendant les années 1910, il lisait Marx et s’y référait lorsqu’il écrivait pour un magazine socialiste, The New Age. Dans les années 1920, il chantait l’épopée de Lénine, Trotsky et des bolchéviques. « Il est désormais temps d’étudier Lénine qualitativement et analytiquement », écrivait-il en 1928. « Il n’a jamais écrit une seule phrase qui ait un quelconque intérêt en elle-même, mais il a quasiment créé un nouveau médium, une sorte d’expression à mi-chemin entre l’écriture et l’action ». Pendant les années 1930, et malgré une hostilité grandissante dirigée contre l’État socialiste, il est resté pacifiste. Dans l’un de ces poèmes, par exemple, il compare Staline et Mussolini comme étant les deux dirigeants mondiaux à avoir (il s’agit, bien évidemment, d’une fiction) pris leurs distances et celles de leurs États respectifs d’avec la guerre impérialiste et le complexe capitaliste militaro-industriel. En mettant tout cela ensemble, on trouve une profonde compréhension de l’anticapitalisme.
Mais cela a dégénéré. En raison de son incapacité à saisir le rapport de valeur, il a commencé à s’investir dans des modes alternatifs de monnaies et de recherche du pouvoir, dont il pensait qu’ils avaient été mis en place dans l’État fasciste, en Italie. En bref, Pound croyait à tort que Mussolini avait réformé sinon aboli le capitalisme en Italie, en mettant en place une nouvelle forme de monétarisme. « Ces choses étant ainsi », écrivait-il en 1935 en pensant au capitalisme d’État en URSS, « est-ce à supposer que Mussolini a régénéré l’Italie, simplement afin de la réinfecter avec la peste noire du système monétaire capitaliste ? » Selon Pound, les fascistes avaient réussi sur ce par quoi les socialistes auraient dû commencer, à savoir éradiquer le capitalisme non pas en tant que mode de production, mais la « peste noire » de son « système monétaire », et l’Italie n’allait pas faire les mêmes erreurs que la Russie, en permettant au capitalisme de se réinsérer dans un mode de production créé en opposition à celui-ci. C’est ce qui a fait de Pound un fasciste : l’idée erronée selon laquelle le fascisme avait fait plus que le socialisme pour lutter contre le capitalisme et ses déprédations.
Et pourtant, sa poésie ultérieure, la poésie de la période fasciste, devrait rester intéressante pour les marxistes pour un certain nombre de raisons, y compris le fait qu’elle sert de leçon de choses quant à la perversion idéologique et à l’importance de la pensée politique du matérialisme dialectique. En effet, le vice critique de Pound est typique du fascisme et trouve une certaine résonance aujourd’hui dans l’attrait de l’alt-right néonazie pour le bitcoin. Un élément plus intéressant de la poésie de la période fasciste, toutefois, est qu’elle semble trahir le poète. La conséquence d’un intérêt pour le socialisme et le communisme tout au long de sa vie est que sa poésie garde des tendances révolutionnaires malgré les proclamations de l’auteur. Marx, Lénine et même Staline y jouent des rôles talismaniques, en tant que balises pour l’intelligence littéraire au sein de l’éclipse de l’imbécillité fasciste. Dans le livre, je vais jusqu’à affirmer que la présence spectrale du communisme est ce qui a sauvé la poésie tardive de Pound de ses pires tendances – que le communisme, tel qu’il s’est manifesté en URSS, énonce la force qui brosse satiriquement la tendance fasciste de Pound contre elle-même, générant une forme contradictoire incapable de réconcilier son ambition politique avec son contenu historique. Les marxistes devraient apprécier le pouvoir absolument transformateur de l’élan communiste qui retourne une poésie fasciste contre elle-même.
En quel sens le concept d’« imagination » de William Carlos Williams est-il lié au contexte de la Révolution russe ?
Le contexte littéraire le plus évident pour un concept poétique tel que celui d’« imagination » est, surtout dans la manière dont l’utilise William Carlos Williams, certainement celui du romantisme anglais du XIXe siècle. Dans la célèbre phrase de Coleridge, par exemple, l’imagination est « a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am ». Ce qui est plus pertinent dans l’usage du concept par Williams est que, depuis le milieu du XIXe siècle, l’imagination a gagné en importance dans toute une lignée radicalement démocratique de romantiques américains. Emerson, dans un cours de 1841, a dit: « America is a poem in our eyes; its ample geography dazzles the imagination, and it will not wait long for metres ». Néanmoins, c’est à Whitman que Williams attribue sa compréhension du concept. Williams écrit : « Whitman’s proposals are of the same piece with the modern trend toward imaginative understanding of life. The largeness which he interprets as his identity with the least and the greatest about him, his ‘’democracy’’ represents the vigor of his imaginative life ». Mon argument est que, en plus de ces antécédents anglais et américains, il existe une autre source pour ce concept, qui est irrévocablement communiste.
Pour Marx, l’imagination est une caractéristique déterminante d’un travail humain qui, précisément, n’est pas aliéné. « Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte », peut-on lire dans sa célèbre formule : « c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. » Et après 1917, ce type d’imagination pratique se réalisant par le travail est devenu un concept encore plus important dans la pensée communiste. Selon Trotsky, l’imagination était l’une des principales vertus de Lénine. « La force de Lénine était », affirmait-il, « dans une immense mesure, celle de l’imagination réaliste. » Williams semblait connaître, ou du moins ressentir, ce courant communiste concernant des concepts esthétiques potentiellement raréfiés ; ainsi lorsqu’il s’est mis à écrire sur l’imagination, il s’est référé à la Révolution russe. « To the social, energized class », écrit-il, « ebullient now in Russia the particles adhere because of the force of the imagination energizing them. » Pour Williams, l’imagination désigne, fondamentalement, la force de la révolution – une énergie sublime qui, dans sa poésie, sert de catalyseur au collectivisme prolétarien.
Votre chapitre sur Zukofsky s’intitule « Louis Zukofsky : communisme cosmique, socialisme cybernétique » : pourriez-vous expliquer ce titre ?
Des trois poètes auxquels je m’intéresse, Zukofsky est celui qui est le plus immédiatement identifiable au communisme : contrairement à Pound et à Williams, il s’est réellement engagé pour le communisme, mais à sa manière. Bien qu’il existe de nombreux écrits sur Zukofsky et le communisme – le meilleur étant sans doute le livre de Ruth Jennison, que vous avez mentionné dans une précédente question – je voulais éviter de répéter ce que l’on savait déjà. Je souhaitais également souligner ce que j’ai toujours trouvé le plus étrange et le plus fascinant dans la poésie de Zukofsky : non pas son appréhension de l’histoire ou son contenu politique, qui sont parfaitement lisibles, mais l’engagement esthétique dans ce que je décris comme de la science-fiction. La poésie de Zukofsky a beaucoup d’affection pour l’exploration interstellaire et la technologie cybernétique, qui sont souvent l’affaire des romans de gare ou des comics, mais qui, comme j’essaye de le démontrer, sont partie intégrante de la poésie communiste.
Zukofsky a une perception proprement cosmique du communisme : il décrit l’utopisme communiste comme un phénomène réellement extra-terrestre, l’exploration de nouvelles galaxies, la colonisation de nouvelles planètes. Et le projet socialiste est, pour Zukofsky, un projet cybernétique : combinant l’humanité aux machines de manière à produire de nouvelles formes de vie. Rassemblant ces deux branches de la science-fiction dans ce qui est sans doute l’une des plus importantes images de la poésie moderniste, Zukofsky décrit Lénine comme un dragon Dieu-machine, descendant d’une autre planète :
He slays the dragon, with golden arms
Born of the moon and stars,
When the world was made he helped, too
Comrades of Uzbekistan
Ce type de pensée, combinant la science-fiction à l’actualité politique, n’est pas propre à Zukofsky. En fait, cela vient de l’État socialiste. Lénine a nommé son célèbre pamphlet d’après le roman utopique de Nikolai Tchhernychevski datant de 1863, Que faire ?, dont le récit amène une conception embryonnaire d’engagement politique pour la clandestinité socialiste russe. L’un des adversaires politiques de Lénine, Alexandre Bogdanov, a écrit un célèbre roman L’étoile rouge, qui raconte l’histoire d’un scientifique-révolutionnaire qui voyage jusqu’à la planète Mars pour expérimenter la version martienne du socialisme. Le thème du socialisme intergalactique se retrouvait également dans les arts visuels, souvent motivés par le cosmologiste soviétique Constantin Tsiolkovski. Lénine lui-même fait part d’une ambition utopique à H.G.Wells en 1920 : « Les idées humaines », lui a-t-il dit, « se basent sur l’échelle de la planète sur laquelle nous vivons. Elles se basent sur la supposition que les potentialités techniques telles qu’elles se développent, ne dépasseront jamais la ‘’limite terrestre’’. »
Dans quelle mesure la situation en Russie après la Seconde Guerre mondiale représentait-elle un « récit particulier dans le rapport entre communisme et modernisme » ?
Je termine Red Modernism peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, car l’URSS était alors devenue une entité très différente de celle voulue par Lénine et Trotsky ou qu’auraient pu imaginer Marx et Engels. Comme l’a écrit Eric Hobsbawn, le type d’autoritarisme de Staline « aurait scandalisé Lénine et les premiers bolchéviques, sans même parler de Marx ». Ce en quoi l’URSS s’était transformée sous le règne de Staline a en grande partie coupé court à l’enthousiasme, déjà conflictuel, que de nombreux poètes avaient pour l’État socialiste ainsi que pour les aspirations communistes de cet État. Cela est vrai pour Pound, Williams et Zukofsky. L’engagement de Pound envers l’URSS était devenu principalement satirique, et c’était contre le stalinisme que cette satire était dirigée. Williams s’est abstenu de faire directement référence à l’URSS dans sa poésie plus tardive, mis à part une référence tardive aux atrocités stalinistes. Et après avoir modélisé une canzone sur la théorie de la marchandise de Marx dans la neuvième partie de son texte épique, Zukofsky allait également détacher sa poésie de la politique dans laquelle celle-ci était investie jusque là, afin de se concentrer littérairement sur la philosophie spinozienne et la vie domestique.
Bien évidemment, dire que ce moment marque la fin du communisme dans son ensemble serait surestimer la signification de Staline et de son appareil d’État. L’idée du communisme était toujours bien vivante en URSS, dans le Front Populaire et lors d’autres manifestations dans divers endroits du globe. Mais, pour les modernistes, dont l’intérêt pour le communisme était si profondément lié à l’URSS, Staline avait rendu le socialisme insoutenable et un socialisme insoutenable signifiait un communisme apparaissant comme de plus en plus improbable. Toutefois, dans l’épilogue du livre, je m’intéresse également brièvement à deux autres contextes révolutionnaires : la Chine de Mao et le Cuba de Castro. La Chine et Cuba résonnaient différemment pour les poètes aux États-Unis – j’évoque la poésie de Charles Olson et d’Allen Ginsberg, qui sont tous deux considérés comme les extrémités du modernisme en poésie – mais traiter de l’héritage de ces révolutions plus tardives dans sa totalité nécessiterait un cadre entièrement nouveau : à savoir, le postmodernisme. Ceci étant dit, ces contextes seront largement traités dans le livre que je suis en train d’écrire : une histoire littéraire de la lutte des classes, de la Commune de Paris jusqu’à l’Insurrection qui vient, qui aura beaucoup de choses à dire sur la guerre de guérilla comme unique mode d’insurrection communiste.
Dans Red Modernism, vous faites référence à l’idée d’Alain Badiou selon laquelle il existerait un « lien essentiel entre poésie et communisme » à cause du lien entre la poésie et le langage : êtes-vous d’accord avec cette idée ?
Je ne suis pas en désaccord avec l’idée de Badiou selon laquelle s’intéresser au langage, c’est s’intéresser à ce qui est commun, mais je ne suis pas entièrement convaincu de l’utilité de son essentialisme. Alors que l’idée elle-même semble très belle, elle risque de produire un formalisme abstrait complètement coupé des situations historiques et donc des conditions de possibilité d’un communisme réel. J’ai l’impression que Badiou ne s’intéresse pas à l’économie politique, alors que je maintiens qu’un communisme sans économie politique n’est pas réellement du communisme. Et si tous les poèmes sont liés au communisme, et peut-être le sont-ils, je voudrais demander : certains poèmes sont-ils plus communistes que d’autres ? Que Badiou illustre son idée en recourant à César Vallejo, Pablo Neruda et Bertolt Brecht – trois communistes convaincus qui ont tous écrit des poèmes sur le communisme – suggère la réponse à cette question.
Entretien mené par Selim Nadi. Traduit de l’anglais par Sophie Coudray et Selim Nadi.