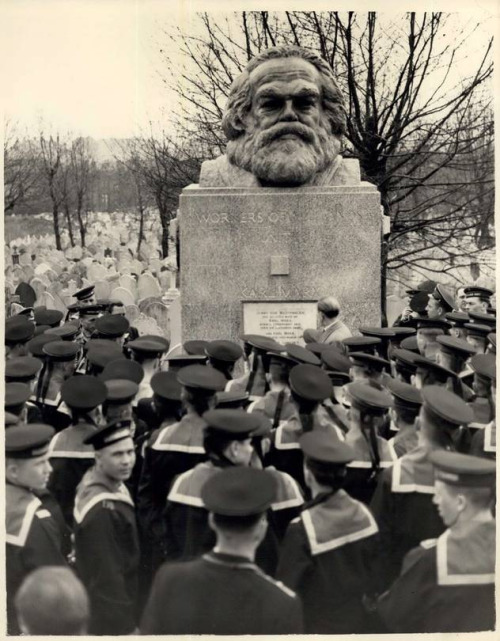À contre-courant
Sebastian Budgen (S. B.) : Il serait sans doute utile de commencer par une petite note biographique. Quel était ton bagage en arrivant en France, à l’âge de dix-huit ans ? Quelles ont été tes premières rencontres et expériences ? Pourquoi t’es-tu engagé dans la rédaction d’une thèse qui allait devenir Philosophie et révolution ?
Stathis Kouvélakis (S. K.) : Même si j’ai toujours aimé lire depuis mon enfance, je me suis intéressé au marxisme avant tout pour des raisons politiques et non livresques. Mon militantisme a commencé en Grèce, pendant mes années de lycée, ce qui était chose assez courante dans ma génération. J’ai adhéré en 1981 à l’organisation de jeunesse du parti communiste grec dit « de l’intérieur », dont l’orientation était eurocommuniste. Au sein de ce courant politique, minoritaire par rapport au parti communiste orthodoxe, mais dont l’audience était significative auprès des lycéens et des étudiants, l’influence d’Althusser était très forte. Plus largement, le marxisme althussérien était dans l’air à l’époque en Grèce, aussi bien dans les milieux militants que dans les cercles qui s’intéressaient tout simplement au débat intellectuel. L’une des raisons se trouve dans l’audience importante de l’œuvre de Nicos Poulantzas, qui était en quelque sorte le théoricien officiel du courant eurocommuniste et assurait une forme de traduction politique de l’althussérisme tout en proposant une élaboration théorique originale.
Une fois arrivé en France, en 1983, après un bref passage par l’économie, j’ai entamé des études de philosophie pour approfondir cet intérêt intellectuel que j’avais pour Marx et pour le marxisme, et pour le replacer dans une perspective plus large. J’ai également milité pendant quelques années à l’Union des étudiants communistes (UEC) ((Après une longue histoire de dissidences, d’exclusions et de vagues de départs au cours des années 1960 et 1970, l’UEC est à l’époque entièrement alignée sur le PCF et fonctionne de fait comme un vivier de futurs cadres du parti.)) et, surtout, au PCF, que j’ai quitté lorsque Pierre Juquin a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 1988 – tout en restant finalement assez proche jusqu’à la fin des années 1990. La totalité de mon parcours d’études s’est faite à l’université de Nanterre, et c’est là que je suis très vite entré en contact avec celui qui fut mon directeur de thèse, Georges Labica ((Georges Labica (1930-2009), philosophe marxiste, auteur de nombreux ouvrages. Membre du PCF depuis 1954, il est nommé en poste à Alger en 1956, pour enseigner la philosophie au lycée. Il rejoint rapidement les rangs du FLN et participe à partir de 1960 à l’équipe de rédaction de son organe principal, El Moudjahid. Labica passe la fin de la guerre dans la clandestinité, à Alger, sa tête est mise à prix par l’OAS. Après l’indépendance, il enseigne à l’université d’Alger où il joue un rôle éminent dans la mise en place de l’enseignement de la philosophie. Il reste en Algérie jusqu’à la fin de l’année 1968, mais participe aux événements de mai à Paris. De retour en France, il enseigne à l’université de Nanterre et milite de nouveau au PCF, qu’il quitte en 1982, après avoir été l’un des animateurs de l’opposition interne autour du mouvement « Union dans les luttes ». Militant anti-impérialiste actif, il était président honoraire du Comité de vigilance pour une paix réelle au Proche-Orient (CVPR-PO), président de Résistance démocratique internationale et membre de l’Appel franco-arabe. Site consacré à Georges Labica : labica.lahaine.org)).
J’ai commencé à travailler sur cette thèse au tout début des années 1990 et je l’ai terminée en 1998, à l’université de Paris 8, sous la direction de Jean-Marie Vincent. Je me suis donc hâté lentement comme on dit… Au-delà des facteurs anecdotiques, je pense que la raison pour laquelle ce travail a pris tellement de temps c’est que j’étais à la recherche d’une voie qui m’était propre. C’est notamment au cours de ces années que j’ai changé ma manière d’approcher Marx et que je me suis détaché de l’althussérisme sans toutefois devenir anti-althussérien.
S. B. : Pourrais-tu situer ta trajectoire dans le contexte français de ces années 1980-1990 qui ont vu le reflux rapide du marxisme et, plus largement, la fin de la radicalisation multiforme qui a marqué la société française dans la foulée de 1968 ?
S. K. : Au début des années 1990, et en réalité bien avant cela, il était devenu clair que quiconque choisissait de travailler ouvertement sur Marx ou dans une perspective qui s’en réclamait commettait un acte de suicide en termes de carrière académique. C’était tout particulièrement le cas en philosophie, mais pas seulement, le constat me semble valable pour l’ensemble du champ universitaire. Je savais donc d’emblée que ce choix aurait un coût très lourd et, effectivement, je ne me suis pas trompé, à la fois en ce qui concerne ma propre trajectoire professionnelle mais aussi pour la poignée de celles et ceux qui ont fait des choix comparables au mien à cette époque. Un véritable mur s’était mis en place à partir du début des années 1980 dans l’université française, mais aussi dans des lieux étroitement liés à celle-ci – l’édition, les revues « établies » –, qui excluait tout travail sur Marx et le marxisme, ou à partir de ceux-ci, du champ de la discussion et des objets de recherche légitimes.
Il me faut insister là-dessus parce qu’il y a actuellement une tendance à faire une sorte d’histoire des idées où on met l’accent – en partie à juste titre d’ailleurs – sur le recul du marxisme comme conséquence de la déliquescence des organisations et des régimes qui s’en sont réclamés. On insiste moins sur les effets de cette purge extrêmement méthodique, qui combinait une forte dimension de « violence symbolique », comme dirait Bourdieu, et un interdit professionnel implicite mais tout à fait réel. Le résultat en est qu’en termes de génération, la mienne est, je pense, la moins représentée dans le champ de celles et ceux qui travaillent dans le cadre du marxisme en France.
Le « choix originel », pour utiliser ce terme de Sartre, en arrière-fond du choix du sujet spécifique était donc de réinventer une forme d’unité de la théorie et de la pratique réfléchie sur le plan théorique et adéquate à une conjoncture difficile, où il n’y avait guère d’autre choix que d’apprendre à nager à contre-courant. Cette recherche de l’unité théorie-pratique signifiait plus particulièrement refuser une posture assez répandue dans un certain milieu qui consiste à juxtaposer un travail académique respectueux du cadre de ce qui est légitime pour l’institution et des positions, voire même des engagements politiques, radicaux. Pour ma part, je n’ai jamais accepté ce jeu à la docteur Jekyll and Mister Hyde : le jour on est un universitaire légitime, la nuit un « subversif ». J’ai tenu à travailler sur ce type de sujet non pas en dépit mais à cause de ces circonstances, tout en étant conscient que, ce faisant, on se fâche avec beaucoup de monde, et avant tout avec l’institution universitaire française.
S. B. : Pourtant, le contexte universitaire de cette époque – celui dans lequel s’inscrit ton propre travail – est marqué par le rôle que tiennent Georges Labica et les gens autour de lui qui s’efforçaient de résister à leur époque.
S. K. : Il me semble qu’André Tosel a résumé la chose de la façon la plus judicieuse quand il a écrit dans son texte sur les « mille marxismes » que c’est grâce à Georges Labica, à son travail obstiné, à ses initiatives et à sa capacité de regrouper des forces autour de lui que ce qui était une débandade a pu se transformer en « retraite intelligente », préparant le terrain à une relance intellectuelle et, peut-être, à terme, pas seulement intellectuelle ((Cf. André Tosel, Le marxisme du xxe siècle, Paris, Syllepse, 2009, p. 68.)). Pour ma part je crois qu’on ne peut pas parler de « chance », parce que c’était un choix tout à fait délibéré. J’ai eu en tout cas le privilège de suivre régulièrement, dès mon année de licence, les activités de l’équipe dirigée par Georges Labica. Cette équipe, dont le noyau était constitué d’enseignants en philosophie à Nanterre et de chercheurs au CNRS, regroupait à mon avis l’essentiel de ce qui s’est fait théoriquement autour du marxisme en France à cette époque – elle en a véritablement été l’épicentre intellectuel. C’était, je pense, une aventure passionnante qui s’est déroulée dans une période, celle des années 1980, qu’on a pu qualifier de « grand cauchemar ((François Cusset, La Décennie. Le grand cauchemar des années 1980, Paris, La Découverte, 2006.)) ».
Georges Labica bénéficiait d’une grande autorité morale, c’était pour moi un modèle de fermeté à la fois politique et intellectuelle, d’engagement et de ténacité à toute épreuve. C’était aussi quelqu’un d’une très grande générosité, qui ne cherchait jamais à imposer son agenda personnel, que ce soit au niveau politique ou intellectuel, à d’autres ; il avait une capacité à faire travailler autour de lui des gens très différents tout en respectant profondément leur personnalité. C’est une qualité que je n’ai jamais retrouvée par la suite, surtout dans le milieu universitaire. Il n’aimait pas parler de lui, et c’est quelqu’un qui, à mon sens, ne s’est pas suffisamment préoccupé de la diffusion de son propre travail.
S. B. : Il y avait une cohérence en termes théoriques dans cette équipe ou s’acheminait-on déjà vers la fragmentation qu’André Tosel a désignée par sa formule de « mille marxismes » ?
S. K. : Disons que le leadership de Labica assurait la coexistence réglée et pourtant productive d’une multiplicité d’orientations. La plupart des membres de l’équipe, ou de ceux qui étaient régulièrement associés à ses activités, appartenaient à ce que j’appellerai l’althussérisme au sens large. Pour le dire autrement, non pas au cercle étroit des disciples d’Althusser, tous issus de l’École normale, mais, comme Labica lui-même, à un deuxième cercle, une périphérie autour du courant althussérien. Certains d’entre eux, dont Labica, avaient participé à la revue Dialectiques qui a profondément marqué le marxisme des années 1970 et qui est mentionnée dans la première édition du Dictionnaire critique du marxisme, qui constitue l’acte fondateur de l’équipe.
L’atmosphère dominante était donc celle du post-althussérisme, avec des trajectoires qui se singularisaient de façon de plus en plus affirmée. Il faut mentionner les noms de Tony Andréani, de Jacques Bidet et de Jean Robelin, ainsi que les rapports étroits qui ont toujours existé entre cette équipe et André Tosel, basé d’abord à Nice puis à Besançon et, par la suite, trop brièvement malheureusement, à Paris. Mais à côté du post-althussérisme, il y avait également des personnalités fortes qui représentaient des orientations très différentes, comme Jacques Texier, Solange Mercier-Josa et Michèle Bertrand.
Autour de cette équipe gravitaient un grand nombre de doctorants. J’appartiens à cette cohorte de plusieurs dizaines de chercheurs qui ont travaillé à peu près à la même période sous la direction de Georges Labica. Ce qui était remarquable, et cela en dit long sur le contexte intellectuel et politique de ces années, c’est qu’au sein de ce groupe les « étrangers » étaient très largement majoritaires – et quand je dis « étrangers » ce n’étaient pas simplement les « non-Français » mais des chercheurs qui, pour la plupart, retournaient dans leur pays d’origine une fois leur thèse terminée. Parmi ceux qui travaillaient de façon plus explicite sur Marx et le marxisme, la quasi-totalité étaient des « étrangers » ou alors des doctorants atypiques – en général des enseignants du secondaire qui à un âge relativement avancé décidaient de faire de la recherche. On voyait donc clairement se poser le problème d’une rupture générationnelle et du non-renouvellement de la présence du marxisme dans l’institution universitaire française.
Dernière chose, les contacts internationaux : cette équipe disposait d’un réseau international assez développé, essentiellement en Italie (c’est là le legs de ce qui avait commencé avec Dialectiques) – on a pu parler à un certain moment, au cours des années 1970, d’un « marxisme latin », qui faisait revivre un arc initié par les échanges entre Labriola et Sorel au début du siècle précédent. Sauf que les interlocuteurs avaient changé, ce n’étaient plus les intellectuels majeurs du PC italien, mais des philosophes comme Domenico Losurdo, Alberto Burgio ou Costanzo Preve. Il y avait aussi des contacts développés du côté allemand, avec Wolfgang Haug et l’équipe berlinoise de Das Argument, (dont le grand projet du Historisch-Kritisch Wörtebuch des Marxismus s’inspire du Dictionnaire critique du marxisme), ou hispanophone (je me souviens notamment de Francisco Fernandes Buey ou de Pedro Ribas).
Ce qui manquait à peu près totalement, c’était l’ouverture vers le monde anglophone. Il y a là assurément un paradoxe, mais aussi une limite évidente, dans la mesure où, à cette époque, le centre de gravité du marxisme au niveau international s’était déjà déplacé vers les pays anglophones. La perception de ce fait était, à l’époque, en France, quasiment inexistante. La raison est sans doute à rechercher dans le poids d’un réseau issu pour l’essentiel de l’intelligentsia communiste de la période antérieure, mais aussi, malgré le caractère très ouvert et interdisciplinaire des thématiques abordées, dans l’orientation essentiellement philosophique de cette équipe qui explique le fait que le travail d’un Fredric Jameson ou d’un David Harvey ait pu passer inaperçu au moment même où leur aura s’affirmait au niveau international.
S. B. : Peut-on caractériser ce noyau autour de Labica comme des orphelins de l’aile gauche du PCF, des dissidents qui l’ont quitté au tournant des années 1970-1980, qui avaient, pour le dire rapidement, fait une croix sur le militantisme politique et déplacé leur énergie vers la recherche académique ?
S. K. : Dans les grandes lignes, ce constat me semble exact, mais ce n’est qu’un côté de la médaille. Labica avait effectivement compris que la seule façon, à partir des années 1980, de continuer un travail à la fois systématique et collectif autour de Marx, c’était de se placer à distance des appareils politiques. Pour le dire autrement, les espaces militants dans lesquels un travail important, avec toutes ses limites, s’était accompli au cours de la période antérieure appartenaient au passé. La seule possibilité concrète d’assurer une continuité mais aussi une transmission, c’était de construire quelque chose au niveau institutionnel, donc universitaire.
Je dois toutefois souligner le fait que Labica n’a jamais perdu de vue les contradictions inhérentes à sa démarche. Travaillant au sein de l’université, il s’est inscrit résolument en faux contre toute tentative de « marxisme académique », amputé de sa dimension interventionniste et politique, soumis au modes intellectuelles et intériorisant les critères dominants de légitimité. Il a toujours raillé des attitudes du type « on se retire dans notre cabinet d’études pour travailler du point de vue de Sirius » et a attaqué avec férocité la prétention selon laquelle la tâche de la philosophie consisterait à fournir aux autres pratiques théoriques le « fondement » (éthique, ontologique, etc.) supposé leur manquer. Il y avait chez lui cette grande exigence théorique, celle d’un travail intellectuel pointu, avec les aspects relativement spécialisés qu’il peut comporter, mais toujours en lien avec les questions portées par la conjoncture.
Je n’en mentionnerai qu’un seul exemple. À cause notamment de son parcours personnel, qui croise de façon forte l’histoire de l’Algérie, Labica a été sans doute parmi les premiers à comprendre l’importance que prendraient la religion et le rapport politique/religion à partir du début des années 1980. C’est une thématique qui fut abordée pendant plusieurs années au cours du séminaire de son équipe, par des intervenants venant d’un large spectre disciplinaire et intellectuel. Je crois que le véritable ciment de cette équipe aux orientations assez diversifiées est à rechercher de ce côté-là, dans une forme de fidélité non-sectaire au marxisme et dans le refus d’une position de surplomb de la philosophie à l’égard d’autres formes de savoir et de pratiques sociales et politiques.
Par ailleurs, même si on ne peut pas en dire autant de tous les membres de l’équipe, Labica lui-même était un modèle d’intellectuel combattant – qui n’a pas hésité à certains moments à se mouiller y compris sur le plan politique et militant après avoir quitté le PCF. Je me souviens de lui en 1986 comme candidat commun aux élections législatives soutenu par la LCR et le PSU dans les Hauts-de-Seine. Au cours des années 1980 il était proche de la LCR, et a également participé aux discussions initiales qui ont abouti à la campagne autour de Pierre Juquin. Il a par la suite pris des distances par rapport à la politique française et s’est recentré sur l’anti-impérialisme, autour de la Palestine notamment. Il avait également conscience du fait que s’il avait accompli un « petit miracle », en créant cet espace pour le marxisme au sein d’une institution universitaire qui le rejetait violemment, cet acquis était très fragile, constamment menacé. Il n’a d’ailleurs effectivement pas survécu à son départ à la retraite, au milieu des années 1990.
Marx et la pensée de la politique
S. B. : Comment as-tu construit l’objet de la recherche qui a abouti à Philosophie et révolution ?
S. K. : La question qui me taraudait bien avant de commencer ma thèse, c’était celle, disons, de l’existence problématique d’une théorie politique ou d’une pensée du politique chez Marx. Elle m’a marqué tout d’abord parce que quand j’ai commencé à militer, c’était précisément l’objet du débat qui était en cours. Celui-ci s’est essentiellement déroulé en Italie, mais aussi, sous une forme différente, en France, autour des interventions de Nicos Poulantzas, d’Althusser, d’Étienne Balibar, sans oublier celles du courant trotskyste, d’Ernest Mandel et de Henri Weber en particulier. En Grèce, on suivait tout cela de près, notamment parce que le parti communiste grec de l’intérieur était très branché sur les débats du communisme italien et du marxisme français. On avait une perception très vive que c’était en fin de compte Norberto Bobbio qui avait remporté la controverse qu’il avait initiée, et ce succès en disait long bien sûr sur l’état de crise à la fois stratégique, théorique et même existentielle du mouvement communiste.
Les thèses de Bobbio sont connues : il n’y a pas de théorie de l’État chez Marx et, plus particulièrement il n’y a pas de théorie de l’État socialiste. Plus fondamentalement, il n’y a pas, au sens fort du terme, une pensée du politique chez Marx, au-delà de quelques considérations instrumentales et réductrices sur les institutions, le droit et la démocratie, toutes choses appelées à disparaître sous le communisme assimilé à un dépérissement du politique en tant que tel. C’est précisément sur fond de cette absence, ou plus exactement de ce point aveugle que, selon Bobbio, le régime stalinien et ses avatars ont pu s’installer. C’est aussi la raison pour laquelle la stratégie eurocommuniste, elle-même héritière de la démarche gramscienne d’une « voie occidentale » de la révolution, était une aporie, sans autre résolution possible que le ralliement à la social-démocratie et le renoncement à la perspective anticapitaliste.
Ce débat était bien entendu d’un tout autre niveau que le vacarme créé en France par les « nouveaux philosophes » qui faisaient de Marx le responsable direct des goulags. En substance, cela revenait néanmoins à dire que, en fin de compte, les racines de la dégénérescence stalinienne et de l’impasse de la révolution en Occident étaient à chercher quelque part dans la théorie de Marx elle-même, et non dans la logique des situations historiques. Ce dont je me suis rendu compte par la suite, je dois dire à ma grande surprise, c’est qu’au cours de la même période Althusser en était venu à des conclusions assez similaires. Certes, la plupart des textes n’ont été publiés qu’à titre posthume, notamment « Marx dans ses limites ((Louis Althusser, « Marx dans ses limites », in Écrits philosophiques et politiques, vol. 1, Paris, Stock/Imec, 1994, p. 359-524.)) », mais ces positions sont même assez clairement énoncées dans ses dernières interventions publiques, des textes comme « Enfin la crise du marxisme », « Le marxisme comme théorie finie » ou « Le marxisme aujourd’hui » ((Ces trois textes, initialement publiés en 1978, ont été repris dans le recueil Solitude de Machiavel et autres textes, Paris, PUF, 1998, p. 267-309.)). Cela explique d’ailleurs pourquoi le recul du marxisme en France ne renvoie pas simplement à l’antimarxisme de l’adversaire, et donc au contexte politique de la fin des années 1970. Il renvoie aussi, et peut-être même surtout, à un délitement qui affecte le marxisme de l’intérieur, tout particulièrement autour du courant althussérien qui a été le pôle le plus dynamique, on peut même dire tendanciellement hégémonique, pendant le bref « âge d’or » qui va du milieu des années 1960 à ce tournant des années 1970-1980.
Mon travail était une tentative de me situer dans ce débat en reprenant les choses d’une façon plus fondamentale. Fondamentale veut dire ici qu’on ne pouvait plus penser en termes de « retour à Marx » ou à un « marxisme classique », en d’autres termes aux textes fondateurs, même s’il s’agissait d’en proposer une interprétation novatrice. Pour avoir quelque chance d’aboutir à des résultats nouveaux, il fallait élargir la focale. Il s’agissait non seulement d’intégrer Engels de façon beaucoup plus organique dans ce récit – les travaux de Georges Labica m’avaient tout à fait convaincu de cette nécessité – mais, surtout, de dépasser le cadre d’une étude « internaliste » des textes marxiens, ou marx-engelsiens, tout en gardant le souci de la spécificité conceptuelle et de la précision philologique.
Dans un premier temps, j’ai pensé que cela revenait à regarder vers le champ intellectuel au sein duquel se dégage la figure de Marx, c’est-à-dire du côté de ceux qu’on appelait les « jeunes hégéliens », qui sont à la fois les interlocuteurs, mais aussi les concurrents au sein de ce champ d’où émergent Marx et Engels – même si ce « et » désigne un problème théorique et non une évidence biographique ou théorique. Puis j’ai assez rapidement réalisé que les jeunes hégéliens étaient des épigones et qu’on ne pouvait se passer de remonter à cette séquence fondatrice, à savoir l’articulation de Kant et de Hegel, qui forme le point de départ finalement de cette étude.
Dans le même temps, j’ai pris conscience du fait que la compréhension de ces problèmes théoriques exigeait une étude précise de la conjoncture historique de ce que les Allemands appellent le Vormärz, la période qui s’étend des révolutions de 1830 à celles de 1848. En fait, il m’est apparu que si on veut vraiment rompre avec la vision téléologique, qui fait de l’évolution de la pensée marxienne le point d’aboutissement inscrit à l’avance dans la logique d’une séquence qui n’en est que l’anticipation, si on veut comprendre, en d’autres termes, l’émergence de cette pensée comme un véritable événement, comme une révolution théorique au sens fort du terme avec sa double dimension de nécessité interne et d’irréductible contingence, il fallait travailler sur ces trois niveaux à la fois, ce qu’à mon sens, aucune étude sur la formation de la pensée de Marx n’avait pu faire, voire même ne s’était réellement proposé de faire.
S. B. : Parlons plus spécifiquement d’Althusser, du rôle qu’il a joué dans ton approche et de la façon dont tu t’es détaché de son interprétation de la pensée marxienne.
S. K. : Il y a tout d’abord une divergence dans la méthode. Je l’ai dit auparavant, j’ai voulu reprendre la question de la formation de la pensée de Marx en élargissant la focale, en allant au-delà d’une simple étude des textes de Marx lui-même, ce qu’Althusser n’a pas fait, ou seulement de façon lacunaire. Sa vision des jeunes hégéliens, et aussi de la trajectoire d’Engels, est restée assez conventionnelle, à l’exception de Feuerbach, pour lequel il a manifesté un véritable intérêt mais dont il a beaucoup exagéré l’importance pour la trajectoire marxienne, pour des raisons qui tiennent à sa propre stratégie politico-théorique, à savoir les exigences de la polémique « antihumaniste ».
La place surdimensionnée accordée à Feuerbach est corrélative du parti pris anti-Hegel, qu’Althusser partage avec les protagonistes de la pensée française des années 1960. Or ramener Hegel à une nuisance, un obstacle dont Marx aurait sans cesse cherché à se libérer mais, mystérieusement, sans jamais y parvenir vraiment – car Althusser sera bien obligé d’admettre, du bout des lèvres, que Marx « revient » vers Hegel au seuil de chaque tournant théorique de son travail (que ce soit dans les Manuscrits de 1844 ou dans les Grundrisse) –, m’est apparu intenable et erroné, à la fois philologiquement et conceptuellement. Quant à l’entreprise d’« historicisation » de la formation de la pensée marxienne, on sait qu’elle se heurte à une double objection de principe chez Althusser, dans la mesure où elle contredit à la fois la « scientificité » de la théorie telle qu’il la définit et la « lecture symptomale » des textes à laquelle il s’est livré, et qui est une forme de lecture strictement « internaliste », prise dans le formalisme structuraliste dominant à cette époque.
Par ailleurs, même si, comme tout chercheur, j’ai essayé de faire preuve d’originalité, je ne pense pas que mon travail est une sorte de point de départ absolu – là encore, contrairement à Althusser. Je ne répugne donc nullement à discuter les différentes thèses qui se sont développées sur la question, surtout quand elles émanent de penseurs qui se réclament de Marx, sans chercher à les ramener à de simples erreurs idéologiques ou, la plupart du temps, en les traitant simplement par le mépris ou le silence. La principale de ces thèses, celle qui a polarisé les débats à partir des années 1960, a d’ailleurs été précisément celle de la « coupure épistémologique » d’Althusser. En ce sens, mon travail est inévitablement post-althussérien.
La thèse de la coupure est une thèse fondamentale dont dépend l’ensemble de l’approche althussérienne. Mais Althusser lui-même a évolué dans la manière dont il la définit. Dans un premier temps, il la pense comme une « coupure épistémologique » au sens strict, comme un passage de Marx de l’« idéologie humaniste » des écrits de jeunesse – et sur le plan philosophique d’un idéalisme dont Althusser avait vu que ce n’était pas un idéalisme hégélien mais un idéalisme jeune hégélien – à ce qu’Althusser appelle « la science », c’est-à-dire le matérialisme historique, avec un effet différé sur la philosophie. Pour Althusser, comme pour toute la tradition du « marxisme-léninisme », la théorie de Marx ne se limite pas au matérialisme historique, elle comporte également une philosophie à part entière, le matérialisme dialectique, que Marx n’avait pas pu élaborer, et qu’Althusser se chargeait de faire à la place de Marx. C’est à cette tâche que s’attellera la lecture symptomale du Capital, à travers une sorte d’induction de la philosophie manquante de Marx mais présente d’une certaine façon à l’état pratique dans les textes fondamentaux du matérialisme historique. En fait, il s’agissait plutôt d’une annonce programmatique, qui ne donnera que peu de résultats, mis à part, dans Lire le Capital, quelques développements (par ailleurs fort intéressants même si leur rapport à Marx est pour le moins problématique) d’Althusser sur la notion de temps historique ou la théorie générale de la transition de Balibar, ainsi qu’une définition générale de la philosophie comme « théorie de la pratique théorique », sorte d’hyper-épistémologie que s’efforcent de mettre en œuvre les textes sur la philosophie des scientifiques.
Avec ce qu’il a appelé son « autocritique », Althusser s’est engagé dans un processus de rectification de ses premières thèses « théoricistes ». Selon lui, malgré leur volonté d’orthodoxie marxiste, elles se situaient finalement dans le cadre du rationalisme développé par l’école française d’épistémologie de Bachelard et de Canguilhem. Dans les textes des années 1970, il dit que ce qui vient avant la coupure épistémologique et la conditionne, c’est une rupture politique. Marx se place du point de vue du prolétariat et c’est précisément à partir de là qu’il convient de retracer la révolution théorique dont il est l’auteur. On a donc là le Althusser numéro deux, un Althusser « politiciste » qui redéfinit le matérialisme historique comme une « science révolutionnaire » et la philosophie elle-même comme « lutte de classes dans la théorie ».
S. B. : C’est à cet Althusser que tu as toi-même adhéré ?
S. K. : Oui, c’est le point de départ de ma réflexion, qui renvoie à la conjoncture grecque que j’évoquais auparavant. Ce qui m’est toutefois apparu, chemin faisant, c’est que le Althusser 2 est en fait une inversion du premier – il ne modifie pas vraiment son schéma, simplement il l’inverse. Althusser a ainsi fini par dire qu’effectivement, chez Marx, la coupure politique précède la coupure épistémologique mais cette rectification l’a conduit à la conclusion selon laquelle Marx est en fin de compte un idéologue et que, en tant que tel, il ne maîtrisait pas les effets de son propre discours, qui se construit autour de vides qui sont autant d’apories théoriques insurmontables (l’inachèvement du Capital, l’absence de théorie de l’État, des classes, de l’idéologie, d’élaboration sur la dialectique, etc.). Pour le deuxième Althusser, en effet, l’idéologie n’est plus simplement l’anti-science des textes antérieurs, mais un implacable mécanisme d’assujettissement émanant d’une instance « interpellante », pensée sur le modèle de l’Église. C’est une conception qui, il faut le souligner, ne peut en aucun cas se réclamer de la problématique marxienne de l’idéologie, quelle que soit la façon dont on l’interprète.
Loin d’être la « science du continent Histoire », comme l’affirmait avec superbe le premier Althusser, le marxisme correspond ainsi à une « idéologie prolétarienne », c’est-à-dire un discours de légitimation des organisations ouvrières, qui assure l’assujettissement de leurs membres à l’appareil qui en forme l’ossature. Sa pertinence scientifique, et philosophique, apparaît largement fictive – la figure de Marx s’effacera du reste presque complètement dans les écrits du dernier Althusser sur le « matérialisme aléatoire ». Quant à son efficace pratique, qui a joué un rôle décisif dans la constitution de la subjectivité ouvrière, elle est désormais périmée. Le marxisme est une « théorie finie », à la fois au sens où il se débat dans des contradictions qui révèlent sa « finitude » et où sa crise, longtemps différée mais qui finit par éclater avec le reflux des années 1970, signe l’épuisement de ses effets en tant que forme concrète de « fusion de la théorie et du mouvement ouvrier ». On est ici pas très loin de la sagesse d’un Raymond Aron, et il n’est guère surprenant de voir le dernier Althusser accepter la formulation de « marxisme imaginaire » dont l’auteur de L’Opium des intellectuels avait affublé l’entreprise althussérienne ((Par exemple dans ses entretiens avec Fernanda Navarro, initialement publiés en 1988 au Mexique. Édition française : Sur la philosophie, Paris, Gallimard, 1994, p. 37, ou dans son autobiographie : L’avenir dure longtemps, suivi de Les Faits, Paris, LGF/Livre de Poche, 1994, p. 168.)).
Les ultimes textes d’Althusser publiés de son vivant, ainsi que ceux que Balibar avait écrits dans la foulée, m’avaient permis de prendre (partiellement) la mesure de la désintégration de la pensée althussérienne, confirmée et amplifiée par la publication posthume de ses écrits. C’est tout particulièrement le cas de « Marx dans ses limites ((Cf. note 4.)) » dans lequel l’ampleur de l’involution de la pensée althussérienne devient manifeste. Althusser y présente une vision extrêmement instrumentale de la théorie de l’État chez Marx et il en conclut qu’il n’y a pas et qu’il ne peut pas y avoir de théorie du politique chez Marx, rejoignant ainsi le propos du socialiste-libéral Bobbio. La lecture de ce texte m’a permis d’expliquer aussi l’évolution de certains disciples d’Althusser, tout particulièrement de Balibar, qui ensuite ont continué dans cette veine aporétique, « déconstructrice » et, disons-le, franchement masochiste, pendant toute la période qui a suivi.
S. B. : Qu’est-ce qui a succédé à Althusser dans ton travail ? Un auteur en particulier ou une orientation théorique plus personnelle ?
S. K. : J’espère que c’est la deuxième option, même si, je l’ai dit, il est illusoire de penser qu’on invente tout. La conclusion qui s’imposait à mes yeux est que si l’Althusser politiciste qui constituait mon point de départ aboutissait à un naufrage intellectuel, il fallait reprendre les choses depuis le début. Il fallait résolument décentrer la perspective pour être en mesure d’historiciser Marx, non pour le réduire à un contexte et sombrer dans un banal relativisme mais pour capter sa singularité et restituer la secousse provoquée par le surgissement d’une pensée novatrice, proprement révolutionnaire. Dans ce livre, j’ai essayé – avec les limites de quelqu’un qui n’a pas une formation d’historien, ni de germaniste – de suivre avec une certaine précision la période du Vormärz, à comprendre finalement cette période comme étant magnétisée par le mouvement qui éclatera avec la vague révolutionnaire de 1848, et qui constitue à mon sens la clef principale pour comprendre la révolution théorique initiée par Marx.
Ce faisant, ce que je redécouvrais en réalité c’est une approche des textes qui est « historiciste » au sens gramscien du terme, d’un historicisme « absolu ». Ayant commencé par militer dans un parti d’orientation eurocommuniste, je m’étais intéressé très tôt à Gramsci, dès mes années de lycée, grâce à l’ancienne édition « thématique » de l’œuvre, celle de Togliatti, disponible en Grèce depuis les années 1970. Mais il est vrai qu’étant sous influence althussérienne, je recherchais avant tout le Gramsci théoricien politique, un Gramsci précurseur, disons, du dernier Poulantzas, celui de L’État, le pouvoir, le socialisme. Par la suite, j’ai commencé à travailler de façon plus approfondie les écrits philosophiques de Gramsci et plus largement sa méthode, à la fois philologique et historiciste. J’ai également été largement poussé dans cette direction par la lecture des travaux de certains représentants éminents de cette école italienne d’approche des textes, comme Domenico Losurdo, auxquels il convient d’ajouter le travail sur Gramsci d’André Tosel. On peut dire que ce livre, comme le suggère son titre, qui annonce un mouvement qui va de la philosophie à la révolution de Kant à Marx, est une façon de réfléchir sur la célèbre série d’équations gramscienne « philosophie = histoire = politique ».
S. B. : Au-delà d’Althusser, parlons de certains travaux, essentiellement français, qui portent sur Marx et les autres auteurs traités dans le livre, parmi ceux qui étaient disponibles quand tu as engagé ce travail, et contre lesquels tu t’es défini, en particulier les travaux d’Auguste Cornu, de Maximilien Rubel, et aussi, par la suite, de Miguel Abensour.
S. K. : Tout cela ne se situe pas au même niveau. Les travaux de Cornu, pour commencer par lui, étaient complètement oubliés, d’ailleurs ils n’étaient plus disponibles depuis très longtemps. On ne les connaissait en général que par ouï-dire, par les mentions qu’Althusser en avait faites, et les choses n’ont guère changé depuis. Pour ma part, Cornu, que j’ai lu attentivement, m’a beaucoup aidé parce qu’il avait travaillé sérieusement sur les jeunes hégéliens. Il permet donc de comprendre la nécessité de situer Marx dans ce champ pour en saisir la trajectoire propre. Les matériaux de ses quatre volumes, notamment les traductions de longs extraits de textes qui y figurent, ont longtemps constitué les seuls textes disponibles en français d’un certain nombre de jeunes hégéliens. J’ai également découvert que Cornu s’était intéressé à Moses Hess, une figure clé dans mon récit, même si ce n’était pas une découverte pour moi dans la mesure où Gérard Bensussan, qui fut pendant un temps un proche collaborateur de Labica, et le codirecteur du Dictionnaire critique du marxisme, lui avait consacré un ouvrage tout à fait remarquable.
Cornu m’a incité à décentrer le récit, mais il fallait évidemment le compléter par des travaux plus récents venant de germanistes et d’historiens qui renouvellent considérablement ceux, plus anciens, de Jacques Droz sur le radicalisme rhénan et les premiers courants socialistes. Sans être exhaustif, je dois toutefois mentionner ceux de Jean-Pierre Lefebvre et de Lucien Calvié, ainsi que les travaux sur Heine et les transferts intellectuels entre la France et l’Allemagne autour de Michel Espagne et de son équipe, ceux de Michael Werner et de Gerhard Höhn. À cela, il convient d’ajouter les travaux d’historiens de la pensée socialiste et communiste, tout particulièrement ceux de Jacques Grandjonc sur la notion de communisme, mais aussi ceux de Jacques Guilhaumou et de Florence Gauthier sur la pensée jacobine et les langages théoriques de la Révolution française.
Il y a néanmoins un point important qu’il me faut mentionner car il se rapporte à la prise de distance par rapport à l’approche althussérienne, c’est l’approche de Labica. Labica représente en effet une tentative d’assumer, et même de radicaliser, -l’Althusser 2, l’Althusser politiciste. Pour lui, et c’est là où il se différencie fondamentalement d’Althusser, il n’y a pas de « philosophie marxiste », ou « marxienne ». C’était justement une erreur d’Althusser que de reproduire cette dualité matérialisme historique-matérialisme dialectique qui est en fait issue de la matrice du diamat, de la vulgate dominante de l’époque stalinienne. Il n’y a qu’un « statut marxiste de la philosophie » et la manière dont Labica définit ce statut est celle d’une « sortie de la philosophie », l’Ausgang de L’Idéologie allemande, qui sert de fil conducteur à sa lecture ((Georges Labica, Le Statut marxiste de la philosophie, Complexe, Bruxelles, 1976.)).
Il faudrait engager une longue discussion sur ce que Labica entend précisément par « sortie de la philosophie », dans la mesure où celle-ci désigne un processus marqué d’une incomplétude constitutive, qu’il s’agit donc de réitérer. On ne sort pas de la philosophie comme quand on claque une porte derrière soi, sinon on aboutit à un aplatissement positiviste du marxisme. Mais je n’étais pas satisfait des conclusions de Labica, notamment parce qu’il ne me semblait pas problématiser suffisamment le rapport entre un positionnement politique et le champ à la fois idéologique et théorique du mouvement ouvrier. Pour lui, l’engagement aux côtés du prolétariat conduit directement à la science révolutionnaire du matérialisme historique.
L’un des points essentiels de ma démonstration c’est que ce processus est beaucoup plus tortueux et qu’il comporte de multiples médiations et bifurcations. Marx part d’un démocratisme radical et devient un révolutionnaire avant de devenir communiste et de s’engager dans l’élaboration de la conception matérialiste de l’histoire. Dans ce passage, il s’oppose à des figures intellectuelles ou militantes liées au mouvement ouvrier, parce qu’une position de classe n’est pas automatiquement une position révolutionnaire et qu’elle ne conduit pas nécessairement à une conception matérialiste du processus historique. J’essaie plus particulièrement de montrer que Hess et Engels étaient entrés en contact avec le mouvement ouvrier avant Marx sans que cela les conduise au communisme dans un sens marxien, comme tendance de la lutte de classes. Leur horizon intellectuel a évolué, jusqu’à un certain moment en ce qui concerne Engels, à l’intérieur de ce qu’on appelle à l’époque le « socialisme vrai », un socialisme humaniste qui refusait explicitement la politique, et brouillait la perspective d’un renversement révolutionnaire de la société bourgeoise au profit d’une vision du « social » et du « socialisme ». Ces deux termes renvoyaient à une opération de restitution de l’essence intégratrice des rapports sociaux, antidote à l’atomisation et aux antagonismes inhérents à la modernité capitaliste susceptible de recueillir l’adhésion même de la bourgeoisie éclairée.
S. B. : Vers la fin des années 1990, l’intérêt pour le jeune Marx en France est relancé par le livre de Miguel Abensour La démocratie contre l’État. Marx et le moment machiavélien.
S. K. : La démocratie contre l’état est incontestablement un livre stimulant, original. Il s’agit d’une lecture interne des textes, menée à partir d’un point de vue libéral arendtien, plus particulièrement du manuscrit souvent désigné comme « manuscrit de Kreuznach », dans lequel Marx commente des extraits des Principes de la philosophie du droit de Hegel. Abensour s’efforce de rattacher un moment particulier du jeune Marx, celui de la « vraie démocratie », au républicanisme tel qu’il est théorisé essentiellement par J. G. A. Pocock, et dans un sens plus large par Arendt, comme vita activa, participation active à la vie de la cité, formation d’un sujet partageant les valeurs fondatrices de la communauté politique (liberté, vertu, citoyenneté). Ce qui toutefois est à mon sens complètement perdu de vue dans cette vision, c’est que pour Marx la politique est toujours constitutivement liée à une transformation matérielle des rapports sociaux, même si les termes dans lesquels il a pensé ces transformations ont évolué. Pour Marx, la praxis politique ne peut être réduite à une affirmation subjective, à l’affirmation d’une autonomie de la politique définie par son sujet constituant. Marx s’intéresse aux Principes de la philosophie du droit précisément parce que dans ce texte Hegel tente de penser les rapports de l’État et de la sphère des rapports sociaux, en intégrant les acquis de l’économie politique. La « vraie démocratie » dont il est question dans le manuscrit de 1843 sur Hegel doit donc être comprise comme une première approche de la politique comme entreprise de transformation radicale des rapports sociaux, que Marx définit comme dépassement de la division entre l’État politique et la société civile-bourgeoise.
Abensour essaie de sauver un moment du jeune Marx mais il en donne une vision unilatérale, qui revient, en fin de compte, à condamner avec d’autant plus de force le Marx qui a suivi, puisqu’il se serait écarté de ce « moment machiavélien », sorte de fulgurance théorique de sa jeunesse qu’il aurait par la suite abandonnée pour sombrer dans l’économisme, l’étatisme et les visions téléologiques de la lutte de classes.
S. B. : La lecture d’Abensour est liée à celle d’une autre figure qui a souvent été vue comme une alternative, à la fois au niveau politique et à celui de l’interprétation des textes, à celle d’Althusser, c’est-à-dire le travail de Maximilien Rubel, éditeur et commentateur de Marx… Je sais que tu es très critique du travail qu’il a fait sur le Capital, mais est-ce qu’il a constitué un repère important pour la période sur laquelle tu as travaillé ?
S. K. : Non, pas vraiment. Rubel a eu le mérite de rendre accessibles un certain nombre de textes de Marx et de faire un travail philologique qui comporte des aspects intéressants, même si sa manie d’éditer Marx en morceaux choisis ou en éliminant carrément des chapitres entiers des ouvrages me paraît tout à fait inacceptable. Toutefois, contrairement à un mythe qu’il a lui-même propagé comme quoi il serait complètement libéré des interprétations marxistes de Marx, qu’il veut revenir à Marx par-delà et contre le marxisme, sa lecture de Marx représente en réalité une option issue d’une tradition intellectuelle très précise. C’est, comme Lucien Goldmann l’avait déjà montré ((« Y a-t-il une sociologie marxiste ? », in Lucien Goldmann, Recherches dialectiques, Paris, Gallimard, 1959, p. 280-302.)), une lecture néo-kantienne et éthique de Marx défendue par certains théoriciens autrichiens, notamment Karl Vorländer et Max Adler. Cette tradition intellectuelle a toujours représenté une sensibilité au sein du marxisme au sens large, plutôt liée au courant social-démocrate d’Europe centrale et germanique – ce qui embarrasse plutôt le libertaire Rubel qui ne la mentionne que de façon occasionnelle et, de surcroît, confuse. Je ne pense pas avoir eu particulièrement à me situer par rapport à la lecture de Rubel qui m’a toujours semblé faible théoriquement.
S. B. : Un nom qui revient assez souvent dans le livre, de façon assez étonnante pour un marxiste, c’est celui de Foucault. En quoi a-t-il pu te servir dans ta tentative de penser le processus intellectuel de Marx ?
S. K. : C’est sans doute paradoxal, mais Foucault a joué un rôle important dans ce travail, qui ne partage pourtant en rien sa vision de Marx et du marxisme. Foucault et le marxisme ont des rapports qu’il est juste de définir comme antagoniques. Foucault lui-même se conçoit comme quelqu’un qui se place en concurrence par rapport à Marx, c’est quelque chose qu’Isabelle Garo a très bien souligné dans son livre ((Isabelle Garo, Foucault, Deleuze, Althusser et Marx. La politique dans la philosophie, Paris, Démopolis, 2011.)). Mais s’il se positionne ainsi, c’est que, pour une part en tout cas, il se situe sur un même terrain.
Le Foucault qui m’a intéressé c’est le théoricien des discours, quand il s’est agi d’examiner la jointure entre un discours proprement philosophique, ou un régime proprement philosophique de discours, et d’autres types de régimes discursifs qui surgissent à cette époque, plus particulièrement ceux liés au « social », ou au « social-isme ». C’est la raison pour laquelle Foucault est présent essentiellement dans le chapitre sur Engels. On ne peut comprendre, à mon sens, l’ouvrage clé du jeune Engels, La situation des classes laborieuses en Angleterre, sans étudier la manière dont il s’inscrit dans un discours du « social » et un regard sur la condition ouvrière tels qu’ils se constituent à cette époque. Pour le dire autrement, la littérature théorique du mouvement ouvrier émergent, auquel appartient cet ouvrage, ne surgit pas dans un vide, ni comme expression immédiate de l’expérience ouvrière, mais dans un déjà-là de discours à prétention indissociablement scientifique et réformatrice, qui forment le fond commun des socialistes et des observateurs « bourgeois » de la condition ouvrière.
Décentrer le récit
S. B. : Parlons maintenant de la structure de l’ouvrage. Tu t’arrêtes au début de 1844, avant les grands ouvrages et textes de Marx – avant La Sainte Famille, avant L’Idéologie allemande – et avant les processus révolutionnaires de 1848. Qu’est-ce qui justifie ce choix du point de vue d’un projet plus large sur Marx et sa pensée de la politique ?
S. K. : L’intention initiale était d’aller au-delà – c’est du reste toujours le cas dans des projets de ce type –, très précisément jusqu’à L’Idéologie allemande, jusqu’au moment de la « coupure » telle qu’Althusser l’avait définie. J’ai dû m’arrêter avant et, pour me justifier, je peux évoquer des raisons de temps, de délais, qui étaient bien réelles. J’avais quand même beaucoup tardé pour terminer ce travail, qui a nécessité pas moins de huit ans. Mais la raison principale me semble d’ordre interne. Je m’arrête à un moment qui est celui des textes de Marx publiés dans les Annales franco-allemandes. Or ce moment, comme le suggère le titre de cette revue dont une seule livraison a vu le jour, représente la conclusion logique de l’axe franco-allemand qui structure la totalité de l’ouvrage. J’y ai certes également inclus une dimension anglaise, principalement à travers Engels, mais, je le reconnais, elle demeure relativement excentrée, moins systématiquement développée que l’axe France-Allemagne.
Pour le dire autrement, en analysant ces textes de 1843-1844, je pensais être arrivé au bout de la démonstration que j’étais en mesure de faire à ce moment-là, c’est-à-dire montrer comment s’opère la « coupure politique », plus exactement comment Marx « passe » du démocratisme radical, mais réformiste, à la révolution, et comment dans cette révolution, il reconnaît, il nomme – et, par cet acte de nomination, contribue à constituer – un sujet nouveau, inouï dans le cadre allemand, le prolétariat, posant du même coup cette révolution comme une révolution radicale, qui ira au-delà de l’horizon français de 1789-1793.
Marx mène ainsi, d’une certaine façon, à terme la séquence que j’aborde dans ce livre. À travers cette vision, inédite en tant que telle, d’une révolution radicale en Allemagne dont le prolétariat serait le protagoniste, il opère la jonction avec Heine qui se concrétisera pour la première fois précisément dans les Annales franco-allemandes, où Heine publie son poème satirique « Éloges du roi Louis ((« Éloges du roi Louis », in Heinrich Heine, Nouveaux poèmes, Paris, Gallimard, 1998, p. 249-253.)) ». Suivre Marx jusqu’à ce seuil décisif qu’est le moment parisien me semblait donc être sinon une conclusion, du moins un point d’aboutissement provisoire adéquat à la démonstration que je tente dans ce livre.
Reste que ce parcours n’est pas suffisant. J’ai essayé d’aller au-delà dans des textes que j’ai écrits par la suite, et notamment dans ma contribution à l’ouvrage collectif Marx politique ((« La forme politique de l’émancipation », in Jean-Numa Ducange, Isabelle Garo (dir.), Marx politique, Paris, La Dispute, p. 39-90.)) , dans laquelle j’essaie de montrer comment Marx réfléchit à la question de l’émancipation politique et à son rapport avec l’émancipation tout court, ou avec l’émancipation sociale. La question formulée dans les textes de jeunesse (l’abolition de la séparation entre l’état ou l’état purement politique et la société civile, ou plus exactement la « société civile bourgeoise », la Bürgerliche Gesellschaft) est reprise et retravaillée dans des textes ultérieurs, plus particulièrement dans les textes sur la Commune de Paris. Là aussi, je prends le contre-pied d’une vision qui divise Marx en deux périodes qui n’auraient rien à voir entre elles, et je tente de montrer qu’il y a au contraire des fils profonds que Marx reprend et remanie d’une période à l’autre en visant quelque chose qui relève d’une pensée du politique, mais d’une pensée du politique dont les termes sont profondément reformulés et déplacés.
S. B. : Ce travail pourrait-il se poursuivre dans un deuxième tome ?
S. K. : Pas exactement dans un deuxième tome qui serait la suite linéaire de Philosophie et révolution, mais vers quelque chose qui traiterait de façon plus systématique l’évolution de Marx au-delà du moment des Annales franco-allemandes – à la fois le moment philosophique des manuscrits parisiens dit « de 1844 », les œuvres du tournant que marque L’Idéologie allemande et le moment des révolutions de 1848 qui pour moi est un moment profondément gramscien, au sens où Marx élabore une stratégie hégémonique pour une révolution démocratique sous la direction d’un bloc radical au sein duquel le prolétariat lutte pour conquérir une place dirigeante. Le défi consiste à cerner comment la défaite de cette stratégie ouvre sur la critique de l’économie politique et, par la suite, sur ce que je n’hésite pas à appeler le « tournant politique » que Marx opère après 1870 et le moment de la Commune de Paris.
S. B. : Abordons à présent la question du choix des auteurs discutés dans le livre. Pourquoi, au-delà de l’incontournable duo Marx-Engels, Heine et Hess et pas d’autres ?
S. K. : L’une de mes obsessions en écrivant ce livre était de parvenir à une historicisation en mesure de restituer la singularité des trajectoires, ce qui implique de rompre avec l’idée selon laquelle tous ces développements devaient tendre vers Marx. J’ai réfléchi à la façon de traduire cette idée dans la structure du livre, et j’ai même pensé à un certain moment que l’agencement des diverses parties devait être aléatoire, de telle sorte qu’on puisse les lire sans ordre préétabli, un peu comme le voulait Raymond Queneau avec ses Cent mille milliards de poèmes.
Celui qui m’a ôté cette idée de la tête, c’est Fredric Jameson, qui m’a dit qu’il fallait assumer une dimension narrative inévitable dans tout texte théorique et que, forcément, il y aurait un ordre qui allait l’emporter sur les autres. Cela revient également à assumer une certaine téléologie comme « forme vide » inhérente à l’ordre de l’exposé, qu’il est possible de contrecarrer en introduisant des ruptures tant sur le plan formel que sur celui du contenu, pour réfuter l’idée selon laquelle Marx est contenu « en germe » dans tout ce qui vient avant lui.
Ainsi, tout en acceptant que l’ordre soit orienté vers le binôme très classique en effet Engels-Marx, j’ai tenu à ce que chaque chapitre soit singulier, pas simplement dans son contenu – car il s’agissait d’étudier les auteurs pour eux-mêmes et pas en tant que « précurseurs » plus ou moins inaccomplis de Marx –, mais dans sa forme même. J’ai essayé dans chaque chapitre d’obtenir une sorte de couleur, de style, qui leur soit propre, en jouant également sur les d’outils d’analyse mobilisés pour chacun d’eux. Pour construire le chapitre sur Engels, j’ai ainsi utilisé Foucault, dans le chapitre sur Heine, j’ai eu largement recours à Walter Benjamin.
S. B. : Pour mieux comprendre la façon dont les choix s’effectuent, il vaut mieux commencer par les absents. Pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre sur Feuerbach ?
S. K. : Pour décentrer le regard sur Marx, il importait à mes yeux de le resituer par rapport au problème fondamental qui se pose à un intellectuel oppositionnel allemand de son temps, celui de la révolution allemande. Bien entendu, celle-ci ne peut être comprise que comme une partie de ce qui se joue plus largement en Europe à cette époque. Mais l’angle allemand est ici tout à fait déterminant. Et Marx l’a formulé de façon assez claire – mais il n’était pas évidemment le seul, ni le premier, c’est ce que j’ai compris petit à petit en parcourant ces matériaux –, il renvoie à l’idée selon laquelle les Français ont fait la révolution mais ce sont les Allemands qui l’ont pensée.
Tel est le décalage originel entre les deux situations, et il peut se décliner de plusieurs façons, selon diverses modalités. C’est bien sûr le rapport de la pratique, française donc, par rapport à la théorie qui, paradoxalement, est une théorie allemande, qui se développe à distance de la pratique – voire en opposition à celle-ci. C’est également un problème spatio-temporel, celui de savoir comment une réalité « attardée », la « misère allemande » comme disait Heine, peut s’articuler au processus français « avancé », comment les réalités de ces deux formations sociales se répondent l’une l’autre dans l’enchevêtrement de la géopolitique européenne qui a suivi la Révolution française. C’est aussi une façon de comprendre le rapport de la politique à la philosophie, puisque la politique est ce qui marque la situation française, et la philosophie ce qui constitue la spécialité allemande.
Le troisième terme dans le binôme France-Allemagne est bien sûr représenté par l’Angleterre, c’est-à-dire le développement capitaliste, mais aussi l’économie politique. On se retrouve avec le paysage qui rappelle à première vue les « trois sources du marxisme », la synthèse harmonieuse théorisée par Kautsky, qui connaîtra une extraordinaire fortune dans la façon dont le mouvement ouvrier s’est représenté l’émergence de la théorie marxienne. Or, au lieu d’une convergence quasi spontanée aboutissant à cette synthèse harmonieuse des savoirs, ce que la recherche fait apparaître c’est, à l’inverse, un processus difficile, comportant une part irréductible de contingence, qui se constitue à travers un jeu constant de décalages. C’est Gramsci qui a réfléchi avec le plus de profondeur sur cette question, qui constitue le point de départ de son concept-clé de « traduction » comme opérateur de passage entre ces trois langues et réalités européennes.
Ce que j’ai compris pour ma part, et qui m’a ramené à une lecture de Gramsci, c’est que les termes du problème avaient été posés par Hegel et par Kant, donc par des contemporains de la Révolution française, à la fois proches et distants de celle-ci, qui ont réfléchi à la nature du processus historico-mondial qu’elle a déclenché et à la manière dont celui-ci « se traduit » dans leur propre pays, à savoir l’Allemagne. On retrouve là ce qui fait en fin de compte le grand paradoxe allemand, qui est que tous ces philosophes qui ont assumé l’événement français tenaient fermement à le mettre à distance de la réalité allemande à proprement parler. Pour le dire autrement, la révolution, c’est bien, mais pour les autres, pour les Français. En Allemagne, on s’y prendra autrement, à travers des réformes, de préférence « par le haut », mais dans lesquelles les intellectuels-philosophes se voient attribuer un rôle spécifique, et stratégique.
Tels sont les termes du problème de la « réalisation de la philosophie » que les fondateurs ont légué aux générations qui leur ont succédé, et c’est ce qui a dicté mes choix quant aux auteurs à mettre en avant. Commencer donc avec Kant et Hegel, parce qu’ils sont le point de départ obligé, puis continuer avec Heine parce que c’est lui qui, pour la génération suivante, relance la question du rapport entre l’Allemagne et la révolution, et du rapport entre l’Allemagne et la France en particulier ; enchaîner avec Moses Hess parce qu’il théorise cette « triarchie européenne » Allemagne-France-Angleterre et joue un rôle décisif dans une première opération de traduction en allemand – traduction ici au sens gramscien – du discours du socialisme français et de l’économie politique. En venir enfin aux trajectoires de Engels et de Marx dans leur singularité, ce qui veut dire aussi dans leur contingence.
S. B. : D’accord, mais je reviens à ma question : pourquoi pas Feuerbach ?
S. K. : Ce choix fait partie de la prise de distance à l’égard de l’interprétation althussérienne. Feuerbach y occupe une place centrale parce qu’il permet de fonder la thèse du jeune Marx fondamentalement humaniste avec lequel s’opère la rupture désignée en termes de coupure épistémologique. Je me suis inscrit partiellement en faux par rapport à ce récit parce que je pense que l’influence de Feuerbach sur Marx a été grandement surestimée par Althusser – et pas seulement par lui bien entendu. En réalité, du fait de son « matérialisme », Feuerbach occupait une place bien plus « légitime » dans le récit « orthodoxe » que les penseurs allemands, irrémédiablement écartés du fait de leur « idéalisme ». Il suffit de lire quelques pages de Plekhanov, l’une des principales références de la vulgate « marxiste-léniniste », pour s’en convaincre.
À mon sens, Marx n’a jamais été à proprement parler « feuerbachien » car, pour le dire rapidement, les problèmes fondamentaux de Feuerbach – l’aliénation de l’homme dans la religion et la recherche d’un matérialisme enraciné dans la « sensibilité » – n’ont jamais été les siens. Ce qui a amené Marx à s’intéresser à lui, c’est sa recherche d’une approche critique de Hegel. Cette rupture était du reste déjà largement entamée à partir d’une lecture plus stricte, plus « hégélienne » en quelque sorte de Hegel lui-même. Et si Marx est amené à le faire, c’est parce que le feuerbachisme était quelque chose de diffus, auquel tout le monde devient sensible à un moment donné dans ces milieux et par rapport auquel on ne pouvait rester extérieur tant que la rupture avec ceux-ci n’était pas définitivement consommée. Cet intérêt dérivé pour Feuerbach doit ainsi être compris comme un « effet de champ », qui renvoie au fait que ce moment du parcours de marxien ne peut être compris en dehors du champ discursif et théorique des jeunes hégéliens.
Je n’écarte donc pas du tout la question de l’humanisme théorique mais ce que j’essaie de montrer c’est que pour la comprendre vraiment, il faut passer par Moses Hess et par Engels. Eux deviennent vraiment feuerbachiens, ce sont de véritables « humanistes théoriques », en d’autres termes des partisans du « socialisme vrai ». Ils veulent se tenir à distance de la politique, a fortiori de la politique révolutionnaire, et visent à changer les esprits par une doctrine de l’amour et de l’harmonie sociale, qui communique directement avec l’anthropologie feuerbachienne. Marx ne les suit pas du tout dans cette voie, et des deux, c’est Engels qui va rejoindre Marx, plus tardivement qu’on ne le pense habituellement.
Cela ne veut pas dire qu’Engels n’ait pas apporté à Marx des choses nouvelles, que l’échange entre les deux n’ait pas eu lieu également dans ce sens-là, mais il me paraît essentiel de souligner que les trajectoires de Marx et de Engels sont jusqu’à un certain moment sensiblement divergentes et ce qui les sépare, de façon décisive quoique non-exclusive, c’est la question de l’humanisme théorique.
Heine, Hess et le radicalisme rhénan
S. B. : Venons-en au chapitre sur Heine, sans doute l’un des aspects les plus singuliers du livre. Tu fais apparaître Heine comme une figure centrale de cette période, ce qui, j’imagine, était un pari risqué dans la mesure où il avait largement disparu du paysage marxologique, si tant est qu’il en ait vraiment fait partie. De surcroît, Heine n’était pas philosophe et, en tant que tel, il est surtout traité par les spécialistes de la littérature germanophone.
S. K. : Il est vrai que Heine est peu présent dans le contexte intellectuel et culturel français depuis déjà un certain temps. Il n’en a pas toujours été ainsi. Il fut en effet une époque où Heine était davantage une référence parce qu’il était intégré dans un canon culturel et littéraire porté essentiellement par la culture communiste. Nous disposons certes de travaux relativement récents d’une très grande qualité, notamment ceux de Jean-Pierre Lefebvre, de Michael Werner, de Lucien Calvié, de Michel Espagne et de ses collaborateurs, mais ils n’ont jamais dépassé, comme tu viens de le faire remarquer, le cercle des germanistes. D’une certaine façon, Heine, un grand classique de la culture allemande, est paradoxalement quelqu’un qu’il s’agit de redécouvrir, non seulement en France mais aussi dans d’autres aires linguistiques.
J’ai essayé, de mon côté, de contribuer à cette redécouverte, en restituant le Heine non pas « philosophe », ce qu’il n’était pas en effet, mais essayiste et intellectuel au sens fort de ce terme, parce qu’il a joué un rôle fondamental pour toute la période du Vormärz. Ce qu’il apporte c’est une redéfinition du rapport France-Allemagne – qui, pour Marx comme pour toute sa génération, est médié par la figure de Heine. Je rappelle que Heine est quelqu’un qui vit en exil à Paris à partir de 1832, alors qu’il est déjà une figure bien établie de la scène littéraire et intellectuelle allemande. C’est Heine qui permet de reformuler la question du rapport de l’Allemagne à la révolution autrement que comme une mise à distance, une traduction « réformatrice », ou comme une simple répétition de la Révolution française – comme le voulaient les jacobins allemands ou, en un sens très abstrait, les jeunes hégéliens fascinés par le radicalisme antireligieux du processus français. Il devient de ce fait une figure centrale dans la formation de ce qu’on peut appeler un radicalisme intellectuel allemand, constitutivement lié aux processus révolutionnaires français compris au sens large, qu’il contribue à actualiser en l’ouvrant aux courants qui marquent son époque : le saint-simonisme, le communisme, le mouvement ouvrier émergent.
Heine est de ce fait un maillon indispensable pour comprendre comment se constitue la génération des années 1840 – les jeunes hégéliens au sens strict du terme. Il m’a semblé, et c’était là effectivement un choix interprétatif de ma part, qu’il importait davantage d’étudier Marx en relation avec Heine – mais pas du tout dans le sens téléologique, ces deux figures ne sont absolument pas réductibles l’une à l’autre – que d’étudier Marx en relation avec Feuerbach. Si on veut comprendre comment Marx relie de façon organique la lutte politique et le communisme à travers la démocratie révolutionnaire, c’est Heine qui est la référence pertinente, pas Feuerbach. Si on veut comprendre comment se transmet l’idée, présente chez Hegel, d’un héritage révolutionnaire allemand, dont les moments constitutifs sont la Réforme, la guerre des Paysans et la philosophie classique, c’est encore vers Heine qu’il faut se tourner.
Il y a aussi une autre raison, je dois l’avouer. Pendant toute cette période des années 1990, j’ai, comme tant d’autres, tout particulièrement Daniel Bensaïd, beaucoup lu Walter Benjamin. J’ai été à la fois marqué par la façon dont Benjamin travaillait sur le xixe siècle – y compris donc sur la période qui m’intéressait – et intrigué par le fait que, chez Benjamin, Heine était très peu présent ; toute la place est en quelque sorte préemptée par Baudelaire. Cette absence m’apparaissait d’autant moins justifiée qu’il y a quelque chose de, disons, très benjaminien dans la figure de Heine. Un grand nombre des thèmes que Benjamin aborde dans son Paris capitale du xixe siècle se retrouvent chez Heine : l’exil, la flânerie, la forme fragmentaire et l’usage de l’ironie, l’apparition de la grande ville dans la poésie, l’expérience de la défaite de la révolution et celle d’une histoire qui, après l’écrasement des espérances de 1848, vire au cauchemar.
Je tenais donc à mettre en évidence ce Heine en tant que pionnier de la modernité émergente, ce qui n’est pas sans conséquence sur son rôle dans l’histoire que j’étudie. C’est aussi pour cette raison que je considère que la rencontre entre Heine et Marx – qui se fait à Paris à un moment décisif de leur évolution respective – est une rencontre épocale, qui ouvre une possibilité à la fois intellectuelle et culturelle inédite : l’idée d’une rencontre entre la modernité esthétique, intellectuelle et politique, dont la promesse continue de nous hanter parce qu’elle demeure inaccomplie.
S. B. : Il faut dire aussi un mot sur Hess. Est-ce qu’en arrière-plan du chapitre que tu lui consacres, tu pensais à ce que j’ai ressenti en le relisant, qu’il y avait quelques analogies entre notre propre période et la pensée de Hess, cette forme d’humanisme politiquement complètement impuissante mais remplie de bons sentiments ? Est-ce qu’il faut y lire en creux la critique d’une certaine ambiance théorique et politique, que tu retrouvais en France, dans l’affadissement de la gauche française, avec l’affaissement du marxisme et la montée d’une pensée molle, une sorte de vague humanisme social-démocrate ?
S. K. : Sans doute, même si ce n’était pas ma préoccupation première. Incontestablement, de nos jours, c’est une forme particulièrement affadie, et même franchement inquiétante, d’« humanisme » qui imprègne le discours politique, pas seulement de la gauche d’ailleurs. On peut penser à l’explosion du « caritatif » et du « compassionnel », suppléments d’âme des politiques néolibérales, ou au paternalisme « humanitaire », bien commode quand il s’agit d’habiller des interventions militaires impérialistes. Pour être équitable avec Hess, il faudrait toutefois dire que ce qui se rapprocherait le plus de son « humanisme » serait quelque chose comme la condamnation virulente du « règne de l’argent » par le pape François et le discours de réhabilitation du « lien social » et du « vivre ensemble ».
Ceci dit, et pour revenir à Hess, il faut bien voir que celui-ci est une figure contradictoire. Il y a bien sûr cet aspect d’un socialisme sentimental humaniste et antipolitique que tu évoques et dont j’ai voulu montrer la cohérence. Pour simplifier ma pensée, je dirais que si Marx était aussi feuerbachien qu’Althusser le prétend, il serait devenu Moses Hess, pas Marx. Mais il y a d’autres aspects de Hess qui sont tout aussi importants. Le premier c’est qu’il nous fait comprendre qu’être en contact avec le mouvement ouvrier ne signifie pas forcément – je l’ai déjà dit – adhérer à des positions révolutionnaires. Ça peut être exactement l’inverse. On oublie souvent à quel point ce socialisme sentimental, éthique, très profondément religieux, était puissant dans le mouvement ouvrier de l’époque. La religion « était dans l’air » d’une certaine façon. Le saint-simonisme lui-même se concevait comme une nouvelle religion.
Ce rapport à la religion m’amène à l’un des fils moins apparents mais néanmoins significatifs de ce travail – c’est le thème du messianisme, qui est également présent en filigrane dans le chapitre sur Heine. En effet, alors que beaucoup de choses séparent Heine et Hess, il y a là une dimension qui les rapproche, même si leur conception du messianisme diffère substantiellement. Hess vise, à travers l’anthropologie humaniste, à une reconstruction du politico-religieux, Heine conçoit la promesse messianique comme la présence spectrale que les générations antérieures vaincues lèguent au présent. Tous deux s’abreuvent pourtant à cette source, le contraire eût du reste été étonnant de la part d’intellectuels juifs qui évoluent dans ce milieu d’un radicalisme qui est essentiellement un radicalisme rhénan. Marx, dont on connaît le non-rapport problématique à sa judéité, et Engels sont également rhénans : d’une façon générale, l’histoire dont il est question est essentiellement rhénane, avant de devenir une histoire d’exilés, et ce filon du messianisme juif en est un aspect constitutif.
S. B. : Marx doit-il également être situé dans ce fil messianique ?
S. K. : C’est une vieille thèse, défendue notamment par Karl Löwith et, plus récemment, par Balibar qui se réfère notamment à mon travail ((Étienne Balibar, « Le moment messianique de Marx », Revue germanique internationale, n°8, 2008, p. 143-160.)). Selon lui, l’apparition du prolétariat chez Marx, dans l’Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel de 1843, relève d’un « moment messianique » attesté par l’usage extensif de métaphores religieuses, propre à un registre apocalyptique et prophétique, exprimant le renversement radical du prolétariat du « rien » au « tout » et la « révolution radicale » dont il est question dans ce texte comme une sorte de recréation ex-nihilo du monde. Il est certain que les métaphores religieuses appartenaient au style de l’époque, en ce sens elles relèvent d’un topos qui n’a rien de spécifiquement marxien. Il en est largement de même de la conception de la religion que véhicule ce texte marxien : à la fois cri de la créature souffrante et consolation (« opium du peuple »).
On ne gagne à mon sens pas grand-chose à se laisser guider par des métaphores ou à s’obstiner à assigner une origine religieuse à chaque concept politique. Contrairement à Engels, Marx, on le sait, s’est désintéressé à peu près totalement de la religion – les seuls fils qui le rattachent à une sensibilité messianique ce sont Hess, qu’il a lu et connu personnellement, et, d’une façon plus souterraine, Heine. En ce sens, oui, de façon indirecte, médiée, il y a un élément messianique, juif mais pas exclusivement, qui renvoie à la spécificité du radicalisme rhénan et à l’atmosphère générale de la période.
Mais je ne pense pas que cet élément joue un rôle structurant dans le cheminement qui conduit Marx à la « découverte » du prolétariat. Celle-ci ne peut, à mon sens, être comprise que comme solution de l’« énigme » de la révolution allemande, de sa non-contemporanéité qui n’a cessé de hanter les penseurs d’outre-Rhin depuis la Révolution française. La subjectivité négative du prolétariat fait corps avec un raisonnement dialectique, une sorte de déduction, certes très spéculative, menée à partir de l’examen d’un problème historique, d’une traduction allemande de la conjoncture à laquelle il était confronté. Tout cela nous éloigne, me semble-t-il, d’un « moment messianique ».
Faut-il brûler Friedrich Engels ?
S. B. : Venons-en à présent à Engels. Il est clair qu’il ne sort pas indemne de ce livre, du fait notamment de la façon dont il traite de l’immigration ouvrière irlandaise dans La Situation de la classe laborieuse en Angleterre. Certes, comme tu le soulignes, cet ouvrage représente le Engels antérieur à la rencontre intellectuelle avec Marx, mais ce que tu en dis est lourd de conséquences quant à la façon d’aborder le long débat, qui n’est pas clos, sur le rapport entre Engels et Marx, les spécificités de chacun, et le rôle que le premier aurait joué dans une certaine tradition du marxisme contre laquelle certains cherchent à se définir.
S. K. : Dans la lecture, j’essaie de prendre le contre-pied des approches critiques d’Engels telles qu’elles existent dans l’abondante littérature consacrée à son rôle dans l’élaboration de la théorie qui porte, essentiellement de son fait d’ailleurs, le nom de « marxisme ». Par « approche critique » il faut ici entendre toute celle qui se démarque de la vulgate selon laquelle Engels est simplement l’alter ego de Marx, le brillant second qui a utilement complété son œuvre. Si on met de côté celles qui cherchent à l’exclure purement et simplement du champ de l’étude, au premier rang desquelles on trouve Maximilien Rubel, l’essentiel de ces approches visent à critiquer, voire à rejeter, les écrits « philosophiques » du dernier Engels, avant tout l’idée d’une « dialectique de la nature ». Perry Anderson a souligné, à juste titre, que la quasi-totalité de ce qu’il a appelé le « marxisme occidental » se caractérise par le rejet de ce legs engelsien. La critique adressée à Engels porte également sur son interprétation du Capital, tout particulièrement de son ordre d’exposition, ainsi que sur son rôle dans l’édition des livres II et III du Capital. Elle a été récemment relancée, suite à l’édition dans la MEGA ((Marx-Engels Gasamtausgabe. Édition des œuvres complètes de Marx-Engels, commencée dans les années 1970 en République démocratique allemande et toujours en cours.)) de l’ensemble des manuscrits marxiens dont Engels s’est servi pour éditer les deux derniers livres.
Concernant le jeune Engels, la tendance est, à l’inverse, de réhabiliter son rôle en tant que pionnier de la critique de l’économie politique et de l’étude des réalités ouvrières. Il est significatif qu’un « anti-engelsien » comme Terell Carver et un « engelsien » comme Labica s’accordent sur ce point ((Cf. Terell Carver, Friedrich Engels, His Life and Thought, Palgrave MacMillan, Londres, 1991 ; Georges Labica, Le Statut marxiste de la philosophie, op. cit.)). Ce dernier a fortement plaidé en faveur de cet Engels pionnier, qui se place déjà sur le terrain du matérialisme historique à construire, mais son argumentation m’a laissé profondément insatisfait. Labica mésestimait, à mon sens, l’appartenance des textes engelsiens à un type de discours hégémonique à cette époque-là et qui réfléchissait sur les problèmes posés par la condition ouvrière en termes médicaux, ceux d’une « physiologie » des conditions sociales. Analyser les réalités de classe en termes racialisants fait par exemple partie intégrante de ce type de discours, et il n’est en ce sens nullement surprenant d’en retrouver certains éléments caractéristiques chez Engels – ce qui est, bien évidemment, embarrassant pour le lecteur actuel et ne va pas sans poser tout un nombre de problèmes dont on aurait tort de penser qu’ils sont derrière nous.
S. B. : Tu essaies donc de sortir d’une opposition entre un « jeune Engels » et un Engels tardif, sur le modèle de celle entre le « jeune Marx » et celui de la maturité ?
S. K. : J’ai tenté une lecture critique du jeune Engels précisément parce que je considère qu’Engels est un penseur original, entre autres du fait que, contrairement à Marx, il n’est pas issu du moule universitaire et qu’il a une connaissance de première main des réalités économiques et sociales anglaises. Il y a bien en ce sens des innovations théoriques d’Engels, tout particulièrement dans sa première tentative de critique de l’économie politique et dans l’analyse de la condition ouvrière. À condition toutefois de voir que cette critique est placée sous le signe de l’humanisme philosophique et qu’elle s’inscrit, à l’instar de celle de Hess, dans les orientations du « socialisme vrai ».
Il est en effet frappant de constater, à la lecture de La situation de la classe laborieuse en Angleterre ou, de manière encore plus explicite, de celle des conférences qu’il a données avec Moses Hess au début de 1845 dans les villes de Rhénanie, à quel point Engels s’inscrit bien dans cette mouvance. Engels et Hess font preuve d’une grande modération, et même d’un refus du politique, en cherchant à déplacer les problèmes posés par la condition ouvrière et les revendications propres à cette classe émergente du terrain politique vers un autre, celui du « social ». Le « social » est conçu à la façon de Saint-Simon, par la suite repris par la « science sociale » française de Comte ou de Durkheim, comme un principe régulateur, pacifiant, en tant que « lien social » pour reprendre une terminologie très présente dans la sociologie contemporaine. Pour lui, la véritable contradiction du capitalisme n’est pas tant l’antagonisme de classe à proprement parler, mais celle entre le principe « social » et le binôme argent/marché, porteur de chaos et de concurrence illimitée.
Une autre innovation d’Engels que j’ai essayé de souligner, c’est sa pensée de l’espace urbain, qui se développe à travers ce regard sur la condition ouvrière et que Henri Lefebvre avait déjà mis en évidence ((Cf. Henri Lefebvre, La Pensée marxiste et la ville, Paris, Casterman, 1973.)). Ce point de vue sur la modernité naissante du xixe siècle est l’un des aspects les plus intéressants d’Engels, comme de Heine d’ailleurs. Ce n’est nullement un hasard si Engels écrit par la suite La Question du logement, l’un des premiers textes qui traitent de façon systématique des problèmes urbains du point de vue du matérialisme historique.
S. B. : Quelles sont les conséquences de ces analyses pour l’Engels tardif, son rôle dans la constitution du marxisme de la IIe Internationale, son positivisme présumé, son rapport à la politique ou ses éventuelles divergences avec Marx ?
S. K. : Quand je disais que je prenais le contre-pied de la quasi-totalité de la littérature existante, je voulais signifier la nécessité de resituer de façon critique le jeune Engels sans pour autant partager le rejet du Engels plus tardif, et sans gommer – bien au contraire – l’originalité de sa trajectoire intellectuelle, y compris après l’indéniable tournant que représente le travail en commun avec Marx.
Il y a bien sûr des éléments de continuité chez Engels, mais ils ne vont pas nécessairement dans le sens que tu suggères, celui d’un aplatissement théorique. Engels s’est ainsi intéressé de façon soutenue à la pensée dite « utopique », mais aussi, je viens de le dire, à celle de l’urbain, à l’anthropologie, à l’histoire et tout particulièrement à celle des religions.
D’autres éléments de continuité sont par contre plus problématiques. Ainsi, sa pensée du « social » a laissé des traces, me semble-t-il, dans la conception du socialisme qu’il développe dans l’Anti-Dühring. Il y décrit le socialisme comme une économie dirigée, une réorganisation rationnelle d’une société industrielle ; il entend par là un dépassement de l’anarchie de la production capitaliste, qui prolonge le type de socialisation dont celle-ci est porteuse. Engels ne pense donc pas le socialisme, ou plutôt le communisme, comme mode de production nouveau, fondé sur des rapports sociaux révolutionnés. Tout cela a pesé d’un poids décisif dans la vision du socialisme dominante sous la IIe Internationale.
Je tiens toutefois en très grande estime l’Engels historien, que ce soit ces études sur la guerre des paysans, sur l’unification allemande comme « révolution par le haut » ou sur la famille, malgré les limites évidentes (pour nous) du matériau anthropologique dont il pouvait disposer. La contribution de l’Engels tardif me semble également originale et importante sur les questions de stratégie et de théorie politiques, loin du Engels banalement « réformiste » qu’on y voit souvent, comme Jacques Texier l’a démontré ((Cf. Jacques Texier, Révolution et démocratie chez Marx et Engels, Paris, PUF, 1998.)) en plaidant pour un Engels d’une certaine façon pré-gramscien.
Je ne partage pas non plus l’horreur que suscitent chez la plupart des « marxistes occidentaux » les écrits « philosophiques » du dernier Engels, dont on sait qu’ils ont été instrumentalisés, notamment par le biais du travail éditorial effectué sur ce « livre », La Dialectique de la nature, monté de toutes pièces par les Soviétiques pour définir les fondamentaux du diamat de l’époque stalinienne. Labica a eu, à mon sens, raison d’insister sur le caractère essentiellement réactif des interventions engelsiennes, sur le fait qu’elles visaient avant tout à s’opposer aux thèses d’un Dühring ou d’un Haeckel, et non à fonder une « philosophie marxiste ». Je suis également d’accord avec André Tosel quand il lit les textes regroupés dans La Dialectique de la nature comme une réflexion critique sur les sciences ((André Tosel, « Formes de mouvement et dialectique “dans” la nature selon Engels », in Études sur Marx (et Engels), Paris, Kimé, 1996, p. 105-138.)). Ce travail est, certes, daté par bien des aspects, et il reste pris dans la vision évolutionniste qui domine à l’époque. Il peut toutefois être lu comme une contribution au travail réflexif que les scientifiques mènent sur leur propre pratique et non comme l’ébauche d’un méta-discours logico-ontologique – en dépit de la tentation engelsienne à énoncer des « lois » universelles de la dialectique.
Ceci dit, et avec toute la prudence nécessaire qu’exigent des études plus précises que je n’ai pas encore pu mener, il me semble que ce qui se dégage malgré tout de la figure d’Engels c’est qu’il est resté par certains côtés proche de la pensée socialiste du xixe siècle dans une version disons plus standard. Sans doute ne retrouve-t-on pas chez lui la forte singularité de Marx, dont il tend parfois à réduire certains aspects novateurs. Pour citer quelques exemples, je pense que sa manière de comprendre l’ordre de l’exposé dans le Capital en termes logico-historiques n’est pas pertinente et tend à aplatir les enjeux théoriques de la structure de l’œuvre. Engels s’est également montré bien plus réticent que Marx à rompre avec l’eurocentrisme, comme l’indique notamment la façon dont il s’est positionné dans le débat sur la révolution russe. Il ne prenait pas au sérieux les indications de Marx dans ses brouillons de lettres à Véra Zassoulitch en faveur d’une voie non-capitaliste prenant appui sur les formes communautaires paysannes. Tout cela pèsera également très lourdement dans l’eurocentrisme, parfois caricatural, de la IIe Internationale.
Marx et la politique aujourd’hui
S. B. : La recherche sur Marx n’a pas cessé depuis la publication du livre. Je pense à une série de biographies, notamment celles de Francis Wheen, de Jonathan Sperber ou de Jacques Attali ((Francis Wheen, Karl Marx : A Life, Londres, Norton, 2001 ; Jonathan Sperber, Karl Marx : A Nineteenth Century Life, Londres, Liveright, 2014 ; Jacques Attali, Karl Marx ou l’esprit du monde, Paris, Fayard, 2005.)), et à une série d’études fouillées sur le jeune Marx. Dans cette catégorie, citons les travaux de Roberto Finelli, de Gareth Stedman-Jones, de Warren Breckman et de Douglas Moggach ((Roberto Finelli, A Failed Parricide. Hegel and the Young Marx, Chicago, Haymarket, 2016 (1re édition Turin, Bollati Boringhieri, 2004) ; Gareth Stedman-Jones, Karl Marx : Greatness and illusion, Londres, Allen Lane, 2016 ; Warren Breckman, Marx, The Young Hegelians and the Origins of Radical Social Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 ; Douglas Moggach (dir.), The New Hegelians. Politics and Philosophy in the Hegelian School, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.)). Avec le recul qu’autorise le temps, est-ce que cette littérature te conduit à modifier ton point de vue, à en approfondir certains aspects, ou bien cela ne change pas vraiment ta perspective ?
S. K. : Ce dont on se rend compte après coup c’est que, pour les mêmes raisons qui font qu’on ne pense jamais tout seul, on est beaucoup moins original qu’on ne le pense dans ce qu’on a pu écrire. Parmi les ouvrages que tu as cités, auxquels il convient d’ajouter les travaux français de Franck Fischbach et d’Emmanuel Renault ((Franck Fischbach, Philosophies de Marx, Paris, Vrin, 2015 ; Emmanuel Renault, Marx et la philosophie, Paris, PUF, 2013.)), je retiens surtout que même si les approches sont très diverses, les convergences avec ce que j’ai essayé de faire dans cet ouvrage sont également significatives. Tous ces travaux mettent en avant l’importance du contexte jeune hégélien pour saisir la trajectoire de Marx dans sa singularité. La plupart la situent dans son rapport au contexte politique et au croisement de la Révolution française et de la philosophie classique allemande. Dans les travaux anglophones, les plus stimulants à mon sens, on retrouve l’idée que Marx était une vraie « tête politique », et que son rapport à Hegel est d’une profondeur qui le différencie de ses interlocuteurs et concurrents. La biographie de Jonathan Sperber, la seule qui apporte des éléments nouveaux, va dans le même sens, même si Sperber verse dans le relativisme historique et fait de Marx une figure enfermée dans le xixe siècle. Même quelqu’un comme David Leopold ((David Leopold, The Young Karl Marx. German Philosophy, Modern Politics and Human Flourishing, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.)), issu de la tradition analytique oxfordienne, a fortement insisté sur le fait que c’était bien en tant que penseur du politique qu’il fallait approcher ce Marx-là. Mon travail doit donc être situé dans ce mouvement plus large de relecture de Marx.
Je pense toutefois qu’il reste une originalité dans mon approche, qui renvoie sans doute au fait qu’elle est davantage liée aux débats du marxisme français, et, plus largement, « continental » pour parler comme les Anglo-Saxons. De ce fait, les enjeux stratégiques sont davantage présents, on sort du cadre d’une discussion académique, entre lecteurs érudits. Cela n’a pas échappé aux lecteurs anglophones. Dans la revue de la vénérable American Sociology Association, l’auteur du compte-rendu consacré à mon livre, tout en reconnaissant le sérieux de ma documentation, me reproche de « brouiller les distinctions » entre, d’un côté, recherche historique et analyse de science sociale, et, de l’autre, polémique politique et construction de « mythe » visant à légitimer le radicalisme politique ((Neil McLaughlin, « Review of Stathis Kouvélakis, Philosophy and Revolution. From Kant to Marx », Contemporary Sociology, vol. 33, n° 3, 2004, p. 375-376.)). Eh bien, pour ma part, j’assume totalement ce « brouillage », synonyme de recherche engagée. Je pense que Marx ne trouverait rien à y redire.
S. B. : Pour conclure sur la dimension politique, l’atmosphère politique et intellectuelle a quand même beaucoup changé depuis les années 1990. Il y a un renouveau du travail sur Marx, qui n’est plus la figure du paria. Ce qui n’empêche pas que Marx en tant que penseur de la défaite, comme tu le soulignes dans les dernières pages de l’ouvrage, soit toujours d’actualité. Comment résumerais-tu la dimension politique de ce travail avec ce recul de dix-huit ans ?
S. K. : Il y a un fil rouge qui parcourt ce livre, c’est cette idée du rapport constitutif démocratie/révolution, on pourrait presque dire que démocratie et révolution sont à mes yeux, pour parler comme Spinoza, comme deux modes d’une même substance. Ce filon « français » chez Marx, rejoint la préoccupation centrale de ma propre trajectoire politique. L’œuvre de Nicos Poulantzas, à qui ce livre est dédié, débouche sur un vaste questionnement des rapports entre démocratie et socialisme. Ce fil rouge est également celui de la réflexion gramscienne sur l’hégémonie ou encore de celle de Lukacs, à partir des célèbres « Thèses Blum » et jusqu’à la conclusion politique de son ontologie, le texte fondamental Demokratisierung heute und morgen ((Édition française : Socialisme et démocratisation, Paris, Messidor, 1989.)).
Si je reprends cette question, pour tenter d’en renouveler les termes, c’est parce que je suis convaincu qu’elle est toujours centrale. C’est bien sûr celle que nous lèguent l’effondrement des régimes soviétiques et l’involution de l’ensemble des expériences révolutionnaires du xxe siècle. Mais c’est aussi celle que pose l’évolution du capitalisme néolibéral, qui vide de son sens toute idée de démocratie, même dans les cadres très limités qui ont existé en tant que conquêtes de très longues luttes des classes travailleuses. Aujourd’hui, il faut inverser le dicton de Poulantzas « le socialisme sera démocratique ou ne sera pas » en « la démocratie sera socialiste ou ne sera pas ». On ne peut vaincre la dé-démocratisation portée par le néolibéralisme sans poser la question du renversement du capitalisme, de l’hégémonie des classes subalternes, donc de l’activation de la tendance communiste de la lutte des classes.
Le Marx dont il est question dans cet ouvrage n’est donc pas un Marx de la défaite, c’est le Marx de l’« autocritique de la révolution », pour reprendre le titre de la conclusion. C’est le Marx qui comprend les limites de l’expérience révolutionnaire qui a débuté en 1789-1793 comme un « ratage » rétroactivement nécessaire pour que quelque chose de nouveau advienne. C’est le Marx qui conçoit le communisme comme une autocritique, toujours recommencée, de la révolution démocratique. Aujourd’hui, il est vrai qu’on serait tenté d’inverser le propos, et de faire de la démocratie le moment autocritique du communisme. Mais ce serait oublier ce que Lukacs a formulé dans ses « Thèses Blum » : il n’y a pas de muraille de Chine entre révolution démocratique et révolution socialiste. Comme le disait déjà Heine, dans une phrase que j’ai placée en exergue à l’ouvrage : « la révolution est une et indivisible ».
Cet entretien est tiré de la réédition de Philosophie et révolution. De Kant à Marx (La fabrique, 2017). Il est reproduit ici avec l’autorisation des auteurs et de l’éditeur.