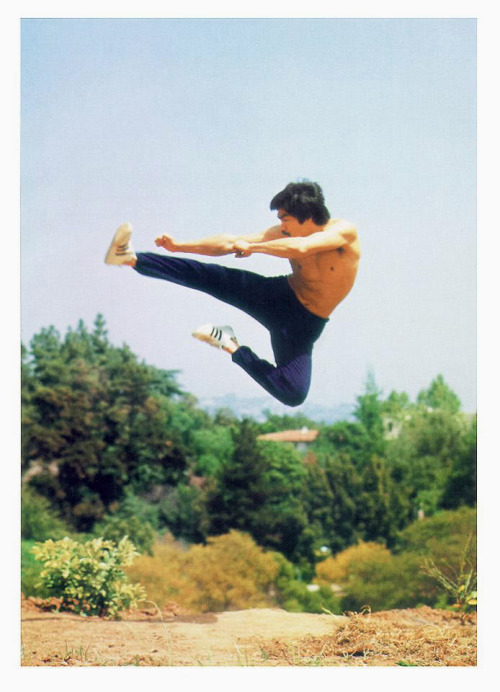Qui a mieux défini la stratégie que Clausewitz ? C’est, dit-il, l’usage du combat aux fins de la guerre. Cela signifie qu’une stratégie ordonne l’enchaînement de combats qui ont leur tactique propre, de façon à atteindre un but déterminé. Liddel-Hart, après bien d’autres, regrette que cette définition lie la stratégie à la bataille. À son avis, la stratégie ne vise pas à rompre en tous les cas par la violence une résistance (sauf celle qu’opposent les obstacles naturels) mais à diminuer la possibilité de la résistance en exploitant certaines situations comme le mouvement et la surprise. Pourtant, si l’on retient l’observation de Clausewitz : que la menace de la bataille est l’équivalent stratégique ou tactique de celle-ci — ce que nous rappelle chaque jour la politique de dissuasion nucléaire — il dévient clair qu’abattre une résistance ou détruire la possibilité de cette résistance sont aussi des équivalents.
La stratégie, ainsi conçue, est une forme d’action dont le modèle existe bien ailleurs que dans la guerre. N’est-elle pas le schéma sous-jacent de presque toutes les activités sociales ? Ne parle-t-on pas de stratégie économique, politique, sociale, religieuse même ? Ce modèle est d’ailleurs décelable aux échelles les plus différentes : la stratégie peut se développer dans de vastes sphères (terrestres, et même cosmiques aujourd’hui) aussi bien que dans des lieux et milieux restreints, sans perdre son caractère; elle s’assigne des objectifs de portée très variable : souvent lointains, mais parfois tout proches. Ne pourrait-on alors formuler une théorie générale de la stratégie, essence des actes sociaux commandés, des mouvements contradictoires qui agitent les États et les sociétés, dont l’importance et la signification furent longtemps estompés aux yeux des analystes par le caractère alternativement figé ou bouleversé que l’on imputait aux institutions et aux constitutions ? Certaines théories modernes des jeux s’efforcent en effet de ramener à quelques règles simples une science de la stratégie applicable à tous les cas possibles d’activité sociale, où plusieurs adversaires se disputent un enjeu en vertu de certaines règles, et où les décisions des joueurs font office de bataille. En tout cas les stratégies, quel qu’en soit l’objet, supposent des adversaires ou des compétiteurs aux prises, des obstacles à vaincre, un but à atteindre, et un enchaînement de tout cela ((Les vulgarisateurs de la théorie des jeux insistent sur cette extension des principes de toute stratégie. Kaufman, Faure et Le Garf, par exemple, écrivent (Les jeux d’entreprises, 1960) : « Une stratégie est une suite de décisions tenant compte de toutes les décisions passées, présentes ou futures du ou des compétiteurs. Une stratégie est, en fait, une collection ordonnée de décisions de caractère combinatoire. On ne confondra pas une décision, un plan, une politique, une tactique, une stratégie. » (p. 13).)).
S’il y a en effet des caractères stratégiques communs à toutes les grandes activités humaines, qu’il s’agisse de celles des personnes, des groupes ou des institutions, il devient intéressant de rechercher, à notre époque de ramification et d’intégration calculée de toutes ces activités, comment les facteurs sociaux influent sur l’élaboration des stratégies. Ainsi, quelle est la signification militaire des stratégies économiques et sociales d’aujourd’hui, et, à l’inverse, quel est au juste le sens social des stratégies militaires dont l’élaboration accapare actuellement l’attention des États et de leurs chefs politiques ? De ce vaste sujet nous ne retiendrons ici que le second aspect. Y a-t-il des éléments sociaux dont le rôle va croissant dans l’élaboration des stratégies de guerre ? Quels sont-ils ? Contribuent-ils à infléchir les stratégies dans un sens déterminé ? Confèrent-ils réellement aux guerres en suspens ou en cours une portée et une allure particulières que n’avaient pas connues les guerres du passé ?
Bien entendu, les grands stratèges n’ont jamais manqué de tenir compte — à toutes les époques — des données économiques et sociales dans l’élaboration et la combinaison de leurs décisions. Toutefois, jusqu’à la révolution russe d’Octobre 1917 aucun État ou chef de guerre n’avait proclamé sans ambages ses fins économiques et sociales comme « but de guerre », ni calculé expressément ses démarches en fonction de ces fins. Aucune guerre n’a été menée publiquement au nom du capitalisme, de la bourgeoisie, ou de tels de leurs intérêts partiels, alors que le socialisme s’est employé, quelquefois sans détour, et d’autres fois moins ouvertement, à proclamer ses propres fins justifiant des guerres « justes ».
Par tradition, les préoccupations que la société imposait à la stratégie se ramenaient aux bilans du recrutement des troupes, de la fabrication des armes, de l’entretien des fortifications, des ressources alimentaires et industrielles, des disponibilités financières, enfin du moral des civils et des soldats. Mais tout cela concernait les moyens de la victoire, et non les fins de la guerre. Les facteurs sociaux des conflits jouent, comme ils l’ont toujours fait, un rôle imprescriptible dans la marche des opérations stratégiques, mais l’objet final de la lutte était placé bien ailleurs, dans le domaine des idéaux politiques, philosophiques ou religieux. En ce sens les institutions militaires se comportent le plus souvent comme les autres institutions qui incarnent par définition ou hypothèse, le droit, la justice, l’honneur ou la gloire ; elles ne représentent pas ouvertement des prérogatives sociales, des appétits matériels, des intérêts économiques.
Les institutions d’État, constitutionnelles, ne sont d’ailleurs pas, à l’exception notable de l’Armée, des institutions stratégiques, car elles ne poursuivent pas à proprement parler une fin : elles sont à elles-mêmes leur propre fin; tandis que les institutions garantes d’intérêts patentés cherchent à atteindre des objectifs économiques moyennant certaines règles de comportement qui supposent la mise en œuvre d’une stratégie au sens propre. Les institutions militaires ont toutefois des traits qui les distinguent de toutes les autres institutions politiques et sociales, dont le principal est le suivant : leur fonction a un caractère latent, ou un aspect actif, selon que les États ou groupes sociaux sont en paix ou en guerre. Les phases de latence et d’activité se combinent d’ailleurs de mille manières, par exemple dans ce qu’on appelle aujourd’hui la « guerre froide», et qui n’est qu’une façon de désigner une vieille pratique : amorcer un conflit dans des conditions avantageuses sous couleur de l’éviter. La fonction latente des institutions militaires, c’est de préparer la nation (ou le groupe social) à confier son sort, le moment venu, aux forces armées qui la défendront contre un adversaire. Leur fonction active, c’est de faire la guerre, lorsqu’il faut en venir là. La stratégie militaire empruntera donc deux formes à ces deux types d’existence des institutions militaires : une élaboration en temps de paix, et une exécution en temps de guerre. C’est peut-être ce qui la distingue des autres stratégies sociales, dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à une situation aussi dramatique et explosive que le recours à la violence armée, à la destruction des biens et au sang versé. Il ne faut pas confondre cette élaboration (en période de latence) et cette exécution (en période d’activation) avec la distinction, courante en sociologie comme en économie, entre la statique et la dynamique. Il s’agit ici de phases distinctes, de deux états réels, et non d’une division analytique relevant de la méthode. C’est pourquoi une étude des facteurs sociaux de la stratégie mise en œuvre par les appareils militaires modernes devrait considérer ces facteurs au cours des deux phases séparément, et bien entendu aussi dans les états intermédiaires ou combinaisons de ces états. En période de latence, le poids et l’efficacité des facteurs sociaux doivent être estimés et appréciés tout autrement qu’en période d’activation. Pourtant, le rôle de ces facteurs doit être prévu dans les deux cas de façon solidaire. Des plans stratégiques qui ne tiendraient pas compte des transformations profondes que subissent les relations sociales au cours de l’activation guerrière se heurteraient dans l’exécution à des situations humaines impossibles à maîtriser. C’est précisément à quoi tendent les plans stratégiques de chaque antagoniste vis-à-vis de son ou ses opposants : acculer l’adversaire au désordre social et par suite à la défaite, tout en maintenant la cohésion de son propre ordre social.
Les facteurs sociaux de la stratégie ne se manifestent pas seulement selon des périodes de latence et d’activation; ils ont aussi des effets tout différents selon que la stratégie envisage une phase défensive ou offensive. Sous cet angle, les facteurs sociaux de la vie combattante sont aussi variables que les facteurs proprement psychologiques : traverser une région urbaine ou agricole au cours d’une retraite ou à la suite d’une attaque entraîne des réactions qui peuvent être de sens opposé dans les populations, qu’il s’agisse de compatriotes ou d’ennemis, de coreligionnaires politiques ou d’adversaires de classe. Napoléon remontant de Fréjus à Paris en 1814 emprunte la voie des Alpes républicaines et non la vallée du Rhône royaliste. Trotsky prépare en 1919 une offensive contre Denikine à travers le Donetz prolétarien et non dans les steppes cosaques du Kouban. Ce sont deux exemples où une stratégie offensive est conçue par référence à des préoccupations politiques et sociales estimées prioritaires. Quant à la défensive, les retraites russes de 1812 et de 1941 restent l’exemple de manœuvres appuyées sur les profondeurs paysannes du pays plutôt que sur des bastions urbains. Les guérillas statiques, les harcèlements qui ne sont ni offensifs ni défensifs, s’accommodent aussi de terrains sociaux variés, denses ou raréfiés selon les cas, grandes villes ou montagnes peu peuplées. Dans les pays bilingues ou multi-ethniques, une partie de la population sert à tenir l’autre : Flamands contre Wallons en Belgique, Hongrois contre Tchèques dans l’ancienne Autriche-Hongrie, Mandchous contre Chinois dans la Chine antique, etc.
De nos jours, les éléments sociaux que peut impliquer l’élaboration des stratégies, latentes ou actives, défensives ou offensives, ne se laissent pas manier aussi lâchement que par le passé. La sociologie des théâtres de guerre potentiels est d’ailleurs mieux connue, bien que les directives qu’on en puisse tirer soient fort sujettes à contestation. Certains critiques militaires estiment par exemple que l’excès relatif de population en Chine serait un élément de succès pour ses ennemis; les populations chinoises pourraient être plus facilement réduites à la famine par les moyens modernes de destruction des récoltes, de pollution des eaux, de contamination de l’atmosphère, de perversion des climats. D’autres soutiennent au contraire que les réservoirs humains, inépuisables malgré leur misère, permettent une résistance plus durable, gage inévitable de victoire. On voit quelles redoutables alternatives pose la considération du seul paramètre démographique.
Ajoutons que la stratégie est liée à l’exploitation de trois grands domaines en dépendance mutuelle, mais qu’il faut nettement distinguer au point de vue technique : les terres, les mers et les airs (atmosphère, stratosphère et espace cosmique). La distinction de ces trois domaines est légitimée, du point de vue social, par l’écologie humaine particulière qui leur est associée. En effet, les terres sont par nature des régions de peuplement stable. Les mers ne sont occupées par l’homme que temporairement, et d’ordinaire en mouvement. Quant à l’espace atmosphérique ou cosmique, il ne peut qu’être traversé à grande vitesse. Les mers et les airs seraient-ils un jour habités, ce ne serait qu’épisodiquement, et par fort peu de gens. Sur terre, les structures sociales prennent tout leur relief; sur mer elles affectent des formes étroitement limitées par les relations entre équipage de navires ou par la cohabitation sur chaque navire; dans les airs, leur allure est tout à fait fugace, car elles ne peuvent se manifester que dans des populations d’une ténuité extrême. La distinction de ces domaines physiques se ramène d’ailleurs à une combinaison dont le sol détient toujours la clé. En effet, les navires, les avions ou les fusées doivent partir, jusqu’à présent tout au moins, de bases terrestres. Les populations à terre détiennent ainsi le contrôle, à plus ou moins lointaine distance ou échéance des mouvements de tous les véhicules qui se détachent du sol. Cette relation technique entre les trois domaines physiques essentiels dont la stratégie doit tenir compte aujourd’hui souligne la signification permanente dont les structures sociales sont chargées comme conditions humaines de la guerre. C’est pourquoi les remarques que nous ferons plus loin sont dans une large mesure indépendantes du domaine géographique, atmosphérique ou cosmique envisagé. Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, ou de leur combinaison, il faut bien en fin de compte en revenir à l’action des groupes humains là où ils forgent les armes, élaborent les stratégies et décident de leur mise en œuvre, c’est-à-dire avant tout sur terre.
Essayons maintenant de classer quelques-uns des grands facteurs sociaux qui pèsent aujourd’hui sur l’élaboration des stratégies, sans nous référer d’ailleurs expressément à l’un ou l’autre des grands « camps » qui divisent militairement le monde actuel, ni aux diverses coalitions assez fluides qui leur sont plus ou moins subordonnées.
Mais il faut auparavant préciser ce que nous entendrons ici par facteurs, ou mieux: arguments sociaux. Il s’agit des arguments qui découlent de la prise en considération, dans la préparation et l’exécution d’un plan stratégique, des structures sociales. Ces arguments excluent donc les éléments proprement techniques, et ceux qui relèvent de l’économie au sens étroit, tout comme ceux que l’on considère habituellement comme psychologiques, encore que ni les uns ni les autres ne soient étrangers aux fonctions sociales elles- mêmes. Nous employons le terme d’argument plutôt que celui de facteur, parce qu’il paraît mieux désigner l’emploi de certains éléments prévisionnels qui entrent dans l’élaboration d’une stratégie. L’efficacité d’un « facteur » social suppose une causalité directe qui n’appartient pas à l’essence de la stratégie. Par contre l’argument est l’élément qui justifie, plutôt qu’il ne cause ou détermine, la décision stratégique où domine la téléologie, le souci du but à atteindre par un enchaînement approprié des mesures à prendre. Nous dirons donc que les éléments sociaux entrent dans la stratégie comme arguments, sans craindre de heurter une opinion établie. Nous pourrions aussi justifier cet usage par la remarque suivante : en stratégie, les facteurs sont avant tout les éléments d’une combinaison, et c’est à ce seul titre que leur effet se trouve déterminé et déterminant. Par exemple, la composition sociale des troupes et le mode de formation qui a été le leur sont des éléments, ou facteurs, qui peuvent entrer dans l’élaboration d’une combinaison stratégique ou tactique, par leur côté latent. Mais une fois entrés en action, en fonction du but poursuivi, ces facteurs deviennent des arguments déployés au cours de l’action réciproque entre les deux adversaires dont le jeu logique décidera de l’issue du conflit. La distinction que nous introduisons entre facteur et argument dépend donc pour une part significative des transformations que subit la stratégie entre sa phase latente et sa phase active : de l’une à l’autre le facteur devient un argument. En termes de propagande, cette modification illustre le passage du « qui nous sommes » au « pourquoi nous combattons », des moyens sociaux de la guerre aux buts sociaux de celle-ci.
Les arguments que nous allons très brièvement passer en revue, ainsi conçus, sont loin d’être limitatifs. De plus, c’est leur combinaison, plutôt que leur singularité, qui en fait toute l’importance relative. Toutefois, cet aspect de la sociologie des stratégies guerrières d’aujourd’hui n’ayant jamais été clairement abordé, il ne sera pas inutile de procéder à un recensement préalable de quelques concepts analytiques susceptibles d’expliquer la formation des concepts stratégiques synthétiques eux-mêmes. Nous limiterons notre examen à huit concepts principaux : ceux d’adversaire, de but de guerre, de manœuvre et opération, de bataille, de potentiel, de gain, de coût et de décision.
1. Le concept stratégique essentiel est celui d’adversaire. Toute stratégie définit un adversaire social, souvent sans l’admettre. C’est en fonction de la nature et de la position de l’adversaire désigné que le plan stratégique s’articule : traditionnellement (tout au moins depuis la Révolution française en Europe), l’adversaire était qualifié politiquement. Aujourd’hui, la qualification politique ne s’entend plus sans une qualification sociale. Même les stratèges qui répugnent à ces qualifications se voient obligés d’en tenir compte dans leurs plans. L’adversaire « rouge », « impérialiste », ou « neutraliste » offre toujours aux manœuvres d’un belligérant une structure sociale dans laquelle il doit insérer ses leviers. Cette structure ne se présente pas seulement sous la forme d’une idéologie : elle offre un certain champ de relations humaines. Ce que la stratégie envisage, c’est l’action sur ces relations, tout autant qu’un effet direct sur l’État. Plus exactement, la stratégie cherche à susciter un déchaînement des éléments, qui assurent la stabilité simultanée de l’État et de la société adverses. Cette conception s’accorde avec la théorie du perturbateur (mise en avant par l’amiral Castex) : stratégiquement, chaque belligérant s’efforce de désigner l’adversaire comme le perturbateur de l’ordre qui prévaut chez lui-même, et de l’attaquer comme tel. La désignation du perturbateur (le « meneur » des luttes sociales) vise à isoler les structures sociales les plus vulnérables, qui peuvent être de nature économique et professionnelle, raciale, gouvernementale ou même religieuse, tout autant que militaire. En tout cas, la vertu essentielle d’une désignation stratégique de l’adversaire consiste à concentrer sur celui-ci le maximum de forces contraires efficaces.
Le changement d’adversaire au cours d’une guerre, et par suite la modification de l’argument social en stratégie, se présente toujours comme une opération délicate. Il entraîne des modifications dans l’opinion, comme par exemple lorsque la Prusse continua, contre la République, une guerre victorieuse contre le Second Empire en 1870, ou lorsque l’Allemagne hitlérienne, après avoir assailli les États d’Europe occidentale en 1938-39, se retourna contre l’U.R.S.S. en 1941. Plus l’envergure du conflit latent est grande, plus la désignation de l’adversaire social est complexe et variable (et du même coup souvent confuse). Dans les guerres locales et subordonnées, en particulier les conflits coloniaux et les guerres civiles, la désignation de l’adversaire n’est pas plus facile, pour d’autres raisons : la pulvérisation des conflits accroît souvent la confusion sociale (exemples récents : le Vietnam, Chypre ou l’Algérie).
2. Au concept d’adversaire s’associe celui de but de guerre, qui ne lui est pas identique. L’adversaire est une collectivité humaine, ou une fraction de celle-ci. Le but de guerre est l’objet que les deux adversaires se disputent, c’est-à-dire ce que chacun d’eux entend substituer à l’existence sociale de l’autre. Il ne s’agit donc pas forcément d’un objet physique. Anéantir des colons ou éliminer la colonisation ne sont pas une seule et même chose. Détruire une administration et instaurer un ordre social nouveau sont deux choses différentes. Les U.S.A. et l’U.R.S.S. ont affronté cette différence entre adversaire et but de guerre après 1945 en Allemagne, au Japon, en Pologne, en Yougoslavie et dans bien d’autres régions. L’adversaire abattu par les armes laissait pendante la question des buts de guerre. La stratégie sociale, en effet, ne se limite pas à la destruction de l’adversaire : encore faut-il préciser ce qu’on entend faire d’une collectivité sociale réduite à merci. On peut admettre en effet que les bouleversements sociaux consécutifs à la fin des hostilités sont en rapports étroits avec la crise des structures sociales qui avaient motivé les hostilités. Il reviendrait alors à la sociologie des stratégies d’éclairer le genre d’écarts qu’entraîne, dans les rapports sociaux, le rétablissement de la paix par rapport aux buts de guerre initiaux. On verrait que la désignation sociale de l’adversaire y joue un rôle prépondérant. Stratégiquement, tout but de guerre social implique la mise en place, au cours même des opérations, d’éléments d’un pouvoir social nouveau chez l’ennemi. C’est là une caractéristique des guerres modernes, bien qu’on en trouve toute sorte d’équivalents dans le passé. La notion opérationnelle qui correspond au but de guerre est celle de centre de gravité. Le centre de gravité peut fort bien prendre un caractère nettement social ((C’est ce qui se produit en particulier dans les conflits coloniaux et révolutionnaires. En voici un exemple typique : « Pour réduire [les Kabyles] il faut attaquer leurs intérêts. On ne peut y parvenir en passant comme un trait; il faut s’appesantir sur le territoire de chaque tribu; il faut s’arranger pour avoir assez de vivres pour y rester le temps nécessaire pour détruire les villages, couper les arbres fruitiers, brûler et arracher les récoltes, vider les silos, fouiller les ravins, les rochers et les grottes, pour y saisir les femmes, les vieillards, les troupeaux et le mobilier; ce n’est qu’ainsi que l’on peut faire capituler ces fiers montagnards. Si l’on se contente de suivre une ou plusieurs routes, on ne verra que les guerriers, on combattra avec plus ou moins d’avantage, mais on n’atteindra ni les populations, ni les richesses, et les résultats seront presque négatifs. » Maréchal Bugeaud. De la stratégie, de la tactique…, 1842. (Œuvres militaires, 1883, p. 91).)).
3. L’adversaire et le but de guerre étant fixés, au moins dans leurs grandes lignes et sous réserve de modifications du plan stratégique, ce sont la manœuvre et les opérations qui constituent la notion essentielle à retenir. Les théoriciens de la stratégie ont généralement ramené cette notion à une alternative purement militaire entre stratégie à objectif total ou à objectif limité (Clausewitz), ou entre stratégie d’anéantissement et d’usure (Delbruck), ou directe et indirecte (Liddel-Hart) . Toutefois, si l’on met au premier plan l’argument social, la stratégie incline à l’objectif limité, à l’usure, au style indirect. L’utilisation de forces sociales chez l’ennemi, la pression différentielle sur ses différentes classes, la perspective de transformations sociales et économiques consécutives à la victoire, conduisent en effet à rechercher la manœuvre qui atteindra le but aux moindres frais sociaux. La difficulté consiste alors à envisager des transformations sociales tout en respectant certaines structures déjà établies : la guerre, qui provoque le chaos, ne s’accommode cependant pas du chaos.
À cet égard, l’appréciation de la résistance et de la cohésion opposées par les structures sociales traditionnelles nécessite des études poussées. Cette appréciation soulève une question sociologiquement capitale : quelle est la hiérarchie de force des institutions sociales attaquées ? D’où : dans quel ordre doivent-elles être ébranlées par le plan stratégique ? Et dans quel ordre doivent- elles être amenées à résister au plan ennemi ? Hitler s’est heurté à un problème de ce genre lors de la pénétration allemande en U.R.S.S. : fallait-il détruire sans délai les kolkhozes, abolir la propriété d’État ? Napoléon avait connu la même hésitation : il ne tenta même pas de libérer les serfs en 1812.
4. L’exécution d’un plan stratégique suppose des combats et des batailles, dont l’issue pèsera toujours sur le déroulement du plan. L’argument social ne se manifeste pas seulement ici dans la capacité de combat des troupes directement engagées dans le duel physique. De nos jours, les batailles sont un processus qui se déroule en profondeur dans le temps et dans l’espace, et non un coup de dés joué en un ou deux jours. L’alimentation de la bataille, la logistique générale des combats, l’exploitation du succès, supposent l’engagement de groupes sociaux (en particulier de travailleurs professionnels de tous ordres), dont l’action échelonnée doit être minutieusement mise au point. Les problèmes posés sont de nature encore plus sociale que psychologique; ils ne peuvent être correctement résolus que moyennant une connaissance détaillée de la nature et de la composition sociale des troupes à pied d’œuvre, mais aussi des relations existant entre les divers éléments de ces troupes et leur support logistique externe. La situation relative et réciproque de « l’arrière » et de « l’avant » manifeste clairement l’état de ces relations. Le polymorphisme des combats reflète alors sous bien des aspects celui des conflits sociaux dans lesquels ils baignent.
5. La cinquième notion à envisager est celle de potentiel, c’est-à-dire de la qualité et de la quantité des ressources mobilisables de toute nature. L’importance croissante accordée au potentiel, à son entretien et à sa protection, souligne l’intrusion toujours plus profonde de l’argument social dans la stratégie. De la notion de potentiel dérive celle des « réserves », humaines au premier chef. Les réserves ne sont pas seulement celles qui fourniront des combattants; ce seront aussi bien — et surtout — celles où se recrutera la population apte au travail orienté vers la guerre. La stratégie des réserves humaines entraîne une action préventive sur les différentes catégories de la population, et par conséquent un effet sur les structures sociales elles-mêmes. Les modifications que l’exécution stratégique provoque dans ces structures ne peuvent être improvisées. Aussi bien l’État se préoccupe-t-il, dans le cadre de la stratégie latente, de prévoir les altérations qu’apporte l’ouverture du conflit aux structures sociales fondamentales : celles qui règlent les rapports de travail, la vie des familles, le fonctionnement des institutions locales et régionales, l’enseignement, le ravitaillement. Bien entendu, le phénomène des pertes (surtout en prévision des attaques nucléaires) entre aujourd’hui comme une grandeur décisive dans le calcul stratégique des réserves; la dimension des pertes estimées peut entraîner certaines métamorphoses des structures sociales fondamentales, un peu comme une grève générale agira sur l’ensemble des structures de travail d’un pays donné.
6. Deux concepts interviennent ensuite : ceux de gain et de coût. À cet égard, les principes militaires ressemblent à ceux qui gouvernent les jeux industriels et économiques selon les techniques de la « recherche opérationnelle », d’autant mieux qu’ils sont à l’origine de ces jeux. La perspective du gain entre dans la détermination du but de guerre et de l’adversaire; stratégiquement, sa valeur propre se présente sous la forme d’un enjeu. On observe à cet égard un glissement, depuis deux siècles environ, depuis les préoccupations territoriales et politiques vers les ambitions sociales. La grande stratégie n’a plus que rarement comme but avoué l’annexion de terres étrangères oui l’extension du territoire national; elle ne vise pas non plus un simple renversement du régime politique de l’ennemi (par exemple la substitution d’une République à une Monarchie ou d’une « Démocratie populaire » à une République). Elle vise de plus en plus franchement la défense ou l’extension de structures sociales liées à certains rapports économiques. Si même elle met en avant un enjeu de caractère territorial, politique, religieux, ou même racial, c’est le plus souvent pour éviter de préciser la nature sociale qui s’y dissimule. L’enjeu social lui-même peut se présenter sous de multiples formes, mais il est constant que les rapports de travail en constituent le noyau. Les guerres antiques avaient comme enjeu la soumission de peuples, c’est-à-dire le travail potentiel de nouveaux esclaves. Les guerres d’aujourd’hui cherchent une fin dans l’instauration de nouveaux régimes de travail et d’appréciation de leurs fruits, que ce soit sous l’emblème de la liberté, du nationalisme, de la démocratie, du fédéralisme ou du socialisme. Cet enjeu, pour n’être pas toujours le plus apparent, est pourtant celui qui finalise les stratégies à long terme dans un monde qui conçoit son évolution sur le modèle de la « croissance économique ». Le gain envisagé ne peut être le simple solde d’un bilan où les pertes et destructions figureraient d’un côté, et les acquisitions, le butin, de l’autre. Il faut que les bouleversements provoqués chez le vaincu offrent la possibilité d’instaurer un régime de travail (avec toutes ses conséquences économiques et sociales) que le vainqueur estime favorable ou supérieur. C’est la raison pour laquelle certains auteurs (en particulier F. Sternberg) estiment — à tort selon nous — que l’ampleur prévisible des pertes humaines et industrielles dans la guerre nucléaire annulent tous les gains possibles, et du même coup suspendent ou interdisent le conflit dans la perspective d’une stratégie rationnelle.
7. L’estimation du coût, de son côté, déborde évidemment les simples paramètres économiques ou financiers. « L’économie des forces », principe stratégique classique, conduit ici à l’argument social qu’est « l’économie des forces productives ». L’appareil technique de production n’est rien sans une mise en œuvre appropriée par des masses humaines fortement structurées. Le rôle majeur qui revient aux ingénieurs et techniciens dans cette mise en œuvre n’amoindrit en rien l’importance des fonctions exécutrices de masses ouvrières différenciées au maximum. Le coût probable optimum d’une stratégie s’évalue donc en fin de compte selon l’économie des forces humaines qu’elle nécessitera. D’où les problèmes aujourd’hui classiques de la mobilisation industrielle, de la formation de spécialistes militaires, du renouvellement et des allocations de la main-d’œuvre, avec tout ce qui en découle dans les domaines les plus variés des relations sociales. L’exécution du plan stratégique fera alterner des phases de tension et des phases de relâchement dans l’application des forces sociales aux productions prioritaires en cas de guerre. Le rendement de cette application ne peut, cela va de soi, dépendre des mêmes critères qu’en temps de paix, et c’est justement pour cela que revient aux stratèges la mission d’en estimer le coût selon diverses variantes. De trop graves erreurs de calcul, dans la période finale d’un conflit plus encore que dans sa phase initiale, conduisent à de telles perturbations dans l’économie des forces, que son coût pèse enfin de façon complètement négative dans la balance du destin. Tel fut le cas pour les forces hitlériennes à partir de 1943.
8. Peut-on considérer la décision comme un argument social de la stratégie ? D’un point de vue général la décision est un moment de toutes les activités humaines et sociales; elle suppose un choix, et surtout l’exécution pratique des modalités d’action choisies. En guerre comme ailleurs, la décision est d’autant plus lourde de conséquences que l’enjeu est gros et que ses effets sont irréparables. Mais c’est en stratégie beaucoup plus qu’en tactique que la décision revêt ces caractères. Sociologiquement, le point important est donc de savoir comment s’élabore le pouvoir de décision et qui le détient, c’est-à-dire quels groupes ou institutions en disposent et l’appliquent, et comment. Là encore, les éléments spécifiquement politiques et militaires de la genèse des stratégies en masquent souvent l’armature sociale. L’expérience récente indique cependant, et dans tous les pays du monde, qu’une vigilance de plus en plus alerte s’exerce sur la structure et la signification sociale des centres de décision en matière stratégique. Les remaniements incessants de la structure des gouvernements, des partis dirigeants, des états-majors et des hauts commandements militaires sont en partie l’effet de cette vigilance. Si les décisions stratégiques ne sont pas acceptées et comprises par les groupes sociaux les plus étroitement intéressés, il y a de fortes chances pour que leur exécution se heurte à des obstacles qui peuvent l’entraver ou la mettre en péril. À ce point de vue la haute stratégie recherche, dans des conditions de tension exceptionnelle, l’instauration d’équilibres sociaux analogues à ceux qui permettent en temps de paix l’exercice du pouvoir gouvernemental lui-même. La concentration extrême des pouvoirs en temps de guerre ne supprime pas cette nécessité bien qu’elle en estompe ou vicie les formes et les manifestations pour un certain temps. Et lorsqu’il se produit un relâchement ou même une dissolution des centres de décision militaires, il apparaît alors qu’ils ne sont pas seulement l’effet d’erreurs, de revers, ou de défaites : leur ébranlement annonce sans équivoque la perturbation des relations sociales cristallisées par l’état de guerre, et par suite l’apparition possible de nouvelles relations qui permettront le retour à l’état de paix fondé sur de nouveaux équilibres. Il serait aisé d’illustrer l’argument social de décision en stratégie par l’évolution des objectifs stratégiques fixés de part et d’autre en Algérie.
Les différents arguments sociaux de la stratégie que nous venons de passer en revue présentent-ils des traits vraiment neufs ? À certains égards ils sont de tous les temps, comme les principes militaires de la stratégie eux- mêmes. Ils prennent cependant un relief inconnu jusqu’à présent, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les chefs militaires et les gouvernements se préoccupent aujourd’hui de sociologie après avoir mis à contribution la psychologie. Définissant la guerre comme « la continuation de la politique par de nouveaux moyens, sanglants », Clausewitz visait à la fois la politique extérieure et intérieure. Aujourd’hui, on peut dire que politique intérieure et extérieure se confondent dans la politique sociale; c’est d’ailleurs le sens visé par Clausewitz, comme on le voit dans ses analyses de la politique militaire de la Révolution française et de Bonaparte. En définitive, aucune stratégie de grande portée ne peut être élaborée aujourd’hui sans la contribution de ce que nous appelons des arguments sociaux. C’est ce qui rend cette stratégie si redoutable. Les arguments techniques et purement militaires seraient-ils seuls en cause, il deviendrait sans doute plus facile de démontrer l’inanité de certaines stratégies où la prévision des pertes l’emporte sur le calcul des gains, où l’enjeu n’est plus la victoire mais la destruction, où le moyen cesse d’être dominé par la fin. Mais ces arguments se trouvent maintenant surdéterminés par des arguments sociaux, et ceux-ci semblent avoir un privilège encore plus exclusif que les arguments psychologiques. L’argument social est en effet lié, plus que d’autres, à ce qui fait la tenue, la cohésion, la force des États et des sociétés, c’est-à-dire ce que tout groupe social est le moins enclin à céder de bon gré, ou à s’adjuger sans y mettre le prix. La violence est devenue le ressort des arguments sociaux dans la même époque où elle affaiblissait ses manifestations dans le domaine psychologique ou politique. Tant que les relations entre États, classes ou sociétés resteront fondées sur des tensions et des antagonismes, il est dès lors inévitable que les stratégies visent au premier chef le bouleversement du contenu social de ces relations.
En ce sens la stratégie, sous ses aspects sociaux, déborde de loin les préoccupations classiques de la géopolitique, dans l’acception que lui ont donnée par exemple Haushofer ou Mahan. La géopolitique a manié des concepts d’origine géographique, ou tiré d’une « psychologie des peuples » assez sommaire, comme ceux d’espace, de frontière, d’expansion, d’autarchie, etc. Son expression la plus intéressante se trouve dans les thèses de Mahan. C’est d’ailleurs dans le domaine géographique que la géopolitique a fourni sa contribution la plus efficace. Sa « psychologie des peuples », par contre, pénétrée de vagues généralisations sur l’esprit des races, sur le sentiment national, le respect de la force ou la crainte du châtiment, n’a conduit ceux qui s’y sont fiés qu’à de profondes erreurs (dont on pourrait citer comme exemples récents les affirmations du genre : « le chinois n’a jamais été soldat », ou « le musulman ne respecte que la force »). Sous cet angle, on assiste aujourd’hui à l’effacement des thèmes « sociaux » de la géopolitique devant l’étude plus sérieuse des structures sociales et économiques. Deux ordres de questions se poseront donc désormais aux stratèges (qui inclueront par conséquent des sociologues) : d’abord, comment notre structure sociale peut-elle favoriser l’exécution d’un plan de guerre, et comment le plan de guerre peut-il ébranler la structure sociale de l’adversaire ? Ensuite : quelles transformations sociales peut-on escompter d’après l’issue de la guerre chez le vainqueur et chez le vaincu ?
Il va de soi que de tels raisonnements supposent que la guerre reste au moins possible… Mais il n’était pas dans notre objet d’examiner ici comment elle pourrait, du moins à brève échéance, devenir superflue, seule façon de la rendre vraiment impossible.
Note bibliographique :
Nous avons abordé certains des thèmes évoqués plus haut dans les écrits suivants :
La guerre du Vietnam, Paris, Éditions de la Revue Internationale, 1948.
La Chine future, Paris, Éditions de Minuit, 1951.
« La guérilla dans la guerre moderne », Observateur, septembre 1950.
« La guerre nationale d’après Engels, Blanqui et Bakounine », Revue internationale, octobre-décembre 1950.
« Le travail et la guerre », Cahiers internationaux de Sociologie, 27, 1959, pp. 27-53.
« Clausewitz et la théorie de la guerre », introduction à Clauswitz, С von. De la guerre, Paris, Ed. de Minuit, 1955.
« La guerre psychologique et le rôle économique de l’Armée », Tribune marxiste (6), mai 1959.
Les ouvrages suivants apportent d’importantes contributions à notre sujet :
Mahan, Alfred T., The influence of sea-power upon history, 1889 (réimpression New York, Sagamore Press, 1957).
Rougeron, С., La prochaine guerre, Paris, 1948.
Earle, E.M. Makers of modern strategy, Princeton, Princeton University Press, 1944.
Liddel Hart, Basil H. Strategy. The indirect approach, New York, Praeger, 1954.
Kissinger, Henry A., Nuclear weapons and foreign policy, New York, Council on Foreign Relations, 1957.
Garthoff, Raymond L., Soviet strategy in the nuclear age, New York, Praeger, 1958. Pokrovsky, G.L., Science and technology in contemporary war, New York, Praeger, 1959. (traduit du russe)
Sternberg, Fritz, Die militärische und die industrielle Revolution, Frankfurt, 1958. (Traduction anglaise : The military and industrial revolution of our time, New York, Praeger, 1959.)
Texte initialement paru sous le titre « les arguments sociaux de la stratégie » in, Revue française de sociologie, 2-2, 1961, p. 4-14.