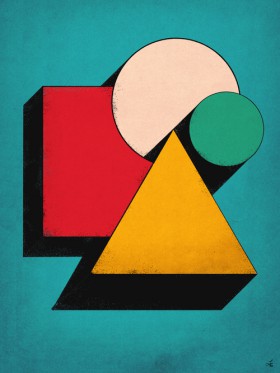Introduction
Quel qu’en soit le sujet, cerner de manière définitive une approche marxiste n’est pas chose aisée. Le marxisme est une tradition turbulente, traversée de scissions, de désaccords et de ruptures qui portent souvent sur la possibilité même de nommer « marxiste » la position adverse. On doit cette effervescence en grande partie au fait que la théorie marxiste n’est jamais pure théorie, mais se conçoit au contraire comme un guide pour l’action lourd de conséquences tactiques, stratégiques et politiques.
S’il en va de même pour la théorie marxiste du droit, un second problème surgit néanmoins (en réponse apparemment au premier) quant au relatif manque d’attention des marxistes pour les questions directement juridiques. Ainsi, les écrits de Marx et Engels ne manifestent quasiment aucun intérêt systématique pour le droit, mais y font au contraire référence dans des fragments dispersés. Ce constat se renforce pour le droit international, dont la forme « moderne » n’a été cristallisée que vers la fin de leur vie. Le marxisme ne se réduit bien entendu pas aux écrits de Marx et Engels, et un certain nombre d’auteurs de la tradition a tenté d’articuler les théories marxistes au droit en général et au droit international en particulier. Néanmoins, en comparaison des travaux sur l’économie politique, l’esthétique ou la politique, les études marxistes du droit sont restées relativement rares, et ce d’autant plus concernant le droit international.
À ces difficultés s’ajoute une dernière qui tient à l’impossibilité d’identifier « les théories marxistes du droit international » comme une « entité indépendante » de l’ensemble des exigences théoriques (et politiques) du marxisme. Alors qu’un partisan du positivisme juridique n’est pas nécessairement attaché à une compréhension plus générale du développement historique ou du rapport entre économie et société, il n’en va pas de même si l’on décide d’adopter une approche marxiste des théories du droit international. Une telle approche ne peut pas être définie uniquement comme une « position interne » au champ du droit international, mais résulte au contraire de l’application propre à ce champ de l’ensemble du projet scientifique du marxisme.
À ce titre, on ne peut saisir les théories marxistes du droit international qu’en relation avec un certain nombre de débats théoriques et de positions internes à l’ensemble de la tradition marxiste. Les débats « généraux » sur la relation entre « base » et « superstructure » (ou entre production et formes sociales), la nature et la fonction de l’État, les théories de l’idéologie, de l’hégémonie et de la domination, sont à cet égard particulièrement importants. À l’origine, ces débats ont porté sur les théories marxistes du droit « interne », sur lesquelles il nous faudra donc revenir également. De même, dans la mesure où nous analysons la théorie du droit international, il s’impose de rendre compte des discussions qui ont porté sur les dynamiques spécifiques au capitalisme international, généralement rangés sous la catégorie « impérialisme ».
Nous essaierons dans cet article de nous frayer un chemin à travers ce territoire composite. Nous commencerons par esquisser les grands contours théorique du marxisme et par examiner les travaux de Marx et Engels sur le droit, avant d’en venir ensuite aux théories marxistes de l’impérialisme et à leur conception du droit international. Nous aborderons enfin la théorie marxiste du droit international dans sa spécificité, pour conclure sur quelques remarques politiques.
Marx et Engels
La base, la superstructure et le matérialisme historique
Comme le note Susan Marks, « adopter le marxisme, c’est, avant tout, adopter l’idée que l’histoire doit être saisie d’un point de vue matérialiste » (Marks 2008, 2). En effet, le matérialisme historique et dialectique a souvent été vu comme la « méthode marxiste ».
La question de la nature précise du matérialisme historique a été l’objet de discussions longues et compliquées, mais le point de départ commun reste la « Préface » de la Contribution à la critique de l’économie politique de Marx. Dans ce texte, Marx affirme que les « les rapports juridiques – ainsi que les formes de l’État – ne peuvent être compris ni par eux-mêmes, ni par la prétendue évolution générale de l’esprit humain, mais prennent au contraire leurs racines dans les conditions matérielles d’existence » (Marx 1972, 18).
Chez Marx, les « conditions matérielles d’existence » font référence à un ensemble très précis de rapports sociaux. Au sein de la production, « les hommes n’agissent pas seulement sur la nature, mais aussi les uns sur les autres [et à cette fin], ils entrent en relations et en rapports déterminés les uns avec les autres » (Marx 1966, 28). Dans leur totalité, ces rapports de production constituent « ce qu’on appelle les rapports sociaux, la société, et, notamment, une société à un stade de développement historique déterminé » (Marx 1966, 27). C’est sur cette base que les rapports juridiques, politiques et culturels émergent :
[…] dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté […]. L’ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s’élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociales déterminées (Marx 1972, 18)
Cette description spécifique – progressivement identifiée à la métaphore de la base matérielle (ou de l’infrastructure) et de la superstructure – a été la source de nombreuses controverses au sein du marxisme. Elle a néanmoins servi de principe fondamental pour ceux qui ont cherché à saisir en quoi le droit était déterminé par les rapports sociaux de production, et à le situer dans le contexte plus vaste des structures politico-économiques.
La « structure économique » n’est pas seulement un concept abstrait aux yeux de Marx et Engels. Au contraire, ils affirment que la nature des rapports économiques se transforme « avec la modification et le développement des moyens de production matériels » (Marx 1966, 27). Dans ses différents degrés, le développement des forces productives fait parvenir les sociétés « à un stade de développement historique déterminé, [et engendre] une société à caractère distinctif original » (Marx 1966, 27). Les sociétés antique, féodale ou bourgeoise en sont autant d’exemples. Chacune d’elles possède une logique interne à part entière, qui en conditionne les causes et les modes de production et de consommation comme la manière dont elle se reproduit.
Bien que l’importance de la co-variation des rapports de production en fonction des forces productives fasse l’objet d’un désaccord, les marxistes se sont généralement intéressés, à l’instar de Marx et Engels, à la manière dont les différents modes de production étaient déterminés par des logiques spécifiques. Le Capital (comme la majorité des écrits d’économie politique de Marx) est ainsi une tentative de déconstruire la logique du mode de production capitaliste ; de la même manière, d’autres marxistes ont essayé d’analyser et d’expliquer les logiques des modes de production capitaliste et pré-capitaliste.
Il faut noter que, pour Marx et Engels, ces logiques spécifiques font émerger des configurations tout aussi spécifiques au niveau de la superstructure, ce qui ne signifie pas – cela est essentiel – que la « structure économique » est toujours manifeste et constitue l’élément majoritairement déterminant dans n’importe quelle société, mais plutôt qu’elle est un point de départ indispensable pour identifier les types de rapports sociaux prédominants :
[…] suivant un journal allemand-américain, cette opinion est juste pour le monde moderne dominé par les intérêts matériels mais non pour le Moyen-Âge où régnait le catholicisme, ni pour Athènes et Rome où régnait la politique. […] Ce qui est clair, c’est que ni le premier ne pouvait vivre du catholicisme, ni la seconde de la politique. Les conditions économiques d’alors expliquent au contraire pourquoi là le catholicisme et ici la politique jouaient le rôle principal (Marx 1969)
Marx et Engels n’en sont pas restés à une conception naïve des structures économiques comme entités statiques gouvernées par des « lois ». Pour autant qu’elles désignent des rapports sociaux précis, ces structures sont aussi des rapports entre individus, et en particulier, des rapports entre classes. Depuis la fin de la société « communiste » primitive, une division s’est imposée entre les individus qui sont partie prenante de la production de la richesse sociale, et ceux capables de se l’approprier par la possession des moyens de production, la coutume ou la pure violence. Ainsi, pour simplifier grossièrement, retrouve-t-on les esclaves et maîtres des sociétés antiques ; les paysans, la bourgeoisie marchande naissante et les seigneurs des sociétés féodales ; les travailleurs et capitalistes des sociétés capitalistes. Ces classes existent en opposition : telle est la logique de n’importe quel mode de production. Elles s’opposent à travers des luttes internes à la société, qui parfois mettent ouvertement en jeu la nature de son mode de production. D’où la fameuse maxime de Marx et Engels : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes de classes » (Marx et Engels 1972, 6). C’est à travers la superstructure politique, juridique et culturelle que « les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu’au bout » (Marx 1972, 18).
À ce stade, la conception marxiste du matérialisme historique définit deux types de phénomènes par lesquels la « structure économique » agit sur le droit, et que l’on peut appeler, pour schématiser, « structure » et « agentivité ». D’un côté, prime la logique d’un mode de production donné qui vient à produire des configurations et des formes sociales distinctes, à l’instar du droit. De l’autre, ce sont les luttes des classes, quotidiennes comme « révolutionnaires », qui sont exprimées à travers le droit et agissent dessus en retour. On peut résumer l’histoire de la théorie marxiste du droit comme une manière d’étoffer une telle analyse et d’en résoudre les tensions.
La théorie du droit de Marx et Engels
On peut lire dans l’Idéologie allemande que « la dissolution de la communauté naturelle engendre le droit privé ainsi que la propriété privée, qui se développent de pair » (Marx et Engels 1969, 44). Au moment où les modes de production fondés sur la possession et la production collectives ont été évincés et où la possession individuelle de la propriété s’est répandue, il est devenu nécessaire de réguler ces relations de propriété entre individus sous une forme juridique. Pendant l’Antiquité comme sous le régime féodal, le droit n’a pas pu s’imposer parce que la propriété privée ne s’était pas largement répandue.
Le développement du droit n’est devenu possible qu’une fois la déliquescence de l’ordre féodal consommée, avec l’émergence de l’industrie et du commerce. En effet, Marx et Engels montrent que là où le commerce a été organisé, « on reprit immédiatement le droit privé des Romains déjà élaboré, qui fut élevé au rang d’autorité » (Marx et Engels 1969, 45). Mais ce n’est qu’une fois que les révolutions bourgeoises eurent renversé l’aristocratie féodale que le « développement proprement dit du droit » a pu commencer (Marx et Engels 1969, 45). À part en Angleterre, ce mouvement a été accompli grâce au perfectionnement du droit civil romain, tant et si bien que même les Britanniques ont dû s’adapter pour se doter d’un droit de la propriété.
Marx et Engels ont ainsi retracé le « développement proprement dit du droit » jusqu’à son accomplissement complet dans l’extension et la systématisation du droit de propriété. Cependant, ils se sont aussi efforcés de montrer que les rapports de propriété existants ne provenaient pas du droit : la croyance inverse reposait, selon eux, sur une illusion juridique consistant à croire que la propriété privée est le pur produit de la volonté individuelle. Ils ont soutenu au contraire qu’une « chose » devient « [une propriété réelle] seulement dans le commerce, et indépendamment du droit ». De fait, la propriété et les bénéfices qu’elle engendre sont enracinés dans des rapports sociaux, et ne sont pas seulement fondés sur un titre juridique abstrait. C’est la raison pour laquelle chaque fois que de nouvelles formes d’échanges sociaux ont vu le jour, le droit « fut régulièrement obligé de les intégrer dans les modes d’acquisition de la propriété » (Marx et Engels 1969, 46).
Marx et Engels abordent, dans l’Idéologie allemande, un ensemble assez restreint d’enjeux juridiques, centrés en premier lieu sur le droit de propriété. Dans un texte antérieur, Sur la Question juive, Marx élabore une analyse similaire, à laquelle il accorde cependant une portée bien plus large. Il tente de suivre l’essor du droit, et en particulier des « droits de l’homme », jusqu’à leur statut de mètre étalon en matière d’organisation sociale. En référence à Hegel, Marx soutient l’idée d’une distinction, au sein des sociétés « modernes », entre la « communauté politique » dans laquelle les individus agissent comme citoyens, et la « société civile » où ils agissent comme hommes privés (Marx 1968, 15).
Tel n’a pas toujours été le cas. D’un point de vue historique, « l’ancienne société bourgeoise avait immédiatement un caractère politique » : ses diverses institutions – propriété, famille, etc. – étaient tout autant politiques, et existaient sous la forme de seigneuries, de castes et de corporations. Les formes de la possession, de la production et de l’appropriation étaient réglées de manière politique, par des statuts. Il était par conséquent impossible de distinguer entre « État » et « société », ou politique et économie (Wood 2003, 9-11).
L’essor des sociétés capitalistes (modernes) a changé la donne. Dans les sociétés capitalistes, l’accaparement de la plus-value n’est plus en rapport immédiat avec la place de l’individu, définie par son statut et par le droit coutumier ; ce rapport est au contraire médiatisé par le marché. Dans une telle situation, il n’est plus possible d’affirmer qu’ « État » et « société » s’interpénètrent : la « constitution de l’État politique et la décomposition de la société bourgeoise en individus indépendants » font en effet partie du même processus historique. C’est ici, de manière décisive pour Marx, que le droit fait son entrée en scène. Durant le temps où la société civile possédait un caractère politique, privilèges et statuts médiatisaient les rapports entre individus ; mais dès que celle-ci s’est trouvée composée d’individus indépendants, c’est le droit qui a médiatisé les rapports entre individus (Marx 1968, 14).
Marx défend alors que les « les “droits de l’homme”, distincts des “droits du citoyen” ne sont rien d’autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c’est-à-dire de l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la communauté » (Marx 1968, 16). Une certaine forme de « liberté », en rapport intime avec la loi, correspond à ce type de société civile. Elle réside dans « le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », droit dont les « limites […] sont marquées par la loi ». Il s’agit pour Marx de la liberté « de l’homme considéré comme monade isolée, repliée sur elle-même » (Marx 1968, 22). Comme dans l’Idéologie allemande, Marx soutient ici que « l’application pratique du droit de liberté » – droit inclus dans la loi régulant les rapports au sein de la société – « c’est le droit de propriété privée » (Marx 1968, 23). De plus, comme la société civile constitue désormais le mécanisme par lequel la base matérielle de la société se reproduit, la communauté politique n’a plus d’autre rôle que de servir d’instrument à la conservation de la société civile (Marx 1968, 24).
Que ce soit dans l’Idéologie allemande ou Sur la Question juive, Marx et Engels établissent par conséquent un rapport structurel solide entre, d’un côté, l’émergence de la propriété privée et du capitalisme, et de l’autre, la prépondérance de la loi et des rapports juridiques. Cependant, comme indiqué précédemment, ils cherchent également à saisir de quelles façons les classes instrumentalisent directement le droit à travers leur lutte. Bien qu’il reprenne plusieurs des analyses déjà rencontrées, Le Capital est particulièrement significatif à cet égard, notamment lorsque Marx aborde la question de la journée de travail.
La question du temps est intimement liée, au sein de la tradition marxiste, à celle de l’exploitation. Dans l’analyse de Marx, la force de travail est une marchandise à part parce qu’elle est productrice de valeur : en effet, le capitaliste a pour seule contrainte de payer le travailleur à hauteur de ce que la reproduction matérielle de son existence requiert. La différence entre le salaire et la valeur produite par le travail constitue la plus-value. Dans une telle situation, caractérisée par un nombre de travailleurs et un niveau de salaire fixes, le capitaliste peut augmenter la plus-value de deux manières : en allongeant la journée de travail, ce qui étend pour le travailleur le temps passé à produire ; ou, tout en maintenant la durée de la journée de travail, en augmentant la « productivité » grâce à une discipline de travail plus stricte ou un progrès technique. C’est ce que Marx nomme, respectivement, la plus-value absolue et la plus-value relative. Bien qu’elle rencontre une limite « naturelle », la première a constitué la méthode la plus facile et la plus rentable pour accroître les profits, en particulier durant la phase initiale du capitalisme.
Marx montre dans le chapitre 10 du Capital le rôle essentiel joué par le droit dans ce processus. En premier lieu, c’est à travers la forme juridique qu’employeur et employé se présentent « comme personnes libres, marchands tous deux » (Marx 1969). En d’autres termes, c’est par l’intermédiaire du contrat que se constitue le rapport capital-travail (et par conséquent tout le problème de la journée de travail). En second lieu, et plus fondamentalement, « [l]’établissement d’une journée de travail normale est le résultat d’une lutte de plusieurs siècles entre le capitaliste et le travailleur », lutte qui a été menée, pour Marx, sur le terrain de la législation. Du XIVe siècle à la fin du XVIIe siècle, « le capital […] cherche à imposer […] avec l’aide de l’État » l’allongement de la journée de travail à la classe ouvrière naissante (Marx 1969). Toutefois, dès le début du XIXe siècle, la législation vise à raccourcir la journée de travail et à limiter le recours au travail des enfants. Pour Marx, une telle législation ne pouvait devenir réelle et contraignante qu’après avoir été « [arrachée] lambeau par lambeau par une guerre civile d’un demi-siècle » (Marx 1969).
Ainsi le droit est-il devenu un front de la lutte des classes, sur lequel « les ouvriers » se sont regroupés et ont, « par un grand effort collectif, par une pression de classe, [dressé] une barrière infranchissable, un obstacle social qui leur interdise de se vendre au capital par “contrat libre”, eux et leur progéniture, jusqu’à l’esclavage et la mort » (Marx 1969). Cette lutte a permis d’unifier et de constituer la classe ouvrière en sujet politique, et de diminuer à la fois le pouvoir de la bourgeoisie et le taux d’exploitation. Pourtant, malgré son impact, elle a rencontré en même temps de véritables limites, comme le note Marx dans le chapitre suivant, et au lieu de faire cesser l’exploitation, l’a fait basculer vers une exploitation réglée par la plus-value relative.
Pour Marx, droit et législation ont également joué un rôle essentiel dans l’ « accumulation primitive » – expression qui désigne le processus par lequel les conditions initiales du capitalisme ont été posées. La transformation des populations de serfs en prolétariat en a été un des aspects essentiels, et n’a pu être réalisée qu’avec l’abolition des droits d’usage et des biens communaux, qui a contraint ces populations à tirer les moyens de leur subsistance de l’emploi salarié, et non plus de la terre. Ce changement s’est accompli en Angleterre grâce à une série de lois votées par le Parlement, connue sous le nom de « mouvement des enclosures » (Marx 1969). En outre, Marx explique qu’une fois expropriés de la terre, ce prolétariat naissant a été soumis à l’interdiction légale de mendicité et de vagabondage assortie de peines extrêmement sévères [Marx 1969]. Après les avoir détournés de la terre, la législation a eu pour objectif de rompre ces populations « à la discipline qu’exige le système du salariat » (Marx 1969). On peut en conclure que le droit, aux mains de la bourgeoisie émergente, a été un outil crucial dans la tentative de garantir les conditions de son propre essor.
L’accumulation primitive est aussi, chez Marx, le processus où affleure le plus directement la question du droit international. Ce processus n’a en effet pas seulement eu lieu à l’intérieur de l’État, mais s’est également déployé « à l’étranger ». Comme le note Marx, l’aube de la production capitaliste est marquée par la « découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires […]. Le régime colonial […] assurait des débouchés aux manufactures naissantes [et les] trésors directement extorqués hors de l’Europe […] refluaient à la mère patrie pour y fonctionner comme capital » (Marx 1969), ce qui permit aux capitalistes européens d’établir d’immenses réserves de richesses vouées à être ensuite transformées en capital. Bien qu’il remarque que le « pouvoir de l’État » a joué dans ces transformations, Marx ne fait pas explicitement mention du droit international. On ne peut cependant pas nier que ces processus internationaux ont été médiatisés par le droit international. Pour en donner deux exemples évidents, l’expansion coloniale a été réalisée par l’intermédiaire d’un droit d’acquisition des territoires coloniaux, tandis que plusieurs traités ont joué un rôle central afin de garantir le commerce, la navigation et le règlement des guerres et des paix.
L’impérialisme
Si, d’un point de vue marxiste, le droit doit être saisi comme étant solidaire d’une certaine configuration des rapports économiques, alors le droit international doit être compris selon les caractères spécifiques de l’économie mondiale. Marx et Engels en présentent une analyse plutôt contradictoire : d’un côté, ils insistent sur les disparités de l’économie mondiale, les écarts de développement entre régions, la juxtaposition de modes de production différents, ainsi que les violents conflits entre États-nations au prix desquels a lieu la diffusion du capitalisme ; d’un autre côté, ils maintiennent un modèle « diffusionniste » du capitalisme, qui rend compte de son expansion régulière depuis l’Europe, et du rôle de la bourgeoisie pour donner « un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays » (Marx 1972, 9) au point que « l’étroitesse et l’exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus impossibles » (Marx 1972, 10). Sous ce dernier aspect, la différence entre économie mondiale et économie nationale s’estompe.
Résoudre cette tension est devenu essentiel après la mort de Marx et Engels. La consolidation et la diffusion du capitalisme se sont accompagnées d’un colonialisme et de rivalités nationales qui, loin de se résorber, se sont intensifiés. Cherchant à intervenir au sein de cette conjoncture, les théoriciens marxistes ont développé la première des perspectives ci-dessus – insistant sur le caractère disparate, la nature violente et prédatrice, et la liaison intime du développement du capitalisme et des rivalités inter-étatiques. L’impérialisme est ainsi devenu une question centrale de la tradition marxiste.
Rudolf Hilferding inaugure l’analyse marxiste « classique » de l’impérialisme, soutenant que les prédictions de Marx au sujet de la concentration du capital se sont révélées justes à la fin du XIXe siècle. Avec la banqueroute et le rachat de certaines firmes, l’industrie capitaliste s’est trouvée concentrée aux mains de plusieurs corporations en situation de monopole. Afin de garantir leur stabilité et leurs profits, ces firmes se sont organisées en cartels, réalisant la fusion des capitaux industriel et financier au sein de vastes blocs monopolistiques. Ce mouvement a opposé les capitalistes au « libre échange » et aux limites que celui-ci imposait au regroupement en cartel, si bien que ceux-là ont fait campagne en faveur de barrière tarifaires à l’entrée des marchés. Ces barrières ont toutefois eu pour effet de limiter le nombre d’acheteurs potentiels, et donc de restreinte les profits.
La solution à ce problème a été double : augmenter la taille de la zone tarifaire grâce à la conquête de colonies, et exporter le capital. Cette dernière stratégie combine la vente de marchandises à l’étranger, le développement à vaste échelle et l’investissement dans les manufactures, les infrastructures de transports, etc. ; elle repose sur l’établissement d’entreprises commerciales à l’étranger et l’exploitation directe de la main-d’œuvre étrangère. En raison de leur sous-développement relatif, les économies capitalistes moins avancées ont à chaque fois fourni le plus grand nombre d’opportunités pour accroître les profits. Dans tous ces processus, contrôler, développer et transformer ces économies ont en outre requis de lourdes interventions des États.
Même si Hilferding a ainsi posé les fondements d’une théorie de l’impérialisme, il s’est davantage intéressé à la manière dont le capital financier a joué à l’intérieur de l’État. C’est à Boukharine et Lénine qu’échoua la tâche théorique et politique de nouer les fils de son argument. S’ils se situent fondamentalement dans son sillage, ils ont en outre montré qu’une certaine division internationale du travail découlait du processus décrit par Hilferding, et correspondait à l’avènement d’une phase qualitativement distincte du capitalisme, alors décrit comme « un système universel d’oppression coloniale et d’asphyxie financière de l’immense majorité de la population du globe par une poignée de pays “avancés” » (Lénine 1947, 2).
Il est important de remarquer que, pour Lénine et Boukharine, ce système a provoqué d’intenses rivalités entre les États capitalistes. Les capitalistes de monopole se sont affrontés mutuellement pour le territoire économique, en particulier à cause du caractère exclusif du système tarifaire. Dans la mesure où ces derniers se trouvaient au sommet des rapports de domination dans leurs États respectifs, et où la conquête du territoire économique en passait nécessairement, en dernière instance, par la violence, la concurrence « économique » s’est transformée en concurrence politique et militaire. Ainsi, pour Lénine et Boukharine, l’impérialisme impliquait la lutte entre puissances capitalistes avancées « pour le partage et le repartage du globe » (Lénine 1947, 53). Ce point a été d’une grande importance parce qu’il s’oppose directement aux arguments de Karl Kautsky selon qui les forces en jeu dans l’expansion coloniale n’étaient pas les mêmes si bien que la rivalité entre puissances capitalistes n’obéissait pas à une nécessité économique. Pour Kautsky, la tendance à l’organisation monopolistique exercée à l’intérieur des États en venait au contraire à jouer au plan des États entre eux, tant et si bien que les États capitalistes avancés formeraient leurs propres trusts afin d’accroître l’exploitation des sociétés sous-développées.
Ces auteurs n’ont que rarement traité, de façon explicite, du droit international. Certaines conclusions se sont cependant imposées du fait de la grande proximité entre ce dernier et les événements qu’ils ont analysé. D’une part, Boukharine, Lénine et Hilferding ont ainsi tous démontré que le droit international constituait l’un des mécanismes de la lutte entre puissances impériales, et l’un des instruments pour sanctionner l’oppression coloniale. Les traités internationaux, définis comme une manière de codifier un certain équilibre au sein des rapports de forces, en offrent un exemple manifeste. Ainsi, pour Lénine, le Traité de Versailles repose sur une « paix dissymétrique et prédatrice », et a fait émerger une situation « dans laquelle soixante-dix pour cents de la population mondiale est mis en servitude ».
Par conséquent, Lénine a aussi décrit les institutions internationales de son temps comme solidaires d’une telle fonction. La Société des Nations était en particulier vue par lui comme une « meute de loups qui se saisissent mutuellement à la gorge » (Lénine 1966a, 172), « une pure imposture […] une association de brigands, chacun essayant de dérober quelque chose aux autres » (Lénine 1966b, 323). À ce titre, il a défendu l’idée que les institutions juridiques internationales incorporaient et exprimaient les rivalités engendrées par l’impérialisme. Étant donné leurs désaccords, il n’est pas surprenant de voir que Kautsky insistait au contraire sur la nécessité de juger la Société des Nations d’après « ce que l’on pourrait en faire si les socialistes du monde entier lui accordaient le plus grand intérêt ». En outre, cette institution offrait pour Kautsky « la seule méthode rationnelle pour mettre fin aux litiges internationaux qui n’aient été réglés par la guerre ou engendrés par les traités de paix » (Kautsky 1924).
Comme nous l’avons noté, dès lors que les études du droit international ont mis en lumière son rôle dans la construction et le maintien du colonialisme, toute théorie de l’expansion coloniale intègre inévitablement des questions de droit international. À certains égards, la manière dont Lénine rend compte de la nature juridique du colonialisme est contradictoire : de façon claire, pour lui, la nature directement juridique de l’expansion coloniale n’a rien de nécessaire, étant donné que l’impérialisme repose d’abord sur la logique de l’« annexion économique », et que le capital financier est « un facteur si puissant, si décisif, pourrait-on dire, dans toutes les relations économiques et internationales, qu’il est capable de se subordonner et se subordonne effectivement même des États jouissant d’une complète indépendance politique » (Lénine 1947, 34). Lénine soutient en fait que l’impérialisme n’était pas uniquement le fait des puissances coloniales et de leurs colonies, mais qu’il s’étend à des « formes variées de pays dépendants qui, nominalement, jouissent de l’indépendance politique, mais qui, en réalité, sont pris dans les filets d’une dépendance financière et diplomatique » (Lénine 1947, 35) – ce qu’il nomme des « semi-colonies ». Cependant, il estime aussi sans détour que l’impérialisme s’exprime en priorité dans le lien immédiatement juridique que la puissance coloniale entretient avec la colonie. L’annexion politique « rend souvent l’annexion économique plus facile, moins cher […] plus accessible et moins pénible » (Lénine 1964). Les États « semi-coloniaux » ne sont alors que des « formes transitoires » dans ce processus d’annexion (Lénine 1947).
À l’évidence, l’histoire n’a pas validé la thèse des formes « semi-coloniales » strictement transitoires, et certains marxistes postérieurs ont démontré comment elles s’étaient en fait généralisées dans le « néo-colonialisme ». Toutefois, les réflexions plus générales de Lénine sur le rôle du droit international ont eu tendance à se réduire à la première position, parfois même de façon sommaire, arguant que « les lois sont des mesures politiques » qui ne peuvent pas « empêcher les phénomènes économiques » (Lénine 1964). Selon son analyse, la logique économique constitue le moteur essentiel de l’impérialisme, et peut se manifester sous des formes différentes dont seulement certaines sont « juridiques ». Les « formes de la lutte » entre impérialistes « peuvent changer et changent constamment pour des raisons diverses, relativement temporaires et particulières, alors que l’essence de la lutte, son contenu de classe, ne saurait vraiment changer tant que les classes existent » (Lénine 1947, 30). Cela entraîne d’importantes conséquences politiques : « sans le renversement révolutionnaire du capitalisme, aucune cour internationale d’arbitrage, aucune réorganisation “démocratique” de la Société des Nations, ne sauraient sauver l’humanité de nouvelles guerres impérialistes » (Lénine 1966).
D’autres théoriciens marxistes classiques ont rendu compte de manière diverse des forces motrices de l’impérialisme, accordant un rôle plus ou moins grand au droit international, mais ils en partagent tous, en partie au moins, la même analyse critique. Si les liens établis entre droit et rapports sociaux impérialistes manifestent parfaitement la manière dont le premier organise les seconds, ces connexions restent contingentes et conjoncturelles, et révèlent l’absence de théorie matérialiste du droit international plus approfondie. Sous une telle perspective, le droit international s’apparente à un « véhicule » passif qui tantôt exprime la « vie réelle » des rapports économiques internationaux, tantôt est simplement mis de côté ou court-circuité. Ainsi, bien que ces auteurs aient pu cheminer au-delà des interprétations de Marx et Engels au sujet de l’économie mondiale, ils ont aussi reculé d’un pas d’un point de vue théorique : les analyses plus précises issues de textes comme Sur la Question juive cherchent à identifier – de manière éclatée, il faut l’admettre – la manière dont une logique juridique spécifique est produite, et à expliquer son rôle dans la reproduction des rapports sociaux capitalistes.
La théorie marxiste du droit international
La théorie de la forme marchandise
Evgeny Pachoukanis est peut-être le plus important théoricien marxiste du droit. Le renouveau de la théorie marxiste du droit s’est en grande part traduit par la « redécouverte » de sa pensée. Les analyses proposées à sa suite ont presque toutes exprimé la nécessité de se situer à l’égard de sa théorie de la forme marchandise (pour l’infirmer ou la confirmer). Pachoukanis est un juriste bolchévique, surtout connu à l’issue de la Révolution russe. Il a été le théoricien du droit du Soviet suprême dans les années 1920 et 1930, a établi une école loyale et dominé l’Institut de droit de l’Académie des sciences de l’Union soviétique. Bien qu’il ne fit pas partie de l’Opposition de gauche (ce fut même le contraire), son travail tomba progressivement en disgrâce aux yeux du régime stalinien, et Pachoukanis, dénoncé comme « ennemi du peuple » (Hazard 1957, 385), fut exécuté en 1937.
Pour Pachoukanis, toute analyse théorique du droit doit en révéler la spécificité à l’égard des autres formes sociales. Cette différence ne peut pas reposer sur la « fonction » régulatrice du droit à l’égard de la vie sociale, étant donné « qu’il existe également chez les animaux une vie collective » mais qu’il « ne nous viendra pas à l’idée d’affirmer que les rapports des abeilles ou des fourmis sont réglés juridiquement » (Pachoukanis 1970, 69). Elle ne peut pas non plus résider dans la particularité des sphères régulées par le droit, étant donné que toute sphère sociale peut être l’objet de « normes » variables. Le matérialisme historique doit partir du fait que « la réglementation des rapports sociaux revêt dans certaines conditions un caractère juridique » (Pachoukanis 1970, 69). La tâche revient alors à analyser la nature de cette forme et à identifier les conditions matérielles qui en conditionnent l’émergence. À ce titre, les analyses qui se contentent d’« introduire le moment de la lutte des classes » (Pachoukanis 1970, 42) dans une théorie purement positiviste du droit, s’en tiennent à faire « une histoire des formes économiques avec une teinture juridique plus ou moins forte, ou une histoire des institutions, mais en aucun cas une théorie du droit » (Pashoukanis 1970, 42-43) : il s’agit là, pourrait-on dire, d’une description correcte de la manière dont les théoriciens marxistes de l’impérialisme ont saisi le droit international.
Fidèle au Marx de La question juive et des intuitions dispersées dans le Capital, Pachoukanis soutient que la forme juridique trouve ses conditions dans l’échange marchand. Pour que ce dernier ait lieu, « [les gardiens des marchandises] doivent […] se reconnaître réciproquement comme propriétaires privés. Ce rapport juridique, qui a pour forme le contrat, […] n’est que le rapport des volontés dans lequel se reflète le rapport économique » (Marx 1969). Par conséquent, chaque détenteur de marchandises doit reconnaître en l’autre un égal, dans un sens formel et abstrait. Mais comme tout échange abrite la possibilité d’un différend, une forme de régulation est requise : c’est là que le droit entre en jeu. Pour Pachoukanis, la forme juridique permet de régler les différends entre des individus abstraits, formellement égaux. Comme l’échange de marchandise, le droit précède donc le capitalisme, bien qu’il existe alors au sein d’espaces spécifiques de la vie sociale, entremêlés aux coutumes et aux statuts, à la religion et aux privilèges.
Au moment où le capitalisme est devenu dominant, il en est allé de même pour l’échange marchand et pour le droit. Toutefois, ce n’est pas seulement que le droit s’est diffusé avec la multiplication des échanges. Dans la logique du capitalisme, « les différents actes accidentels d’échange se transforment en une circulation élargie et systématique de marchandises » (Pachoukanis 1970, 104) (et s’opposent aux formes d’échange éclatées). À partir du moment où tout doit être commensurable, la valeur cesse d’être incorporée à des échanges spécifiques et devient, dans ce contexte, une catégorie abstraite. Le droit subit une même évolution, avec l’émergence d’une forme abstraite : un sujet de droit universel qui régit l’ensemble de la vie sociale.
De manière singulière, Pachoukanis a aussi écrit au sujet du droit international, pour articuler, de manière essentielle, sa théorie de la forme marchandise à l’analyse de Lénine sur l’impérialisme, et soutenir que le droit international pourrait en fait être la plus ancienne forme de droit, pour autant que l’on peut décrire à gros traits les institutions juridiques internationales « des temps les plus reculés des sociétés de classes et même des sociétés primitives » (Pachoukanis 1980, 175). L’échange marchand a en effet été inauguré non entre individus mais entre tribus et communautés. Toutefois, c’est seulement avec l’avènement du capitalisme que le droit international a pleinement éclot, à l’instar du droit interne : en premier lieu parce que l’on a assisté dans ce contexte à l’extension et à l’épanouissement de l’échange marchand à l’échelle internationale ; en second lieu, parce que l’État souverain et indépendant, compris communément comme le sujet central du droit international, a lui-même été le produit du capitalisme. Si ce processus a commencé avec la formation des monarchies absolues, dont « l’essor du capital mercantile » a fourni la base économique (Pachoukanis 1980, 173), ce n’est qu’avec les révolutions bourgeoises qu’il s’est achevé : à travers la séparation de « la règle publique et de la règle privée, ainsi que la transformation du pouvoir politique en une force spécifique et de l’État en un sujet spécifique […] à ne pas confondre avec les individus qui à un moment ou à un autre sont titulaires de son autorité » (Pachoukanis 1980, 174).
Dès lors que les États sont structurés en classes et qu’ils sont pris dans les filets d’un impérialisme, cette stratification de classe s’exprime à travers le droit international. Reprenant ainsi la théorie de Lénine sur l’impérialisme, Pachoukanis montre ici que, loin d’être un corps de règles générales neutre, le droit international équivaut à « la forme juridique de la lutte des États capitalistes entre eux pour la domination du reste du monde » (Pachoukanis 1980, 169) : fondamentalement, c’est ainsi qu’est façonné l’ordre juridique international. À l’instar de Lénine, Pachoukanis aborde le rôle joué par certains traités pour structurer et organiser la domination impérialiste, et conclut qu’une « obligation issue d’un traité n’est rien d’autre que la concrétisation, sous une forme spécifique, des rapports économiques et politiques » (Pachoukanis 1980, 181).
En outre, il a été attentif à la manière dont le droit international détermine la relation entre les pays capitalistes avancés et le reste du monde colonisé. Il a défendu que la « division entre États civilisés et États “semi-civilisés” » (Pachoukanis 1980, 172) trouve ses racines dans la logique de l’exploitation impérialiste, et que le droit international correspond à « la totalité des formes que les États capitalistes bourgeois mettent en œuvre dans leurs relations mutuelles, pendant que le reste du monde apparaît comme un simple objet de toutes leurs transactions » (Pachoukanis 1980, 172). Enfin, la domination coloniale, sous sa forme juridique, n’est pas, pour lui, l’unique moyen qui permet au capitalisme avancé d’exploiter les États moins développés. Au même titre que le « droit privé suppose l’égalité formelle de tous les sujets mais accepte en même temps des inégalités de richesse réelles », le droit international reconnaît « l’égalité de droit entre États bien que leur pouvoir et leur poids dans les relations internationales soient incomparables » (Pachoukanis 1980, 178), ce que l’absence d’État international centralisé renforce.
China Miéville part de cette dernière assertion pour tenter d’appliquer de manière systématique les idées de Pachoukanis à l’étude du droit international (Miéville 2005). Ce travail occupe une place centrale dans le renouveau actuel de la théorie marxiste du droit international, et en est devenu une référence obligée, à l’instar de Pachoukanis (Knox 2009 ; Marks 2007). Bien que l’analyse de ce dernier sur le droit international soit en réalité assez succincte, selon Miéville, sa théorie de la forme marchandise peut être développée et permettre d’éclairer quelques-uns des problèmes centraux de la discipline. Pachoukanis offrirait notamment les arguments pour répondre à l’éternelle question : le droit international est-il « vraiment » du droit ?
L’argument est connu, l’une des plus fréquentes critiques à cet égard consiste à récuser la juridicité du droit international en raison de l’absence d’une souveraineté globale capable de le faire appliquer partout. Pachoukanis, en insistant déjà sur la simple définition du droit comme relation entre des sujets abstraits et formellement égaux, déplace la question. On pourrait cependant encore se demander si une certaine notion de souveraineté n’est pas requise pour fonder le droit international, et si l’on peut donc vraiment parler de droit. Miéville tente ici d’aller plus loin que Pachoukanis, dont il montre l’incapacité à rendre compte précisément de la violence logée au cœur de la forme marchandise. Pashoukanis opère un « glissement caractéristique » (Miéville 2005, 126) lorsqu’il affirme, à tort selon lui, que « la coercition […] contredit la pré-condition fondamentale des transactions entre propriétaires de marchandises » (Miéville 2005, 143). Pour qu’une marchandise « soit, sur un ton qui en dit long, la-mienne-et-non-pas-la-tienne, de solides aptitudes sont nécessaires, en l’absence desquelles cette marchandise peut m’être retirée et l’acte d’échange annulé » (Miéville 2005, 126). La corrélation entre violence et forme marchandise contamine également la forme juridique, étant donné que la justification des droits repose clairement sur la violence de l’autorisation à posséder quelque chose comme le-mien-et-non-pas-le-tien.
Cet argument constitue pour Miéville le ciment juridique du droit international. Comme la coercition est inhérente à la forme marchande, comme elle peut avoir lieu entre les termes mêmes du rapport, il est inutile de faire appel à une « souveraineté » globale supérieure. Au contraire, « dans les systèmes juridiques dépourvus d’autorités supérieures et autonomes, la violente coercition exercée par les sujets légaux eux-mêmes permet de réguler les rapports juridiques » (Miéville 2005, 133). Comme l’a fait remarquer Pachoukanis, au sein même de l’État « les sujets influencent par leurs seules activités la manière dont s’exerce une grande partie des rapports du droit civil » (Miéville 2005, 180).
La question de la violence est aussi liée, de manière intrinsèque, à celle du contenu du droit. Miéville reprend ici le fameux argument de Martti Koskenniemi pour qui l’ordre juridique international est indéterminé et traversé par une tension fondamentale. D’un côté, il est composé d’États indépendants et souverains dont les obligations réciproques reposent sur leur seule volonté, et dont les justifications et principes ont pour prémisses la « volonté étatique ». De l’autre, celle-ci ne peut être la source de l’obligation entre les États, puisque le droit international (en tant qu’ordre juridique) requiert de contraindre les États même alors qu’ils ne le souhaitent pas. Pour Koskenniemi cette tension entre « concrétude » d’un côté, et « normativité » de l’autre, est symptomatique de la structure plus large du droit international : on peut le définir du point de vue de l’intérêt des États (il en serait l’apologie) ou du point de vue de l’ordre mondial (il en constitue la représentation utopique). Les arguments défendus de part et d’autre ont une légitimité égale et se contredisent, ce qui se reflète sur l’ordre juridique international et rend la contradiction insoluble sur le terrain propre du droit international.
Miéville reprend en grande partie cet argument, bien qu’il affirme que l’approche de Koskenniemi reste trop idéaliste puisqu’elle attribue cette contradiction à la pensée libérale, alors qu’elle réside au contraire, selon lui, dans le capitalisme lui-même (Miéville 2005, 54). Surtout, il se demande comment les problèmes juridiques, alors qu’ils sont insolubles, se trouvent néanmoins résolus. L’enjeu de la violence réapparaît ici. Miéville s’appuie sur Marx qui a montré, dans le contexte des « Lois sur les manufactures », qu’ « entre deux droit égaux, c’est la force qui tranche », autrement dit que devant deux arguments juridiques irréfutables, c’est la force qui résout la contradiction. Pour le droit interne, c’est l’État qui assume ce rôle, mais dans l’arène juridique internationale, selon les précédents arguments, « il n’y a pas d’État pour peser en tant qu’arbitre final sur des revendications concurrentes [si bien] que la violence reste un moyen aux mains des parties elles-mêmes en désaccords au sujet de la loi » (Miéville 2005, 292).
La forme de cette violence est bien entendu déterminée par un certain contexte des relations sociales. À l’échelle internationale, il s’agit de l’impérialisme, dont l’analyse est issue chez Miéville de la tradition classique de Lénine et Boukharine décrite ci-dessus, et dont il pousse la logique à l’extrême :
La nécessité de cette violente dissymétrie découle précisément de l’égalité juridique : grâce à son pouvoir de coercition, l’un des sujets de droit fait la loi au sein du rapport juridique – il exerce sa domination impérialiste. Le droit international suppose de manière spécifique, selon la forme universalisée de l’égalité juridique et de l’auto-détermination, l’impérialisme (Miéville 2005, 293).
À ce titre, la connexion structurelle entre droit international et impérialisme s’exerce partout pour Miéville : dans la mesure d’abord où la forme légale est directement liée à l’expansion du capitalisme, ce qui fait du capitalisme mondialisé un impérialisme ; et ensuite, parce que la forme du droit international engendre des contradictions qui ne peuvent être résolues que par la violence d’un impérialisme.
À l’évidence, cette théorie de la forme marchandise repose sur les théories marxistes classiques de l’impérialisme, mais va bien au-delà de leur analyse initiale du droit international. Le rapport entre droit international et impérialisme n’est pas qu’une pure coïncidence, il se noue à un niveau structurel plus profond. Miéville va cependant encore plus loin, et montre qu’avec l’éclosion complète du capitalisme mondial, le droit international pénètre de manière universelle « chaque incident international [et s’insinue] jusque dans la fabrique même du système international » (Miéville 2005, 282). Loin d’être simplement lié de manière structurelle aux relations internationales, le droit international en vient en fait à structurer et à constituer le monde (Miéville 2005, 283). Cette thèse possède une prétention plus générale, encore ambiguë chez Pachoukanis, qui tend à faire du droit un élément de la « base » comme de la superstructure en raison de son rôle constitutif dans la forme marchandise.
Critique de l’idéologie
L’idéologie a été l’un des outils les plus fréquemment déployés par les marxistes pour comprendre le droit. Comme on l’a vu, Marx et Engels produisent leurs premières élaborations du droit dans l’Idéologie allemande. De la même façon, dans la « Préface » de la Contribution à la critique de l’économie politique, Marx décrit le droit comme l’une des « formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience [du conflit de classe] et le mènent jusqu’au bout » (Marx 1972 : 18). Ce concept a été particulièrement discuté dans les années 1970, lors du renouveau de la théorie marxiste du droit en Angleterre. Comme le notent Cain et Hunt, ce mouvement a fait parti d’une impulsion plus vaste au sein des débats marxistes, déclenchée par la traduction et la diffusion des travaux de Louis Althusser et d’Antonio Gramsci, et mue par le souci « de s’émanciper de l’étreinte conceptuelle de processus historiques inévitables, de réaffirmer l’indépendance des structures à l’égard des individus qui les mettent en œuvre et […] d’insister sur la capacité des gens à les changer » (Cain et Hunt 1979, ix).
Le concept d’« idéologie » revêt bien entendu un sens tout à fait particulier au sein de ces débats. Sous ses premières versions, l’idéologie a en général été directement associée à l’idée de « fausse conscience ». Engels donne un tel sens au concept dans sa lettre à Franz Mehring : « L’idéologie est un processus que le soi-disant penseur accomplit sans doute avec conscience, mais avec une conscience fausse. Les forces motrices véritables qui le mettent en mouvement lui restent inconnues, sinon ce ne serait point un processus idéologique » (Engels 1970). La fonction du droit est ici, essentiellement, de servir d’écran de fumée pour masquer les processus « réels » à l’œuvre dans le monde – précisément, les classes et la lutte des classes. Althusser et Gramsci ont alors fourni le moyen de dépasser cette vision (Hunt 1985).
Ces débats n’ont toutefois eu qu’un impact réduit dans le champ du droit international. Les théories les plus décisives durant ces années appartiennent au courant de la critique de l’idéologie issu de l’École de Francfort, comme en témoigne le travail de Susan Marks. En référence à John Thompson, Marks emploie le concept d’idéologie afin de débusquer les « manières par lesquelles le sens sert à établir et à consolider des rapports de domination » (Marks 2003, 10). Pour sa part, la conception précise de Marx se veut critique dans la mesure où « l’idéologie » n’est pas comprise comme la description neutre de « croyances » ou de « visions du monde » (Marks 2003, 11), ni comme ressortissant à une posture « épistémologique » soucieuse de la structure « réelle » du monde. Marks rejette ainsi l’analyse issue d’Engels dans laquelle l’idéologie n’est qu’un échec à la compréhension du monde.
Comme Marks le reconnaît, le sens peut servir à établir et maintenir les rapports de domination de multiples façons. En s’appuyant à nouveau sur Thompson, elle montre toutefois que l’idéologie relève d’un certain nombre de procédés décisifs, qui possèdent chacun leur « stratégie discursive » dérivée. Les procédés qu’identifie Marks sont : la « légitimation », « qui permet de faire apparaître l’autorité comme valide et adéquate » (Marks 2003, 19) ; la « dissimulation » par laquelle « les rapports de dominations sont occultés, masqués ou niés » (Marks 2003, 20) ; l’ « unification » qui octroie aux rapports sociaux un caractère harmonieux et cohérent (Marks 2003, 20) ; la « réification » qui les fait apparaître comme autre chose que le produit des rapports humains, donc comme des formes éternelles (Marks 2003, 21) ; et enfin, la « naturalisation » qui rend « l’existence des ordres sociaux évidente et autoréférentielle » (Marks 2003, 22).
De manière fondamentale, il n’est pas possible d’interpréter ces procédés comme le résultat d’une ignorance ou d’un défaut de connaissance. Bien que l’illusion puisse participer de chacun d’entre eux, « il ne s’agit pas d’un simple cas d’erreur ou d’ignorance à l’égard de la réalité sociale » (Marks 2003, 22). Alors que nous pouvons tous, en droit, prendre conscience des rapports d’exploitation et des inégalités qui traversent le monde, nous agissons au contraire comme si nous l’ignorions : il y a illusion dès lors que l’on ne se rend plus compte de l’effet produit par un tel comportement. Ainsi, dans le travail, il se « peut que nous ne nous rendions pas compte à quel point notre prétention à croire que les asymétries au sein des rapports de travail n’existent pas, qu’elles sont immuables ou légitimes, conduit à perpétuer ces asymétries » (Marks 2003, 22).
En tant que forme idéologique, le droit international met en œuvre chacune de ces opérations idéologiques de différentes façons, et dans divers contextes. Ainsi, Marks soutient dans The Riddle of All Constitutions que les formes de développement disparates issues de la mondialisation ont provoqué un système de « démocratie de basse intensité » qui :
répond aux besoins immédiats des crises anti-autoritaires, en calmant les tensions et en restaurant l’ordre, mais tout en empêchant cependant des changements structurels de grande ampleur dans les régions périphériques et semi-périphériques. Ainsi continuent à se concentrer dans ces régions des salaires relativement bas, des profits relativement bas, et des activités économiques hétérogènes ; mais d’un autre côté, la démocratie de basse intensité est aussi liée au projet d’étendre la portée des marchés mondiaux et d’éliminer les derniers obstacles à la transnationalisation du capital. Ce système facilite la pénétration et la consolidation des rapports de production capitalistes dans les régions périphériques et semi-périphériques. Les politiques de libéralisation économique, d’ajustement structurel, de dérégulation des échanges, etc., ont davantage de légitimité lorsqu’elles sont menées par des gouvernements élus que quand elles sont imposés par des régimes autoritaires (Marks 2003, 57).
En défendant la « position de la norme démocratique », le droit international aide à assurer ces transformations. Il établit fondamentalement les critères à partir desquels les organisations internationales peuvent contrôler la démocratie, en s’attachant lourdement au seul principe des élections. Il participe ainsi à une forme de naturalisation en faisant de la démocratie de basse intensité la seule forme possible de démocratie ; mais aussi d’unification, en séparant les droits politiques de leurs enjeux plus vastes ; et de réification, en neutralisant le caractère historique de la démocratie pour la définir comme une simple étape à atteindre ou un pur événement (Marks 2003, 63-67).
Il est possible de trouver au sein du corpus marxiste contemporain des analyses similaires sur le droit international. Ainsi, dans un texte récent, Tor Krever défend l’idée que le droit pénal international œuvre à isoler les actes individuels de leur contexte et des rapports sociaux plus larges dans lesquels ils ont lieu (Krever 2013, 720). Tels qu’ils sont définis, les actes ignominieux ne font plus partie d’un système global de violence mais sont au contraire imputés à quelques « fruits pourris » ou, au mieux, attachés à un foyer de crise particulier. Le droit pénal international se préoccupe ainsi avant tout « de violences conjoncturelles et de leur caractère anormal, plutôt que des forces […] qui se cachent en-deçà et de leur caractère normal » (Krever 2013, 722). À partir du moment où les comportements individuels sont coupés de leur contexte, la possibilité de les prévenir apparaît d’autant plus réduite, ce qui oblige à en gérer les dérèglements de la manière et au moment où ils interviennent, sans envisager d’action de plus grande ampleur.
Malgré le grand nombre de procédés idéologiques que le droit peut reconduire, l’opération la plus commune revient sûrement à abstraire les actes individuels de leur contexte général. Marks l’a vraisemblablement aperçu, comme l’indique son vif intérêt pour cette question dans ses derniers travaux. Ainsi, affirme-t-elle dans « Droits de l’homme et causes premières » que les institutions des droits de l’homme ont tendance à se détourner de revendications plus larges pour s’en remettre à une causalité systémique. Bien que certaines des conditions qui « engendrent et entretiennent » les problèmes internationaux soient distinguées, « le cadre plus large au sein duquel ces conditions sont reproduites de manière systématique » suscite très peu d’intérêt (Marks 2011, 71). Nous pouvons en déduire d’une part que le rapport « pratique » aux droits de l’homme est profondément dépolitisant, et d’autre part que, au sein des fonctions idéologiques potentiellement infini du droit international, la production de ce que Marks nomme « fausse contingence » constitue l’un de ses procédés essentiels (Marks 2009).
Le droit international et le Tiers-monde
Le « Tiers-monde » a historiquement représenté l’un des espaces les plus notables de la réception des théories marxistes de l’impérialisme. De nombreux acteurs des mouvements anti-coloniaux, anti-impérialistes et tiers-mondistes ont déployé une analyse essentiellement marxiste de l’impérialisme, et symétriquement, de nombreuses études marxistes de l’impérialisme ont fait référence et articulé des projets politiques tiers-mondistes. À ce titre, plusieurs théoriciens du droit et activistes issus du tiers-monde ont produit des analyses du droit international fortement influencées par les discussions marxistes. Mohamed Bedjaoui soutient ainsi que le droit international a « permis la colonisation, l’exploitation de l’homme par l’homme, les discriminations raciales, [et a] facilité et légalisé l’enrichissement des pays riches » (Bedjaoui 1979, 63). Le droit international classique est en effet « dérivé des lois de l’économie capitaliste et du système politique libéral » (Bedjaoui 1979, 49), et dans sa version contemporaine, il continue d’autoriser l’exploitation néo-coloniale au sein de laquelle les firmes multinationales remplacent les États (Bedjaoui 1979, 37).
L’enjeu ne réside pas tant dans le fait que le droit a créé des « rapports inégalitaires » (Bedjaoui 1979, 112), mais dans la « dichotomie entre loi et réalité » (Bedjaoui 1979, 63) qui masque, par une inégalité formelle, à la fois des inégalités réelles et une « attitude complaisante, fidèle au laisser-faire, qui […] a mené […] à la non-intervention légale et a favorisé la spoliation des richesses et des biens des peuples moins forts » (Bedjaoui 1979, 49). Un tel jugement s’inscrit dans l’interprétation plus large que Bedjaoui fait du droit, qui exprime dans son contenu un « “moment” de l’évolution des activités sociales et économiques, et détermine à un degré plus ou moins grand leur état d’équilibre » (Bedjaoui 1979, 106). Il n’existe donc pas, selon lui, de lien nécessaire entre droit et impérialisme, et bien que le droit implique à l’origine un certain conservatisme, « si la réalité change dans un sens plus égalitaire, le droit […] s’adapte inévitablement aux nouvelles données matérielles » (Bedjaoui 1979, 112).
L’approche générale de Bedjaoui consiste à enraciner les différentes formes d’arguments légaux dans les différents rapports impérialistes entre États. On retrouve cette même approche dans des études marxistes plus contemporaines du droit international. L’un de leurs plus éminents représentants est peut-être B. S. Chimni, selon qui « les questions juridiques sont toujours en même temps des questions sociologiques » (Chimni 1993, 218). En raison du lien intime entre « l’État » et « les relations internationales » en régime capitaliste, les théories marxistes font dépendre, selon lui, les relations internationale de l’organisation interne des États (Chimni 1999, 337). Comme chaque État du monde est adossé à un mode de production et à une classe dominante donnés, « la politique étrangère d’un État est intégralement liée à sa politique intérieure » (Chimni 1999, 337).
Cependant, le mode de production capitaliste est toujours déjà mondialisé ; il n’est donc pas vrai que l’économie mondiale correspond au regroupement des différentes économies nationales. Le capitalisme a au contraire fait émerger un marché mondial dont « la base repose sur une certaine division internationale du travail et définit les relations des parties (les États et leurs économies) au tout (l’économie mondiale) » (Chimni 1993, 221). Dans cette perspective, « le droit et les institutions internationales doivent être perçus comme un dispositif au service de certains intérêts globaux de groupe » (Chimni 1999, 338). Dans les franges supérieures de la division internationale du travail, les classes dominantes cherchent à satisfaire leurs intérêts à travers le droit international. ((Bien entendu, la situation est en fait plus complexe. Les intérêts de classe ne sont pas directement traduisibles dans les termes du droit international et la politique étrangère « exprime et se compose de plusieurs facteurs : les intérêts de la classe dominante, le compromis de classe, les enjeux de sécurité nationale, les problématiques culturelles, les mouvements de résistance, et la manière spécifique dont se construit le droit international » (Chimni 2010, 68).)) C’est pourquoi « n’importe quel changement au sein de la division internationale du travail est voué par conséquent à se refléter sur la matière des relations internationales, et, finalement, sur le droit international » (Chimni 1993, 221).
L’histoire de l’impérialisme a connu, selon Chimni, cinq « époques » distinctes, dont chacune a façonné de manière fondamentale le contenu du droit international. La première s’étend de 1600 à 1760 et correspond à « l’ancien colonialisme », c’est-à-dire à la période de « l’accumulation primitive », de l’expansion mercantiliste, et de la consolidation des États et de leur territoire d’après le modèle « westphalien ». D’un point de vue juridique, elle marque le passage du droit international féodal au droit international bourgeois.
Le caractère arriéré de la manufacture européenne et, par conséquent, la nécessité d’accumuler matières premières et biens issus des colonies ont conditionné cet ancien colonialisme. Le nouveau colonialisme (1760-1875) a renversé la situation. Devenues désormais des marchés pour la production de marchandise européenne, les colonies ont été soumises à une plus forte pression. C’est dans cette période que le droit international émergea sur une base solide, fermement structurée autour de la souveraineté étatique. Cependant, avec l’importance croissante des colonies dans le développement européen, « le droit international bourgeois se déroba du statut de droit des gens universel pour en rester au droit des gens chrétien » (Chimni 1993, 231). La thèse de la responsabilité de l’État fut l’enjeu de toute une série de développements dans l’intention de défavoriser le monde non-européen et d’étayer le développement du capitalisme. Ces tendances furent exacerbées sous la période de « l’impérialisme » (1875-1945) et du capitalisme de monopole décrit ci-dessus. Le mouvement de colonisation connut une forte accélération, en particulier en Afrique, et le droit international joua un rôle essentiel pour permettre les acquisitions de nouveaux territoires. C’est aussi durant cette période que le droit international est devenu un droit des « nations civilisées ». Ce mouvement vers un modèle séculier et prétendument « universel […] était en partie motivé par le besoin de s’adapter à l’essor de grandes puissances non-européennes dont certaines n’étaient pas chrétiennes » (Chimni 1993, 233) : ce droit international permit tout autant de légitimer la domination coloniale exercée par les puissances européennes et, ainsi, de faciliter leur entreprise continue d’exploitation.
La décolonisation reste un phénomène contradictoire pour Chimni. D’un côté, l’émancipation politique des anciens territoires colonisés constitue un progrès important. De l’autre, « l’achèvement du colonialisme ne constitue pas celui de l’impérialisme mais le début d’une nouvelle phase : l’impérialisme sans colonies » (Chimni 1993, 235). La période 1945-1980 a ainsi été marquée par l’essor du néo-colonialisme, situation dans laquelle « l’indépendance politique marche main dans la main avec la dépendance économique » (Chimni 1993, 250), ce qui déteint sur le droit international. La souveraineté de chaque État était pour la première fois reconnue à part égale, mais ce principe juridique a pour autant cohabité avec des inégalités réelles favorisées par le droit international. Il faut souligner que ces États nouvellement dotés d’une personnalité juridique s’inscrivaient alors dans un droit écrit sous l’ère coloniale, « expression géométrique de l’hégémonie que la doctrine bourgeoise exerce encore aujourd’hui » (Chimni 1993, 255). Le droit international de cette période néo-coloniale peut dès lors être qualifié de droit « démocratique bourgeois » : à l’instar de la démocratie libérale, l’égalité formelle et la participation populaire y existent à côté de l’inégalité matérielle et des rapports d’exploitation.
Ainsi en parvient-on à la période actuelle, celle de la « globalisation ». À la suite de William I. Robinson, Chimni montre qu’à partir des années 1980 la principale évolution du capitalisme repose sur l’essor « d’une classe capitaliste transnationale », classe véritablement globale, sans attache précise à un système économique national, à la pointe du tournant de la «mondialisation ». Le capital transnational dépend de manière essentielle d’un « espace économique fonctionnel, homogène et mondialisé » et de la liberté de circulation pour les capitaux (Chimni 2005, 9). Pour Chimni, les institutions internationales jouent à ce titre un rôle crucial, et, de manière analogue à la fonction de l’État dans les phases antérieures du capitalisme, elles ont servi à faire tomber « les obstacles locaux à l’accumulation du capital » (Chimni 2005, 7). Ainsi, l’OMC, le FMI et la Banque mondiale ont-ils remodelé les économies des sociétés périphériques de manière à les rendre bien plus attractives aux yeux du capital transnational. En outre, ces institutions ont refondu, à travers les programmes de « bonne gouvernance », la vie politique des périphéries d’après ces mêmes objectifs.
Pour Chimni, la somme totale de ces rapports annonce la formation d’un État global, dont la fonction « est de réaliser au sein du système international les intérêts du capital transnational et des États forts au détriment des États et des peuples du Tiers-monde » (Chimni 2005, 1-2) : autrement dit d’incarner la fonction d’un État global impérial. Il faut remarquer ici que Chimni ne défend pas l’idée d’un État global qui aurait supplanté les États nationaux, mais soutient plutôt que la mondialisation a transformé la place structurelle qu’occupe chaque État souverain au sein de l’ordre international, ce qui a conduit à la création des institutions internationales et à la mise en œuvre par ces États des fonctions d’un État global. Comme cette évolution représente un pas en arrière face aux bénéfices du droit démocratique bourgeois, un nouveau mouvement social et global doit tenter de soumettre cette forme étatique aux principes de la démocratie et à l’autorité de la loi.
En un certain sens, il est possible d’interpréter le geste de Chimni comme une analyse matérialiste saisissant le droit international « par le haut », à partir des différents modèles de l’accumulation capitaliste et des activités de la classe dominante. Si la question de la « résistance » est néanmoins prise en compte, elle se trouve abordée lors de sa brève analyse de la décolonisation. En rupture manifeste avec cette approche, l’œuvre de Bill Bowring postule d’emblée que la loi et le droit ne peuvent être conçus comme des « formes vides et déracinées » (Bowring 2008, 109), mais au contraire comme des « sujets et des objets de luttes réels dans le monde effectif » (Bowring 2008, 111). Bowring tente ainsi d’offrir une « analyse substantielle » qui entend historiciser et saisir le droit international comme le produit des luttes entre groupes humains (Bowring 2008, 112).
À cette fin, il se définit en regard des arguments de Badiou pour qui l’histoire humaine est structurée autour d’« événements », de ruptures imprévisibles au sein du statu quo. L’événement constitue chez Badiou l’une des dimensions de la « procédure de vérité », avec la « fidélité » – les conséquences durables de l’événement – et la « vérité » – le résultat total de l’ensemble du processus. Les exemples classiques d’événements défendus par Badiou sont les Révolutions françaises et russes. Il soutient dans cette perspective propre que la fonction des droits de l’homme consistait à empêcher de tels événements, en récusant l’éventualité de toute alternative radicale à l’ordre en place. Contre cette interprétation, Bowring montre que les droits de l’homme ont en fait été constitutifs des révolutions française et russe, ce dont il tire alors une position théorique plus large.
Dans son raisonnement, le droit international – et les droits de l’homme en particulier – découlent effectivement de la fidélité à certains événements. Par conséquent, « les scandales et ruptures intervenues au travers des grands événement politiques contre les conditions d’existence sociale antérieures » se matérialisent dans le droit international ainsi que dans les droits de l’homme, ce qui permet ainsi de transmettre leur héritage. La structure classique des trois générations des droits de l’homme – libertés civiles et politiques, droits sociaux et économiques, droits civiques – coïncident aux trois grandes révolutions : 1789, 1917 et les mouvements de décolonisation.
C’est aux derniers que Bowring accorde le plus d’importance. Partant d’une critique de la théorie de la forme marchandise, il soutient que Pachoukanis et Miéville sont incapables de saisir le contenu politique essentiel de l’auto-détermination, et rappelle que le droit immédiat à l’auto-détermination fut uniquement défendu par l’Union soviétique et le mouvement anti-colonial, contre le souhait des puissances coloniales (Bowring 2008, 30). Cette revendication gagna le système plus large des Nations unies profondément transformé par l’entrée de nouveaux États dans ses rangs. Pour Bowring, comme pour Chimni, cet héritage précieux se trouve ébranlé par la conjoncture contemporaine. Mais à l’inverse de ce dernier, Bowring n’attribue pas cet effet à l’essor de la mondialisation ; il démontre au contraire que les juristes internationaux se sont laissés « séduire » par une promesse de pouvoir avant l’intervention au Kosovo, avant de devenir inopportuns et d’être mis de côté eux et leurs arguments juridiques. Bien sûr, Chimni et Bowring ne sont pas les seuls marxistes qui ont tenté de saisir ensemble le droit international et les dynamiques impérialistes (précises) issues de l’accumulation du capital (Neocleous 2012 ; Rasulov 2010).
Conclusion : et après ? que (reste-t-il à) faire ?
La 11e thèse sur Feuerbach est l’une des formules les plus fameuses de Marx : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de le transformer » (Marx et Engels 1969, 59). Bien qu’elle puisse être interprétée de façon ennuyeuse et rebattue, elle exprime une vérité de premier ordre au sujet des textes analysés ci-dessus. En arrière-fond, se cache la question du rôle que le droit peut jouer, si tant est qu’il en ait un, dans la lutte pour l’émancipation sociale. Cette question a marqué l’histoire des théories marxistes du droit, et a refait surface aujourd’hui à travers un certain nombre de débats (Baars 2011 : 415 ; Knox 2010 ; Taylor 2011).
Chacune des positions étudiées auparavant y apporte sa réponse, mais il est possible, de manière succincte pour le propos, de les répartir en deux camps : les opportunistes, qui à certains égards sont les plus nombreux, et les négateurs. Ainsi, Susan Marks soutient-elle que la critique de l’idéologie présente l’avantage, parmi d’autres, de ne jamais considérer l’idéologie comme unilatérale, et d’en maintenir l’instabilité. Il est ainsi toujours possible de découvrir des « logiques contre-systémiques » au sein du droit international, en identifiant la contradiction entre la réalité du droit et la promesse qu’il renferme, et en insistant sur la nécessité de satisfaire cette promesse (Marks 2003, 144). De manière similaire, il faut, selon Bowring, redonner sens à la fonction émancipatrice des droits de l’homme, inscrite dans leurs structures mêmes. Enfin, pour Chimni, le droit international « bourgeois et démocratique » ne doit pas être abandonné, parce que « le droit international contemporain offre un bouclier fragile mais tout de même protecteur pour les États moins puissants au sein des relations internationales » (Chimni 2003, 26).
Au rebours de ces arguments, China Miéville a souligné de manière incisive que « la tentative de remplacer la guerre et l’inégalité par le droit n’est pas seulement utopique – elle est précisément contre-productive ; un monde organisé autour du droit international ne peut être qu’un monde de violence impérialiste » (Miéville 2005, 319). Bien entendu, il s’agit simplement là d’une conséquence logique tirée du constat de Pachoukanis : le droit dépend structurellement du capitalisme. Plusieurs des auteurs précédents ont étayé cette thèse avec de solides d’arguments. Mais en réalité, cette bipartition tient à l’évidence de la simplification facile. Comme je l’ai montré ailleurs, la démonstration de Miéville vaut pour le lien structurel entre droit international et impérialisme, mais n’implique pas nécessairement de conséquences immédiates du point de vue des pratiques ordinaires.
Comme je l’ai montré ailleurs, ce débat – couramment ramené à l’alternative « réforme vs révolution » – doit être structuré autour des concepts de stratégie et de tactique (Knox 2010). D’un point de vue marxiste, les problèmes du monde ne découlent pas simplement d’événements hasardeux ; ils sont au contraire fondés sur des systèmes de rapports sociaux, plus vastes et plus profonds, doués d’une logique propre. Par conséquent, résoudre ces problèmes oblige de manière fondamentale à transformer l’ordre social, et pour ce faire, à s’impliquer parallèlement dans un certain nombre d’actions davantage locales et défensives, constituant la pratique ordinaire des mouvements sociaux.
Si d’un point de vue structurel et stratégique, il apparaît souhaitable à long terme de renverser l’ordre existant, néanmoins, d’un point de vue conjoncturel et tactique, il est nécessaire à court terme de composer avec. Par conséquent, la tâche consiste à savoir de quelle manière stratégie globale et tactiques locales interagissent. Or cette question ne peut être résolue de manière purement empirique. En effet, si les réflexions précédentes sont justes, alors ce qui pourrait avoir la forme de l’émancipation est susceptible à terme de renforcer les rapports d’oppression et de domination. Ainsi est-il nécessaire, pour répondre à ce problème, de se doter d’une jurisprudence théorique plus approfondie au sujet des relations entre droit et capitalisme, ou droit et impérialisme, comme du mode de légitimation propre de la loi (Knox 2011, 9). Pachoukanis comme Miéville ont eu le mérite d’avoir réellement essayé de produire une telle théorie, quel que soit l’avis que l’on en retire. Bien que la majorité des travaux cités relève d’un pareil geste, ou implique tacitement de telles perspectives théoriques (sur le « droit » comme forme sociale nécessaire à toute société par exemple), les élaborations systématiques sur ces questions restent peu nombreuses. Pour l’heure, alors que la réflexion pourrait avancer à pas de géant, la question des rapports entre droit et transformations sociales au sens large – à entendre sûrement comme la question des théories marxistes du droit – demeure sans réponse.
Traduit de l’anglais par Olivier Chassaing.
Bibliographie
Grietje Baars, « Reform of Revolution – Polanyian versus Marxism Perspectives on the Regulation of the Economic », Northern Ireland Legal Quarterly, 62, 2011
Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, Paris, Unesco, 1979.
Bill Bowring, Degradation of the International Legal Order: the Rehabilitation of Law and the Possibility of Politics, London, Routledge-Cavendish, 2008
Maureen Elizabeth Cain and Alan Hunt, Marx and Engels on Law, London, Academic Press, 1979
B. S. Chimni, International Law and World Order: A Critique of Contemporary Approaches, Sage Publications, 1993
–, « Marxism and International Law: A Contemporary Analysis », Economic and Political Weekly, 337, 1999
–, « Third World Approaches to International Law: A Manifesto », International Community Law Review, 3, 8, 2006
–, « International Institutions Today: An Imperial Global State in the Making », European Journal of International Law, 15, 1, 2004
–, « Prolegomena to a Class Approach to International Law », European journal of international Law, 21, 57, 2010
Alan Hunt, « The Ideology of Law: Advances and Problems in Recent Applications of the Concept of Ideology to the Analysis of Law », 19, Law & Society Review, 1985, p. 11-37
Friedrich Engels (14 juillet 1893), « Lettre à Franz Mehring » in Karl Marx et Friedrich Engels, Œuvres choisies, t. 3, Moscou, Editions du Progrès, 1970
John N. Hazard, « Pashukanis is No Traitor », The American Journal of International Law, Vol. 51, No. 2, Apr. 1957, pp. 385-388
Karl Kautsky, « The League of Nations », Justice, 10 April 1924
Robert Knox, « Marxism, International Law, and Political Strategy » (2009), Leiden Journal of International Law, p. 413-436
–, « Strategy and Tactics », Finnish Yearbook of International Law, 21, 2010, p. 193-229
–, « What is to be Done (With Critical Legal Theory)? », Finnish Yearbook of International Law, 22, 31, 2011
Tor Krever, « International Criminal Law: An Ideology Critique », Leiden Journal of International Law, 26, 03, 701, 2013
Vladimir I. Lénine (1916), L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, essai de vulgarisation, Moscou, Éditions en langues étrangères, 1947
–, « A Caricature of Marxism and Imperialist Economism » in M.S. Levin (ed.), V.I. Lenin, Collected Works, vol. 23, Moscow, Progress Publishers, 1964
–, « Speech at 2nd All-Russia Conference on Rural Work » in M.S. Levin (ed.), V.I. Lenin, Collected Works, vol. 31, Moscow, Progress Publishers, 1966a
–, « Speech Delivered at a Conference of Chairmen of Uyezd Volost and Village Executive Committees of Moscow Gubernia October 15, 1920 » in M.S. Levin (ed.), V.I. Lenin, Collected Works, vol. 31, Moscow, Progress Publishers, 1966b
–, « Conditions of Admission Into the Communist International » in M.S. Levin (ed.), V.I. Lenin, Collected Works, vol. 31, Moscow, Progress Publishers, 1966c
Susan Marks, The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology, Oxford, Oxford University Press, 2003
–, « International Judicial Activism and the Commodity-Form Theory of International Law » (2007), European Journal of International Law, p. 199-221
–, « Introduction » in Susan Marks (ed.), International Law on the Left : Re-examining Marxist Legacies, Cambridge University Press, 2008
–, « False Contingency », Current Legal Problems, 2009, volume 62, p. 1-21
–, « Human Rights and Root Causes », The Modern Law Review, Volume 74, Issue 1, pages 57-78, January 2011
Karl Marx (1843), La Question juive, Paris, 10/18, Paris, 1968
– (1849), Travail salarié et capital, Pékin, Éditions en langues étrangères, 1966
– (1859), Contribution à la critique de l’économie politique, Paris, Éditions sociales, 1972
– (1867), Le Capital (livre I), Paris, Garnier-Flammarion, 1969
Karl Marx et Friedrich Engels (1845), L’idéologie allemande, 1e partie : Feuerbach, Paris, Editions Sociales, 1969
– (1848), Manifeste du Parti communiste, Paris, Éditions Sociales, 1972
China Miéville, Between Equal Rights: A Marxist Theory of International Law, Leiden, Brill, 2005
Evguéni B. Pashoukanis, La Théorie générale du droit et le marxisme, Paris, EDI, 1970
–, « International Law », in Piers Beirne and Robert Sharlet (eds.), Pashukanis, Selected Writings on Marxism and Law, London, Academic Press, 1980
Mark Neocleous, « International Law as Primitive Accumulation; Or, the Secret of Systematic Colonization », European Journal of International Law, 23, 2012, p. 941-962
Akbar Rasulov, « Writing About Empire: Remarks on the Logic of a Discourse », Leiden Journal of International Law, 23, 2010, p. 449-471
Owen Taylor, « Reclaiming Revolution », Finnish Yearbook of International Law, 22, 2011, p. 259-292
Ellen Meiksins Wood, Empire of Capital, London, Verso, 2003