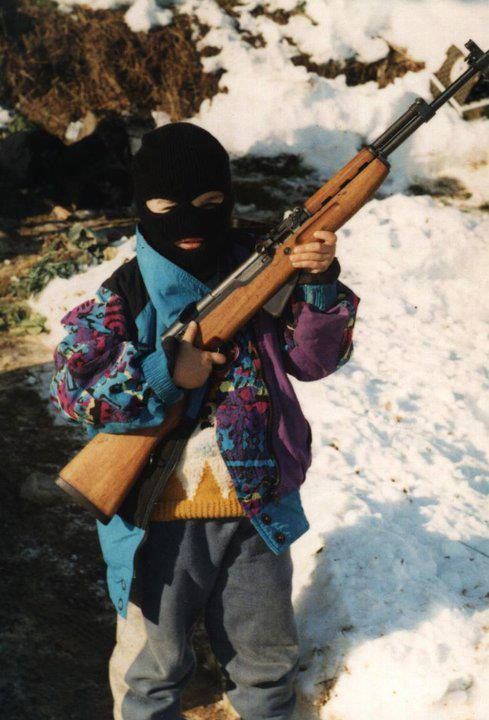Tu es poète et professeur de littérature ; comment en es-tu venu à écrire un livre sur les émeutes et l’économie ?
Il y a plusieurs réponses à cela. D’abord le fait qu’aux États-Unis – j’ignore comment ça se passe en France –, personne n’enseigne purement la littérature. J’ai toujours enseigné la littérature et l’économie et je me suis spécialisé en littérature et en théorie des crises. J’ai donc beaucoup écrit sur les crises économiques, la financiarisation et les transformations du système-monde après 1973. Les émeutes sont entrées dans ce cadre intellectuel par la bande, en quelque sorte, parce que, comme j’ai une autre vie de militant politique, j’ai vu des émeutes, participé à des émeutes, je trouve qu’il s’agit d’un intéressant phénomène humain et elles me paraissent avoir une place de plus en plus grande dans les endroits du monde que je connais, en particulier aux États-Unis et en Angleterre. Je me suis donc mis à réfléchir à ces deux choses conjointement, pour tenter de comprendre – en prenant bien soin d’éviter tout jugement moral – la place de plus en plus centrale de l’émeute comme forme de lutte politique.
Tu as été très impliqué dans le mouvement Occupy Oakland.
Personne ne dirait avoir été très impliqué. Moi j’y étais le premier jour. Le phénomène Occupy a bénéficié d’une grande visibilité aux États-Unis mais on oublie souvent qu’il s’agissait d’un résultat plutôt que d’un commencement. Dans la baie de San Francisco, où je vis, Occupy a été le produit de deux types de luttes : les luttes dans l’université, qui ont débuté en 2009, en l’honneur ou dans la tradition de ce qui se passait déjà en Grèce, à Vienne, dans d’autres endroits d’Europe et à New York. Mais outre les luttes universitaires, qui ont rassemblé un certain groupe de militants, il y a eu une série d’émeutes après qu’un jeune Noir, Oscar Grant, a été tué par la police, en 2009, et ces émeutes ont aussi réuni tout un ensemble de militants. Ces deux groupes se sont en partie rejoints, et c’est de là qu’est parti Occupy Oakland, qui a ensuite développé une existence propre.
Donc ton livre tente de clarifier ta propre pratique politique sur un plan théorique et historique ?
Dans une certaine mesure, c’est sans doute le cas de tous les livres. Pour ma part, je ne sais pas si c’était aussi conscient. Les émeutes sont, affectivement, des expériences fortes pour les individus et elles l’ont clairement été pour moi. Mais en écrivant le livre, je voulais les mettre à distance et, plutôt que faire un récit à la première personne du genre « J’étais là, les vitres brisées, les poubelles en feu », essayer de les théoriser à partir de l’économie politique. Mais quoi qu’il en soit, oui, c’est mon parcours qui a fait des émeutes un problème à élucider.
Des années 1980 au début des années 2000, il y avait un divorce entre théorie et pratique politique, en particulier aux États-Unis, avec ce paradoxe que d’une certaine façon la radicalité politique a survécu dans les départements de littérature et de sciences sociales plutôt que dans les rues : par conséquent, et même si tout livre peut être une tentative de comprendre sa propre pratique, ton livre fait aussi partie de ceux qui tentent de combler ce fossé auquel nous nous étions habitués.
C’est vrai, et à mon avis, il faut se rappeler que la période de la disparition du bloc soviétique a aussi marqué la fin d’une volonté révolutionnaire de dépasser le capitalisme libéral-démocrate. Durant cette période de mise en cause de la plausibilité de certains types de lutte et de pratique politique, ce sont des théoriciens, des philosophes, parfois dans des départements de littérature, qui ont tenté de conserver la flamme du communisme ou de maintenir l’horizon communiste. C’était assez frustrant car tous ces discours semblaient idéalisés, abstraits ou détachés des luttes, mais on n’avait pas le choix. On n’avait pas de lutte à laquelle rattacher la théorie, et c’est cela qui a commencé à changer dans les années 2000, en particulier après la crise de 2008. Il est amusant de noter au passage que l’un des derniers moments de cette période correspond à l’un des fameux colloques organisés par Verso, « L’idée du communisme », où des intellectuels (dont Alain Badiou) donnent des analyses très classiques, très formelles, tandis que des émeutes éclatent en quelque sorte au bout de la rue. Mais théoriciens et « praticiens » se rejoignent de plus en plus, et de toute façon, comme je l’explique au début de mon livre, la théorie naît de la pratique – proche ou lointaine – et je voulais faire de mon mieux pour suivre cette séquence.
Après 68, à partir de la fin des années 1970, on a assisté au retour d’une forme plus traditionnelle de philosophie politique et de débats sur les concepts de démocratie, de justice, de politique, etc. La publication d’Empire de Hardt et Negri (2000) et le renouveau des débats sur le communisme ont d’une certaine façon changé la donne, mais il s’agissait encore de catégories abstraites ou générales. Ce qui me paraît intéressant dans ton livre, c’est qu’il traite moins de concepts que de formes et de moments de lutte : la grève, l’émeute.
Ce résumé me semble tout à fait juste. Tu évoques Empire : ce livre a été galvanisant et en même temps c’était en effet une analyse abstraite du politique, pas une abstraction réelle (je tiens beaucoup à cette expression) mais une abstraction légitime. Il se confrontait à une énigme pratique, comprendre le sujet politique mais aussi la possibilité d’une nouvelle collectivité politique pour des sujets qui n’étaient plus réunis dans l’usine, comme dans le grand modèle marxien du Capital, mais se rassemblaient sur internet de plein d’autres façons. Il s’agissait de voir si ces sujets pouvaient constituer une force d’opposition similaire à celle qu’avait été la classe ouvrière. Empire s’intéressait à l’abstraction d’internet, à l’abstraction de la vie quotidienne, toutes choses qui ont une réalité, et c’est pourquoi l’abstraction du livre avait une légitimité. Cela dit, la thèse ne m’a pas convaincu et je crois que des objets concrets, tactiques et stratégiques, ou des événements, comme les émeutes, n’ont jamais disparu. Ils ont connu des périodes de flux et de reflux, mais ils n’ont jamais disparu.
À mes yeux, l’un des problèmes était l’association entre ces activités ou événements et des polarisations idéologiques. Par exemple, l’émeute s’intégrait à la catégorie abstraite d’anarchisme, pour laquelle j’ai une certaine sympathie quoique je ne croie pas être anarchiste, tandis que l’activité concrète de la grève était associée à l’idéologie du communisme. Cela m’apparaissait comme une forme de réification inadéquate aux transformations historiques qui étaient en train de s’accomplir. Donc le but du livre est en partie de rouvrir ces catégories et de les rendre à nouveau pensables, de les considérer d’un regard neuf, au lieu de penser que l’on sait ce qu’est une grève, ce que les gens font pendant une grève, que l’on sait ce qu’est une émeute et quel type de personnes y prennent part, etc.
Ton livre se présente en effet comme une tentative de réconcilier deux traditions, le marxisme et l’anarchisme, et de dépasser les oppositions traditionnelles entre spontanéité et organisation ou entre moment présent et orientation vers l’avenir. C’est pourquoi tu construis un récit historique très particulier, articulé sur une séquence en trois temps : l’émeute, la grève et ce que tu appelles « émeute’ [prime] ». À te suivre, l’émeute est la forme de lutte des débuts du capitalisme, la grève la forme de lutte qui domine à partir de la révolution industrielle, et l’émeute’ cette forme de lutte encore assez indéterminée et difficile à définir qui marque la période contemporaine depuis les années 1960. De quelle façon l’émeute diffère-t-elle de l’émeute’ ? Et l’émeute’ inclut-elle ou subsume-t-elle le stade antérieur de la grève ?
Le livre est lui-même une simplification, une schématisation ou une modélisation. Et bien sûr cela implique de laisser de côté un grand nombre de choses. La question pour moi n’est pas de savoir ce qu’on perd à modéliser mais au contraire ce qu’on peut y gagner. Je soulignerai que dans la séquence émeute-grève-émeute’, aucun des termes n’est indépendant des autres, chacun naît des autres : j’ai tenté d’expliquer comment la grève naît de l’espace de l’émeute, qui est celui de la circulation. C’est l’une des catégories maîtresses du livre. Dans la critique marxienne de l’économie politique, la circulation et la production impliquent des activités concrètes et pratiques, mais il existe aussi des agencements sociaux orientés vers la production ou la circulation (le marché, l’échange, la consommation, etc.).
Ma thèse est que le principal antagoniste du capitalisme naissant vient de l’espace de la circulation. Le capital est unité de la circulation et de la production : or l’antagoniste fondamental est interne au capital mais extérieur à la production – c’est l’époque des émeutes. Le développement de la révolution industrielle parviendra à intégrer cet antagoniste dans la production. Puis, avec la désindustrialisation des principaux pays industriels, celui-ci sera de nouveau extériorisé : il restera dans le capital tout en étant exclu de la production. C’est là que se trouve le lien entre les deux périodes des émeutes, « émeute » et « émeute’ ».
Le livre montre comment la grève naît de l’émeute : c’est une lutte interne à la sphère de la production, mais au départ elle se développe dans le secteur des transports et les ports avant de s’implanter dans l’usine. Et de la même façon, la grève commence à disparaître parce que la productivité industrielle exclut la force de travail du procès de production ; un nombre grandissant de personnes dépend du marché sans avoir directement accès au salaire, et c’est là que l’on revient à l’émeute. Il existe une continuité historique entre A, B et C, ainsi qu’un lien entre A et C. Les différences tiennent en grande partie à la nature des sujets qui sont exclus de la production. Comme cela varie d’un pays à l’autre, je ne veux pas trop simplifier. Mais aux États-Unis il existe un lien fort entre les personnes externalisées – la « surpopulation » au sens de Marx – et les communautés non blanches, en particulier les Noirs. Dans les pays scandinaves et en France, il s’agit souvent des populations immigrées. Donc la principale différence entre la période « émeute’ » et la période initiale des émeutes réside dans la dimension raciale.
Tu associes la séquence émeute-grève-émeute’ à différents stades du développement capitaliste, en t’appuyant principalement sur la périodisation proposée par Giovanni Arrighi dans The Long Twentieth Century. Pourrais-tu expliciter la relation entre ces phénomènes sociopolitiques et les cycles économiques ? Y vois-tu une forme de causalité expressive, et serais-tu, en un sens, un marxiste « mécaniste » ?
La médiation fait partie des catégories que je ne crois pas assez bien comprendre pour avoir une position à leur sujet. Selon Arrighi, tout régime d’accumulation capitaliste comporte trois phases, qui semblent toutes suivre le même schéma, allant du capital commercial au capital industriel et enfin au capital financier, fondamentalement lié au capital bancaire. Les Provinces-Unies, le Royaume-Uni et les États-Unis ont chacun dominé un cycle d’accumulation. L’ambition (peut-être excessive) du livre consiste à projeter ces trois périodes de luttes sur des périodes du capital. Il faudrait un livre entier pour étayer cette thèse économico-politique de manière convaincante. La question est donc la suivante : si l’on accepte ma proposition, du moins à titre d’expérience de pensée, quelle serait la causalité ? Je n’ai pas du tout peur des positions causalistes, même si les communistes orthodoxes me disent souvent que je suis un anarchiste parce que mon analyse du politique leur semble inadéquate ; et à l’inverse, les anarchistes diront que mon approche est trop déterministe, voire qu’elle relève de la causalité expressive.
Or je crois, comme Marx, aux lois du mouvement de l’histoire : on construit des modèles précisément pour montrer qu’une causalité est à l’œuvre. Ceux qui ne recherchent pas des causes ne m’intéressent pas : je trouve que cela n’a aucun intérêt de regarder les étoiles en se contentant d’énumérer leurs noms et que l’on doit s’efforcer de comprendre les causes de leurs mouvements et de les prédire, même si cela ne reste qu’une approximation. Je tiens donc à l’approche causale.
En revanche, je ne comprends pas vraiment la médiation, en fait je crois que personne n’en a une compréhension réelle. Cela dit, le pur économique, le pur politique n’existent pas, la nature du capital fait que ces domaines ont perdu leur autonomie pour devenir une unité. C’est lorsqu’on les sépare que l’on commet des erreurs. J’ignore ce qui se passe dans la conscience des sujets, comment la grande transformation de la composition de classe est éprouvée consciemment, inconsciemment, comment elle fait son chemin en moi de sorte qu’un jour, en entendant un grand bruit dans la rue, je me mette à penser : « Il faut que j’y aille et je n’hésiterai pas à m’en prendre aux flics. » La médiation est une boîte noire, et c’est pourquoi le livre l’évite soigneusement.
Mais quoi qu’il en soit des médiations, je crois que l’on peut tout de même parler de tendances : on constate que des tendances se dégagent, que certaines choses se produisent plus souvent que d’autres, et on cherche à les expliquer. Par exemple, ma thèse relative à la circulation est très simple. Au niveau le plus élémentaire, elle est que l’on ne peut pas faire grève si l’on n’a pas de salaire. On se trouve dans l’espace social et conceptuel de la circulation, même si l’on n’est pas sur le marché, dans une relation d’échange, dans la production. Quand on n’a pas de travail et que la possibilité de la grève est exclue, on va se battre d’autres manières : dans les rues, sur le marché – et c’est ce qui sera appelé « émeute ». Ma seule thèse est qu’il est sensé de dire que le passage de l’économie à la circulation entraîne un passage politique à ce que j’appelle des luttes au sein de la circulation.
On pourrait aussi évoquer un phénomène contemporain qui se rattache à ta distinction entre production et circulation : le fait que les individus sont en quelque sort scindés, dans la mesure où leurs intérêts de travailleurs (obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail, lorsqu’ils ont du travail) s’opposent à leurs intérêts de consommateurs (acheter des marchandises au prix le plus bas).
D’une certaine façon, tu nommes là l’une des contradictions fondamentales du capital, que l’on peut rattacher à la contradiction entre valeur d’usage et valeur d’échange. Sur le marché, en tant que consommateur, on a seulement affaire à la catégorie de prix, tandis qu’en tant que travailleur, ce qui nous intéresse, même si l’on n’en a pas conscience, c’est la catégorie de valeur, puisque c’est la valeur qui détermine le temps de travail socialement nécessaire, ou inversement le temps de travail socialement nécessaire qui détermine la valeur, la base du salaire. Mais évidemment, le temps de travail n’est pas payé en valeur, mais en prix. Dans la sphère de la production, on est marié à l’idée de valeur, alors que dans la sphère de la circulation, on se situe au niveau du prix. C’est là une contradiction profonde, qui est la source même des crises : le fait que le capital tente toujours de générer des profits (mesurés en prix) mine sa capacité à générer de la plus-value. Il tente de réduire les coûts de production et de circulation, notamment en expulsant la force de travail qui constitue la source de la valeur, de sorte que la quête de profit met en péril sa capacité à accumuler de la valeur.
Quant à la contradiction entre notre être de producteur et notre être de consommateur, nous tentons en tant que consommateurs de racheter une part de ce que nous avons produit. Mais cela revient à laisser intacte la contradiction entre prix et valeur. Dans le livre, qui envisage le capitalisme sur une longue période, je parle souvent d’une courbe de l’accumulation : le capitalisme naissant croît assez vite et possède un grand dynamisme et une forte capacité d’expansion, il génère énormément de plus-value, l’accumulation est rapide, puis arrive un moment où il atteint un pic (plusieurs en fait, comme Henryk Grossmann l’a très bien montré), il expulse une trop grande quantité de force de travail, l’accumulation commence alors à décliner et le capital continue de faire des profits mais sans accumulation. Dans la périodisation que je propose, le début de la courbe de l’accumulation correspond à l’émeute, son moment ascendant correspond à la grève, puis quand la courbe décroît, on revient à l’émeute. Ces différentes périodes sont donc très étroitement liées à l’expression concrète de la contradiction entre valeur d’usage et valeur d’échange, entre valeur et prix.
Ton articulation des luttes et des cycles économiques pourrait aussi être interprétée comme une manière d’articuler différentes échelles, de relier la lutte la plus locale au capital compris à la fois comme processus global et comme abstraction. Et du même coup, se pose la question de l’articulation entre le concret et l’abstrait, par exemple celle du corps, de l’implication de corps physiques dans un espace physique, où la police en tant qu’agent physique constitue l’incarnation de l’abstraction que constitue le capital.
Mon propos se veut plus humble : je voudrais seulement que l’on envisage autrement les émeutes et les possibilités qu’elles offrent. Malgré ce que m’ont dit de nombreux lecteurs, mon livre n’est pas une défense et illustration de l’émeute, et je ne crois pas que l’émeute soit la voie royale vers la révolution. Je voulais m’élever contre le rejet et le mépris dont l’émeute fait l’objet au sein de ce que j’appelle « la gauche du Parti de l’ordre [the Left Party of Order] », donc proposer un rééquilibrage. Mais les gens ont tendance à concevoir l’émeute comme un phénomène excessivement local, à l’associer au spontanéisme, à la réduire à un événement bref, qui disparaît aussi vite qu’il est survenu. Il y a là une part de vérité, même si, pour prendre un exemple récent, la première émeute de Ferguson a duré plus de deux semaines, soit plus longtemps que la majeure partie des grèves. L’une des ambitions du livre, c’est d’envisager l’extension des émeutes, dans l’espace et dans le temps. En effet, dès que l’on considère l’émeute comme l’expression concrète d’une situation abstraite – les transformations des classes, du capital, de la production –, on commence à percevoir une unité sous-jacente entre les multiples émeutes. L’émeute est donc pour moi une série d’expressions locales d’un phénomène global, mais inégalement global. Et bien que ma thèse se limite aux premiers pays industrialisés, je pense qu’il existe ailleurs des trajectoires similaires, réparties inégalement au cours des vingt dernières années. Penser l’émeute politiquement, ce n’est donc pas s’intéresser aux désirs de ses sujets, même s’ils sont importants, mais la concevoir comme l’expression sur le plan politique d’une économie politique sous-jacente. En ce sens, les émeutes entretiennent entre elles une complicité secrète, qui devient de plus en plus visible au fil du temps ; et plus concrètement, on peut imaginer qu’à un moment, deux foyers d’émeute seront suffisamment rapprochés pour se rencontrer et n’en faire plus qu’un – alors on se demandera si l’on ne peut pas parler de révolution. Je ne pense pas que l’émeute puisse se généraliser : l’émeute telle que je la définis est limitée à un certain rapport au marché qui disparaîtra à un moment. Pour moi, il y a des luttes après l’émeute mais pour l’heure, il est capital de comprendre chaque émeute comme une extension, sur le plan concret, dans un moment et un lieu déterminés, de la substance de la politique (« substance », au sens spinozien du mot).
Tu disais que la race était un élément central des émeutes contemporaines. Pourrais-tu développer ce point ? Par exemple, tu rappelles dans le livre qu’aux États-Unis dans les années 1960, le Black Power avait coutume d’opposer sa lutte à celle des travailleurs blancs.
À mon sens, la relation entre émeute et race se décline sur deux axes. L’histoire et les dynamiques sociales de la race aux États-Unis sont connues dans le monde entier, et en même temps elles sont très spécifiques, c’est pourquoi je ne veux pas trop généraliser. Donc, s’agissant du premier axe : le processus de production d’une population excédentaire. L’industrialisation entraîne un immense transfert de la force de travail, qui passe de l’agriculture à l’industrie. Le plus grand transfert de force de travail de l’histoire de l’humanité est en grande partie un transfert des communautés rurales aux communautés urbaines. Le secteur agricole, qui connaît une hausse considérable de sa productivité à la fin du XIXe et au début du XXe, met au chômage un grand nombre de travailleurs. Le secteur des services ne peut absorber cette force de travail dans sa totalité, et la population excédentaire venue du secteur agricole est en grande partie constituée de travailleurs noirs, qui, après la fin de la guerre civile et l’abolition de l’esclavage, migrent du Sud vers les villes industrielles du Nord, et du Midwest vers l’Ouest. C’est ce qu’on appelle les première et deuxième grandes migrations. Cette population arrive dans le secteur industriel relativement tard, et pendant longtemps, les syndicats tentent de la tenir à l’écart, dans le style bien raciste des institutions états-uniennes. Elle arrive tard, et elle est aussi la première à se faire licencier. Voilà pour le premier axe : lorsqu’une surpopulation est produite dans le secteur industriel, elle est composée majoritairement (mais pas exclusivement) de Noirs.
Le second axe concerne le rapport de l’émeute à la racialisation. Aux États-Unis, l’émeute est socialement codée comme le recours « quasi politique » des populations pauvres, historiquement assimilées aux Noirs. Les Noirs font des émeutes et les Blancs font la grève. Ce n’est évidemment pas vrai : les travailleurs noirs se sont souvent et fortement mobilisés, notamment à Detroit dans le secteur automobile, et il en va de même des ouvriers latinos. Et les Blancs font tout le temps des émeutes, même si bizarrement, aux États-Unis, on ne parle pas d’émeutes dans ce genre de cas. Par conséquent, cette dichotomie est fausse mais idéologiquement codée. Et cette idéologie se combine à une thèse historique relative à la structure du prolétariat : il existe une aristocratie ouvrière composée de travailleurs blancs et mâles, qui occupent des emplois privilégiés et des positions syndicales au détriment des peones que sont les femmes, les Noirs et les autres populations non blanches. Cette division interne au prolétariat se rejoue donc dans la distinction idéologique entre l’émeute et la grève. Par conséquent, une fois que ce type d’idéologie s’est formalisé et solidifié, sa direction s’inverse : participer à une émeute, c’est par transitivité devenir noir. Cela ne veut pas dire que si je suis blanc, j’ai plus de chances de me faire tirer dessus par la police. Je veux juste souligner comment fonctionne la racialisation aux États-Unis et sans doute ailleurs. Enfin, si l’émeute est un phénomène racial, c’est aussi un phénomène de classe, produit des transformations du capital. Le livre tente de mobiliser les deux éléments, la production d’une surpopulation et la racialisation, pour comprendre la co-articulation de la race et de la classe. C’est toujours un défi pour les marxistes, ça ne marche jamais parfaitement, mais ça me semble absolument nécessaire.
La race est aussi mobilisée pour discréditer l’émeute et en faire une forme de lutte « proto-politique ».
Absolument. Beaucoup d’idéologies sont associées aux émeutes : l’anarchisme, la noirceur, l’illégitimité. Elles ne peuvent être vraiment politiques parce qu’elles ne sont pas vraiment discursives. On n’est vraiment dans la sphère de la politique que si l’on reconnaît le monopole de la violence par l’État et si l’on accorde un primat à la négociation. Or, comme les émeutes ne veulent rien négocier, qu’elles ne formulent pas de revendications (hormis une revendication assez abstraite : « Il faut en finir ») et qu’elles ne reconnaissent pas le monopole étatique de la violence, elles ne peuvent être tenues pour politiques. Elles sont exclues de la vraie sphère de la politique et codées comme noires. Et, comme par magie, être noir, c’est être exclu de la sphère de la vraie politique. Ce transfert est central dans l’histoire politique états-unienne.
Le dernier chapitre du livre porte sur l’émeute contemporaine et la commune. Considères-tu qu’il existent une continuité entre la première et la seconde ? Par ailleurs, tu ne parles jamais de l’État, tu ne dis jamais comment la commune se rapporte à l’État, qui, à te lire, apparaît comme un appareil purement répressif, non comme une entité complexe, traversée de contradictions et, à bien des égards, constitutive de la vie quotidienne et de la subjectivité.
Comme je viens d’Oakland, pour moi l’État n’est rien d’autre que la police ! Je sais bien que l’État est un être complexe, doté d’une histoire complexe, mais je pense qu’il faut cesser de s’y intéresser. Depuis plusieurs décennies, si ce n’est un siècle, le problème est que les luttes politiques se sont beaucoup trop attachées à l’État. Il est très rare aujourd’hui qu’elles s’attaquent directement à l’économie ; il s’agit en règle générale de combattre l’État, ou du moins son appareil répressif, de s’emparer de l’État, de l’organiser, de le réorganiser, d’en prendre le contrôle… L’idée qu’il faut se confronter à la question de l’État est absurde : il faut au contraire nous détourner de cette question qui a presque entièrement monopolisé notre attention.
Quant au mot « commune », j’en fais un usage très particulier. Malgré les nombreuses tentatives de définir la commune comme phénomène historique éphémère, pour moi il ne s’agit pas immédiatement d’une forme politique ou sociale. Elle le deviendra inévitablement, mais dans la mesure où elle naît de la grève et de l’émeute, elle est d’abord un ensemble de problématiques, de stratégies et de tactiques liées à des situations particulières. En effet, les stratégies et les tactiques qui s’offrent à nous ne sont pas les mêmes selon que l’on dépend du marché et du salaire ou que l’on dépend du marché mais pas du salaire. Quoi qu’il en soit, même si l’émeute parvient à s’attaquer à l’économie (plutôt qu’à l’État), elle ne pourra pas résoudre les problèmes fondamentaux. Je ne crois pas qu’il soit encore possible de s’emparer du marché, de la boulangerie, de la cordonnerie, etc., pour résoudre ses problèmes de subsistance, du fait de l’expansion et de l’aérosolisation du marché et de la production.
La grève a épuisé ses possibilités, l’émeute est en plein essor mais elle finira par atteindre ses limites, et alors se posera une troisième question : comment reproduire notre existence indépendamment du salaire et du marché ? Pour moi, c’est là la question de la commune. La réponse peut prendre de multiples formes, et les diverses communes que l’on a connues à travers l’histoire ont été, dans leurs tentatives, imparfaites mais remarquables, de s’émanciper de la logique du salaire et de la logique du marché capitaliste, une anticipation de que sera à l’avenir la lutte communiste. Et la question de la reproduction implique de traiter celle du genre, de qui effectue le travail reproductif – sur ce point, il est essentiel de puiser dans les féminismes marxistes et matérialistes. Voilà pourquoi la commune est une tactique, mais une tactique qui produira forcément une forme de vie. Historiquement, la commune, la forme de vie que cette lutte a produite, a eu tendance à se détacher non seulement des catégories économiques mais aussi de l’État. En fait, je ne pense pas qu’il soit possible de faire l’un sans l’autre. L’idée contraire correspond au rêve communiste du XXe siècle. Ou pour reformuler, je ne crois pas que l’on puisse résoudre le problème de la reproduction collective en s’émancipant du salaire et du marché mais pas de l’État, du moins sous les formes que nous lui connaissons.
Je voudrais préciser un peu ma pensée pour éviter des malentendus. D’abord je ne crois absolument pas que cette prise de distance avec l’État, le marché, le salaire peut prendre la forme passive du retrait : « On deviendra des hippies, on ira vivre à la campagne, on fera pousser des courgettes, et voilà, le communisme sera réalisé. » Il faudra en passer par un conflit frontal, notamment parce que même si le capital a beaucoup automatisé, et même s’il a de moins en moins besoin de nous en tant que travailleurs, il a toujours besoin de notre participation, au moins en tant que consommateurs. Toute tentative de détachement passif serait immédiatement bloquée par l’État en tant que représentant du capital, qui commencerait par prendre des dispositions juridiques avant d’opter pour des solutions plus brutales. Le détachement ou la déconnexion n’a rien de facile et implique une confrontation violente. Ensuite, quand je dis qu’il faut se détacher de l’État, du marché et du salaire, je ne prône pas une joyeuse absence d’organisation. Si je ne crois pas que la forme État et le communisme d’État soient une solution, je ne m’oppose absolument pas à l’idée que l’on se rassemble et que l’on discute de mesures politiques, d’idées, de projets d’organisation. Tout ce que je refuse, c’est que la catégorie d’organisation ou de coordination soit automatiquement associée à quelque chose comme le parti et la forme État. C’est ce que l’on a connu au cours du siècle passé, mais il n’en va pas nécessairement ainsi. C’est même une maladie dont il semble que nous sommes en train de guérir.
Entretien réalisé le 30 septembre 2016. Mené, édité et traduit par Nicolas Vieillescazes