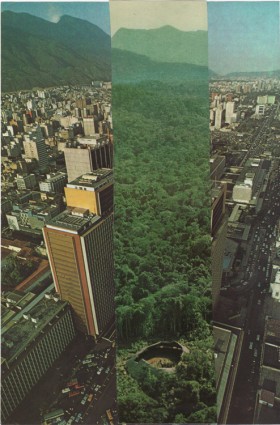Le « capitalisme cognitif » et le « travail cognitif » ont représenté des concepts cruciaux dans les débats récents sur le capitalisme contemporain. À travers ces notions, il s’agissait de saisir la pertinence stratégique de la connaissance pour l’accumulation du capital, du point de vue de la composition du travail impliquée dans la production du savoir lui-même. Dès le départ, des questions aussi importantes que la précarité, les réseaux et les transformations de l’État-providence sont entrées en jeu dans ces débats. L’une des critiques les plus répandues des concepts de « capitalisme cognitif » et de « travail cognitif » touchaient aux théories de la « division internationale du travail ». On affirme souvent que si le capitalisme et le travail peuvent bien s’avérer « cognitifs » en Occident, ils demeurent industriels (voire se caractérisent par des formes d’extraction plus « anciennes » et par la soi-disant « accumulation primitive ») dans « une large partie du monde ».
Cet article peut être lu comme une contribution à la discussion. Le concept de « capitalisme postcolonial » proposé dans les pages qui suivent doit être compris comme un complément aux débats actuels sur le capitalisme cognitif et suggère quelques modifications importantes de la notion elle-même. En prenant comme point de départ la critique des théories des « stades » de développement capitaliste récemment proposée par plusieurs analyses postcoloniales, l’étude soutient que l’un des éléments fondamentaux des transitions globales du capitalisme aujourd’hui repose sur une sorte de bouleversement géographique impliquant un constant mélange des échelles d’accumulation, de dépossession et d’exploitation. Cela implique que de grandes divisions spatiales comme le centre et la périphérie, le Nord global et le Sud global, le premier et le tiers monde, soient de plus en plus questionnées voire ébranlées. Du point de vue des débats actuels sur le capitalisme et le travail cognitifs, les conséquences ne sont pas négligeables. D’une part, le concept de capitalisme postcolonial ouvre un espace dans lequel le rôle de la production et des économies de la connaissance peut être analysé d’un œil critique, bien loin des frontières de l’« Ouest » – en tant qu’élément distinctif du capitalisme contemporain dans son extension mondiale. D’autre part, il indique l’importance accrue des formes d’extraction et de soi-disant « accumulation primitive » dans les anciens centres métropolitains de la modernité coloniale. Plus généralement, le concept de capitalisme postcolonial souligne la pertinence de la diversité d’échelles, de lieux et d’histoires dans la structure du capitalisme mondial, ce qui pousse à nuancer les théories du capitalisme et du travail cognitifs, qui apparaissent trop souvent comme détachées de ces hétérogénéités spatiales et temporelles.
Dans les pages qui suivent, je chercherai donc à questionner pour parfois repréciser les concepts marxiens de travail vivant, de force de travail et de travail abstrait. Mon étude fait appel à l’histoire globale du travail et à la critique postcoloniale, en particulier au livre de Dipesh Chakrabarty, (2000). Le deuxième chapitre (« Les deux histoires du capital ») propose non seulement une lecture audacieuse de la notion marxienne de travail abstrait, mais l’ouvrage offre surtout au débat sur le travail et le capital un cadre bien plus vaste, où la compréhension même de la « modernité » et la géopolitique de la production de la connaissance sont également en jeu.
1. La multiplication de la modernité
Entre autres lectures, Provincialiser l’Europe peut être abordé comme une intervention puissante dans les débats sur la « modernité », qui depuis la fin des années 1970 (soit, ce ne peut-être un hasard, depuis les prémices du débat sur la « postmodernité ») ont gagné en importance et en nuances. Ces trente dernières années, les frontières temporelles et spatiales de la modernité ont été remises en question et déplacées, en particulier par la critique postcoloniale. Il me semble que cette nouvelle optique sur la modernité suscitée par les études postcoloniales constitue l’une des contributions fondamentales du champ à notre compréhension critique de l’histoire et du présent. Je voudrais ici brièvement développer ce que j’appellerais l’imagination géographique mobilisée par cette perspective.
J’emploie le terme d’ « imagination géographique » en ayant en tête le jeune narrateur indien du roman d’Amitav Ghosh, The Shadow Lines, qui reproche à son cousin de tenir l’espace, le lieu et la géographie pour acquis. « Un lieu n’existe pas en soi », dit-il, « il doit être inventé dans l’imagination de quelqu’un ((Amitav Ghosh, The Shadow Lines, Delhi, Ravi Dayal, 1988, p. 21. Voir également Amitav Ghosh et Dipesh Chakrabarty, ‘A Correspondence on Provincializing Europe’, Radical History Review, 83, 2002, p. 146–172 (avec une introduction de Duane Corpis, p. 143–145, d’où j’extrais cette citation).)) ». Il va sans dire que Ghosh a lui-même fournit de magnifiques exemples de cette imagination géographique : la modernité, telle qu’elle se reflète dans le miroir de la « Sea of Poppies » ((Il s’agit du titre d’un ouvrage d’Amitav Ghosh paru en 2008.)) [mer de coquelicots], parcourue par le navire négrier Ibis, ne s’apparente guère à ce que les ouvrages de Jürgen Habermas et Marshall Berman proposent! Sur fond de trafic d’opium et de coolies dans les années qui précèdent les guerres de l’opium, Ghosh suggère une modernité née d’un brassage extraordinaire de races, de peuples et de langues dans les eaux océaniques et fluviales, qui devient l’une des étapes d’un processus de réévaluation spatiale continue de l’histoire moderne. La diversité des langues parlées à bord de l’Ibis, par son équipage et ses passagers, allant du Lascar au Zubben, en passant par le Hindi et le Bhojupri, s’exprime dans l’anglais même de l’auteur, questionnant la norme des langues nationales modernes et homogènes et installant la traduction, bien au-delà du domaine linguistique, au centre de la modernité « mondiale » ((Amitav Ghosh, Sea of Poppies, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008. Sur le rapport entre traduction et modernité, voir Naoki Sakai, Translation and Subjectivity. On “Japan” and Cultural Nationalism, Minneapolis and London, University of Minnesota Press, 1997; ainsi que Sandro Mezzadra, ‘Living in Transition. Toward a Heterolingual Theory of the Multitude’, in Richard F. Calichman and John Namjun Kim (eds), The Politics of Culture. Around the Work of Naoki Sakai, London: Routledge, 2010, pp. 121–137. [voir:http://eipcp.net/transversal/1107/mezzadra/en])).
La dimension « mondiale » qu’a revêtu la modernité dès son origine est aujourd’hui largement reconnue et étudiée selon des approches historiques variées, allant de la théorie du système-monde aux histoires postcoloniales et globales. Comme l’a notamment souligné Etienne Balibar, le tracé de frontières géométriques sur la carte d’Europe, nouvelle géographie politique apparaissant avec l’essor de lÉtat moderne, était au départ inséparable des cartographies coloniales et impériales qui arbitraient le monde entier ((Voir Etienne Balibar, « L’autre scène : violence, frontière, universalité » in La crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx, Galilée, Paris, 1997.)). Cette double organisation de l’espace politique, ajoute Carlo Galli dans un ouvrage remarquable sur les « espaces politiques », s’est toujours avérée « un champ de bataille, un théâtre de conflits » : « L’espace politique moderne a suscité des énergies subjectives », écrit-il, « poussant ses géométries à évoluer et, plus encore, mobilisant ces géométries, afin que celles-ci s’ouvrent à des dimensions spécifiquement universelles. Ces dimensions ne semblent pas de prime abord constituer le véhicule de l’ordre spatial. Au contraire, elles ont le pouvoir de détruire tout espace politique fermé » ((Carlo Galli, Political Spaces and Global War, Adam Sitze (ed), Minneapolis, MN : University of Minnesota Press, 2010, p. 54.)).
L’assemblage moderne des cartographies nationales, coloniales et impériales a été contesté par différents mouvements subjectifs et par des luttes sociales en Europe, tout en étant remis en cause par une multitude de formes de résistance et de négociation de la frontière coloniale et impériale, malgré ses modes « nécropolitiques » d’extraction, de génocide et d’exploitation profondément racialisés et genrés. Dans leur dernier ouvrage, Michael Hardt et Antonio Negri font une description captivante des tensions dérivant de cette dimension constitutive de la contestation et de la résistance au sein de la structure de la modernité, laquelle apparait dans leur analyse comme fracturée de l’intérieur par les forces de l’« antimodernité » et ouvrant par là même la voie à une « altermodernité » ((Voir Michael Hardt et Antonio Negri, Commonwealth, Stock, Paris, 2012, Deuxième partie. Pour la référence aux dimensions « nécropolitique » de la modernité, voir Achille Mbembe, « Necropolitics », Public Culture 15(1), 2003, p. 11–40.)).
L’apport le plus conséquent des études postcoloniales à la compréhension de la modernité réside dans la mise en avant d’une démultiplication des modernités, dans la découverte de modèles et expériences alternatifs de modernisation ((Voir, par exemple, Dilip Parameshwar Gaonkar (ed), Alternative Modernities, Durham, NC and London: Duke,University Press, 2001.)). Partageant ce postulat intéressant, je m’attache ici surtout à approfondir ce que ces modernités multiples, ce passage d’une « modernité » unique à des « modernités » plurielles, signifient. En suivant l’ouvrage fondateur de Sibylle Fischer sur Haïti et les cultures d’esclavage à l’heure de la révolution, on peut dire que l’un des premiers points importants sur la question est que la modernité pluralisée nous aide à comprendre la modernité elle-même, non pas en termes habermassiens de « projet inachevé », mais plutôt – je le soulignais déjà plus haut – comme un champ contesté. Les révoltes et révolutions d’esclaves des années 1790 aux Caraïbes, explique Fischer, représentaient autant de « luttes portant sur ce que le fait d’être moderne signifie, sur qui peut s’en revendiquer et à quels titres ». Par ailleurs, et peut-être surtout, il faut se rappeler que « l’hétérogénéité est une condition congénitale de la modernité, et que la pureté supposée de la modernité européenne est une théorisation a posteriori voire l’une des stratégies visant à établir la suprématie de l’Europe » ((Sibylle Fischer, Modernity Disavowed. Haiti and the Cultures of Slavery in the Age of Revolution, Durham, NC and London: Duke University Press, 2004, p. 24 and 22.)).
C’est cette pureté présumée, cette prétendue homogénéité de la modernité européenne, qui façonne la « figure imaginaire » de l’Europe qui, comme l’écrit Chakrabarty dans les premières lignes de Provincialiser l’Europe, demeure profondément ancrée « dans certaines habitudes de la pensée ordinaire » ((Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe, Paris, éditions Amsterdam, 2009, p. 32)). Or, ces modes de pensées ne cessent d’informer les discours politiques et théoriques à l’heure de la mondialisation. L’Europe en tant que « figure imaginaire » résume une configuration complexe de savoir et de pouvoir, qui caractérise concrètement la modernité et ses discours comme formes puissantes dinterpellation, pour reprendre les mots de Louis Althusser. Dans son ouvrage précurseur sur l’éducation occidentale de l’Inde coloniale, Sajay Seth a par exemple montré que l’enjeu de ces diverses formes d’interpellation n’est autre que la constitution du sujet ((Voir Sanjay Seth, Subject Lessons. The Western Education of Colonial India, Durham, NC and London: Duke University Press, 2007.)). Il va sans dire que l’éducation demeure un domaine stratégique de recherches sur les effets tangibles de la modernité comme interpellation, dans la mesure où celle-ci est intrinsèque à la formation de la citoyenneté – et à la définition, comme à la légitimation, de ses hiérarchies et de ses frontières internes et externes. En découle la coexistence, entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle, du citoyen métropolitain et du sujet colonial au sein du cadre juridique des empires européens. (Une question brièvement mais très effiacement analysée dans Provincialiser l’Europe à travers les Considerations sur le gouvernement représentatif de John Stuart Mill, qui consignait « les Indiens, les Africains et les autres nations “grossières” à la salle d’attente imaginaire de l’histoire ») ((Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe, op. cit. p. 40.)).
2. Neue Sachlichkeit
Afin de pouvoir fonctionner comme interpellation, la modernité, ses concepts et ses discours, nécessitent un cadre répondant à un code abstrait, conforme à la logique de ce que l’historien allemand Reinhart Koselleck a appelé des « collectifs singuliers ». L’analyse développée par Koselleck, qui associe les idées de Carl Schmitt et de Walter Benjamin, tout en établissant un parfait parallèle avec la critique de l’« historicisme » selon Chakrabarty, met en avant un processus de subsomption de la multiplicité des temporalités constitutives de l’expérience historique sous le temps homogène et linéaire du progrès. Subsomption qui, en retour, devient le squelette temporel des principaux concepts politiques et historiques de la modernité ((Voir en particulier Reinhart Koselleck, Futures Past. On the Semantics of Historical Time, New York, Columbia University Press, 2004. Sur le parallèle entre Chakrabarty et Koselleck, voir Sandro Mezzadra et Federico Rahola, ‘The Postcolonial Condition: A Few Notes on the Quality of Historical Time in the Global Present’, Postcolonial Text, 2(1), 2006, disponible sur http://postcolonial.org/index.php/pct/article/view/393/819.)).
Le caractère « artificiel » de cette image du progrès était largement reconnue à l’époque que Koselleck considère comme le Sattelzeit, comme le seuil temporel de la modernité, qui, aux alentours de la Révolution française, a vu ce processus décisif de temporalisation des concepts politiques s’opérer. En 1799, Johann Gottfried Herder écrit ainsi, dans sa « métacritique » de la Critique de la raison pure de Kant : « en réalité, toute chose qui change porte en soi la mesure de son propre temps. […] Il n’y a pas deux choses dans le monde qui aient la même mesure temporelle. […] Nous pouvons ainsi dire, d’une expression audacieuse quoiqu’exacte, qu’une multiplicité infinie de temps coexistent en même temps dans l’univers (es giebt also [man kann es eigentlich und kühn sagen] im Universum zu einer Zeit unzählbar viele Zeiten). Le temps que nous imaginons comme étant la mesure de toute chose n’est qu’une proportion de nos idées (ein Verhältnismaas unserer Gedanken), […] en un sens, une simple ilusion (Wahnbild)» ((Johann Gottfried Herder, Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik der Kritik der Reinen Vernunft, Leipzig: J.F. Hartknoch, 1799, p. 120–121.)).
Profondément influencé par Spinoza et marquant à son tour l’émergence du romantisme, en particulier à travers ses écrits sur le langage, la poésie et l’esprit national, Herder ne peut être considéré comme représentatif de ce qu’on peut saisir à la suite de Koselleck comme courant dominant de la modernité. Cependant, contrairement à ce que suggèrent de nombreuses critiques simplistes, il serait illusoire de penser que ce courant dominant qui va, disons, de Hobbes à Hegel, ignorait cette multiplicité des temps (c’est-à-dire d’expériences, de formes de vie et d’appartenance, d’ « habitations du monde »). Au contraire: le mouvement de constitution des concepts modernes comme « collectifs singuliers » est par essence façonné par une tension violente, par un processus d’appropriation et de synchronisation de cette multiplicité de temps au sein du temps « homogène et vide » de l’État et du capital. Une fois de plus, l’enjeu de cette tension est la production même de la subjectivité.
J’introduis ici les termes d’État et de capital car la subsomption de temporalités et d’expériences hétérogènes sous un code linéaire et homogène saisit bien les éléments essentiels des deux concepts et structures en question. L’État et le capital constituent le cadre de référence global des notions politiques et historiques modernes ; ils s’établissent comme principaux pouvoirs capables de dessiner le champ même de l’expérience sociale et culturelle. Leur existence et leur reproduction requièrent un rapport spécifique à la subjectivité. En bref, on peut dire que la citoyenneté et le travail sont l’expression de la subjectivité sous la domination de l’État et du capital. Bien entendu, il y existe un lien structurel entre citoyenneté et travail, relation que des universitaires comme David Montgomery et Evelyn Nakano Glenn ont exploré d’un point de vue historique, dans le cas États-unien ((Voir David Montgomery, Citizen Worker, New York: Oxford University Press, 1993 et Evelyn Nakano Glenn, Unequal Freedom. How Race and Gender Shaped American Citizenship and Labor, Cambridge, MA et London: Harvard University Press, 2004.)).
Le statut du travail (le « travail libre » tel qu’imaginé et conçu par la doctrine juridique de la liberté de contrat) est rattaché, depuis les premiers jours de la République, à l’idée de citoyenneté, à la reconnaissance du citoyen adulte à part entière. Malgré toutes les divergences dans les détails du processus, de l’époque à laquelle il a vu le jour ou de la violence des conflits qui l’ont accompagnés, on peut en dire autant de l’Europe occidentale.
Tandis que la citoyenneté est apparue comme un cadre juridique et politique abstrait, résultant d’un processus de perturbation des appartenances multiples et « concrètes », le travail salarié « libre » a quant à lui été conçu comme rompant tout lien autre que monétaire entre employeur et employé. Une nouvelle objectivité est apparue – une neue Sachlichkeit, pour reprendre les mots de Marx et Weber, qui ont tous deux employé l’expression dans leur analyse du capitalisme et par là-même anticipé un mouvement artistique important des années 1920. Cette nouvelle objectivité, comme nous le rappelle Chakrabarty dans Provincialiser l’Europe lorsqu’il cite et analyse Marx, relève d’une objectivité spectrale, presque « fantomatique ». Une objectivité censée se refléter dans des positions subjectives spécifiques, celles du citoyen et du travailleur.
Pour résumer une histoire longue (et complexe) en une analyse courte (et simpliste), le couple citoyen-travailleur a dominé le monde après la Seconde Guerre mondiale, durant l’âge d’or des villes industrielles américaines telles que Flint et Michigan et sous les figures de Stakhanov en URSS ou du travailleur discipliné des plans Nehru. En 1950, T.H. Marshall a proposé une sorte de conceptualisation formelle de ce schéma binaire du point de vue du développement de la citoyenneté, dressant le bilan de ce qu’ Antonio Negri a effiacement décrit comme un long processus de constitutionnalisation du travail. La reconnaissance – et par là même la mystification – du pouvoir du travail (de la classe ouvrière industrielle organisée) est devenue à l’« Ouest » la base des nouveaux « droits sociaux » et d’une nouvelle « constitution matérielle », qu’Étienne Balibar définit comme la constitution de l’« État national-social » ((Voir Thomas Humphrey Marshall, Citizenship and Social Class, and Other Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 1950; Antonio Negri, Il lavoro nella Costituzione, Verona: ombre corte, 2009; Etienne Balibar, La crainte des masses, op. cit.)).
Dans un ouvrage important sur le capitalisme postcolonial, Kalyan Sanyal a récemment montré comment la nouvelle configuration de savoir et de pouvoir qui soutient cette constitution a interpellé une fois de plus le monde non-occidental à travers la formation discursive du développement ((Kalyan Sanyal, Rethinking Capitalist Development. Primitive Accumulation, Governmentality & Post-Colonial Capitalism, London: Routledge, 2007.)). Son efficacité matérielle réside justement dans le fait de présenter la généralisation du salariat comme condition de déploiement complet de la citoyenneté nationale (et, partant, de l’accession complète à la souveraineté, enjeu essentiel des luttes anti-coloniales pour l’indépendance). Bien que les conditions matérielles de l’« État national-social » comme de l’État développementaliste ont été bouleversées ces trente dernières années par les politiques néo-libérales, il suffit de regarder les expériences significatives des récents gouvernements « populaires » d’Amérique latine pour saisir à quel point ce lien crucial entre citoyenneté et travail salarié ne cesse de façonner l’imaginaire politique, en particulier à gauche ((Voir Giuseppe Cocco and Antonio Negri, GlobAL. Luttes et biopouvoir à l’heure de la mondialisation : le cas exemplaire de l’Amérique latine, Paris, Amsterdam, 2007)).
Revenons maintenant à la violente tension qui caractérise le rapport entre des concepts, modèles et normes aussi abstraits que la citoyenneté moderne et le travail salarié « libre » face à la multiplicité de temps qui constituent la « vie ». À mon sens, le deuxième chapitre de Provincialiser l’Europe propose l’une des analyses les plus pertinentes et originales de cette opposition. Le cadre théorique que Chakrabarty développe me paraît aussi valable, au-delà même du domaine du capital et du travail (en ce sens qu’il peut être employé pour examiner la modernité en général). Résumer l’argument exposé dans ce chapitre et discuter son propos dépasse les limites de cet article. Il suffit d’expliquer que le rapport entre ce que Chakrabarty nomme l’« Histoire 1 » (« un passé posé par le capital lui-même comme sa condition préalable ((Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe, op. cit., p. 118.)) ») et l’« Histoire 2 » (la somme d’histoires et de passés qui ne sont pas posés par le capital lui-même, mais peuvent malgré tout devenir des « présuppositions » ou des éléments constitutifs du rapport capitaliste) ne doit pas être interprété comme dialectique, ce qui impliquerait de considérer l’Histoire 2 comme « l’Autre dialectique de la logique nécessaire de l’Histoire 1 » ((Ibid., p.121.)).
Le concept de subsomption (on pourrait presque dire de « capture ») paraît plus adéquat pour décrire l’enjeu de cette relation ; il fournit une clé théorique au problème fondamental sur lequel se penche Chakrabarty: « le fait que le capitalisme mondial [mais on pourrait ajouter : tout comme la modernité mondiale] présente des caractéristiques communes, même si chaque exemple de développement capitaliste [chaque aspect de la « modernisation »] possède une histoire unique » ((Ibid., p. 96.)).
Mon interprétation de la solution que propose Chakrabarty aux problèmes qui découlent de ce postulat est relativement simple. Schématiquement, l’« Histoire 1 » représente les « caractéristiques communes » du capitalisme, tandis que la rencontre (et les conflits, la violence et les catastrophes qui vont avec) entre l’« Histoire 1 » et l’« Histoire 2 » explique la singularité de chaque histoire du développement capitaliste. Notre analyse des « coordonnées spatiales » de la modernité s’en trouve influencée, puisque son histoire ne peut être reconstruite qu’à partir de la multiplicité des points de vue (des lieux) qui correspondent à la diversité des « rencontres » entre l’ « Histoire 1 » et l’ « Histoire 2 ».
En même temps, il faut prendre en compte le fait que ces rencontres ne relèvent pas simplement d’un « il était une fois » au sein de ce qui pourrait être décrit (je pense ici à l’analyse de Marx de la « soi-disant accumulation primitive » dans le livre I du Capital) comme la « préhistoire » du capitalisme et de la modernité : au contraire, elles se répètent au quotidien et à travers le monde (et l’on devrait ajouter que l’ « Histoire 2 » elle-même est sans arrêt reproduite sur de nouvelles bases, du fait de la multiplicité de temps qui sillonne le présent) ((Voir Sandro Mezzadra, ‘The Topicality of Pre-history. A New Reading of Marx’s Analysis of “So-called Primitive Accumulation”’, Rethinking Marxism, Vol. 23/3, 2011.)). Il me semble que ceci problématise la possibilité même de considérer une fois pour toutes les « modernité alternatives » comme établies et présentant des caractéristiques stables et distinctives assurant leur spécificité « culturelle ». La répétition constante de la confrontation entre l’« Histoire 1 » et l’« Histoire 2 » ouvre un espace théorique dans lequel la contestation de la modernité, la « lutte portant sur ce que le fait d’être moderne signifie, sur qui peut s’en revendiquer et à quels titres », pour reprendre les mots de Fischer, nécessite d’être examinée et interrogée d’un point de vue politique. C’est précisément dans le cadre de cet espace théorique que je pose la question introduite dans le titre du présent article : combien d’histoires du travail ?
3. Le capitalisme et la production sociale de la différence
Le défi de la « provincialisation de l’Europe » a également d’importantes conséquences pour les études européennes. Une fois la suprématie de l’Europe déstabilisée dans l’histoire de la modernité, un nouveau regard peut être posé sur l’histoire européenne elle-même, dévoilant par exemple combien le déploiement des standards abstraits de la citoyenneté et du travail salarié « libre » a été contesté, limité et contradictoire. L’existence de ce que l’on considère encore largement comme la « relation normale de travail », c’est-à-dire l’hégémonie sociale d’un travail salarié relativement stable au sein de l’ensemble des formes de travail dépendant, n’a en réalité configuré l’histoire de l’Europe de l’Ouest qu’au cours des décennies du « Fordisme », et avec des différences importantes et des déséquilibres conséquents entre pays et régions.
Sous cet angle, l’histoire du travail salarié en tant que « relation normale de travail » semble bien courte. Il s’agit clairement d’un exemple paradigmatique de ces « formes clichées et sommaires » constitutives de la « figuration imaginaire » de l’Europe auxquelles Chakrabarty se réfère de manière critique dans les premières pages de Provincialiser l’Europe. Dans ses travaux fondateurs sur l’« invention du travail libre » et le développement du capitalisme dans le monde anglo-américain, Robert J. Steinfeld a attiré l’attention sur les multiples manières dont des contraintes « non pécuniaires » (pénales, administratives, sociales, morales) ont pesé sur le travail et ont caractérisé le développement des relations d’emploi en Angleterre jusqu’à la fin du XIXème siècle. Le travail salarié « libre », comme le démontre Steinfeld, n’était pas le fruit de libres contrats au sein de libres marchés, mais plutôt de « restrictions imposées à la liberté de contrat par la législation socio-économique adoptée au cours du dernier quart du siècle sous la pression de luttes ouvrières acharnées ». Il nous invite en outre à abandonner toute lecture « historiciste » de l’histoire du travail, suggérant d’inverser notre point de vue et de faire par exemple appel à l’asservissement et à l’esclavage pour repenser l’histoire des relations d’emploi aux États-Unis (où les limites imposées à la liberté de contrats étaient évidemment de nature différente qu’en Angleterre) ((Robert J. Steinfeld, The Invention of Free Labor. The Employment Relation in English and American Law and Culture, 1350–1870, Chapel Hill, NC et London: University of North Carolina Press, 1991, p. 9; et Coercion, Contract, and Free Labor in the Nineteenth Century, Cambridge et New York: Cambridge University Press, 2001, p. 4–6 et 10.)).
Une fois de plus, nous sommes ici confrontés, du point de vue de l’histoire du travail et du capitalisme aux États-Unis, au problème de la persistance de l’« accumulation primitive ». Les historiens marxistes ont trop souvent confiné certains processus « irréguliers » tels que la confiscation de terres natales et le recours au travail forcé voire servile au début de l’histoire capitaliste aux États-Unis, sans prendre en considération la reproduction permanente de leurs traces dans la formation de la citoyenneté et la composition du travail. Le « salaire de la blanchité », pour reprendre les mots introduits par Du Bois en 1935 et développés par David Roediger dans le cadre d’une interprétation percutante du rapport entre race et classe dans la formation de la classe ouvrière américaine, a court-circuité la figure abstraite du travail salarié « libre » aux États-Unis et ce jusqu’aujourd’hui, jouant un rôle décisif dans la production d’un développement capitaliste spécifique à ce pays ((Voir W.E.B. Du Bois, Black Reconstruction in America 1860–1880, New York: The Free Press, 1998, p. 700; et David R. Roediger, The Wages of Whiteness. Race and the Making of the American Working Class, London: Verso, 1999.)). La « ligne de couleur » a notamment fracturé le marché du travail, régulant et limitant radicalement la mobilité des individus non blancs, d’une manière qui semble totalement contredire l’un des énoncés les plus connus de Marx sur le « travail en général » comme « universalité abstraite de l’activité créatrice de richesse » :
Cet état de chose, écrit Marx dans son Introduction de 1857 aux Grundrisse de 1857, a atteint son plus haut degré de développement dans la forme d’existence la plus moderne des sociétés bourgeoises, aux États-Unis. C’est là seulement en effet que l’abstraction de la catégorie “travail” , “travail en général”, travail sans phrase, point de départ de l’économie moderne, devient vérité pratique ((Karl Marx, Manuscrits de 1856-1857 dits « Grundrisse », Paris, Éditions sociales, 2011, p. 61.)).
S’appuyant sur d’importantes recherches réalisées ces dernières décennies, Lisa Lowe dresse un constat historiquement beaucoup plus réaliste (nous devrons revenir sur ce réalisme historique du point de vue de la théorie). « Au cours de l’histoire des États-Unis », assure-t-elle dans son livre Immigrants Acts, « le capital a maximalisé ses profits non en rendant le travail “abstrait” mais précisément à travers la production sociale de la “différence” (…) marquée par la race, la nation, l’origine géographique et le genre » ((Lisa Lowe, Immigrant Acts. On Asian American Cultural Politics, Durham, NC et London: Duke University Press, 1996, p. 28–29.)).
Il va sans dire que cette affirmation ne s’applique pas uniquement aux États-Unis (bien qu’elle soit particulièrement valable pour le pays, si l’on garde en tête l’exemple de Marx cité plus haut) : l’histoire de l’Amérique latine témoigne, par exemple, de la grande diversité d’instanciations des différents moyens par lesquels la « production sociale de la différence » a joué un rôle clé dans la subsomption du travail sous le capital. Ce phénomène se reflète également dans la diversité et souvent la violence des formes de résistance voire des combats menés par le travail vivant contre cette subsomption. Comme nous l’a appris Michal Taussi, les ouvriers agricoles afro-américains et les travailleurs miniers confrontés aux processus d’ « accumulation primitive » et de « prolétarisation » entonnaient A friend of the devil is a friend of mine (L’ami du diable est mon ami) dans les plantations de sucre de l’ouest de la Colombie et les mines d’étain de Bolivie bien avant les Grateful Dead. Le diable, ici, n’est autre que l’incarnation anthropomorphique du capital, mais leur « différence » leur permet de négocier avec le personnage d’une manière qui échapperait totalement au travail abstrait ((Voir Michael Taussig, The Devil and Commodity Fetishism in South America, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1980.)).
Ainsi, il apparaît évident que ce que j’appelais plus haut la « relation normale du travail » n’a pas seulement une histoire bien courte. Loin d’être « normale », elle semble plutôt exceptionnelle quand on considère le capitalisme historique à l’échelle mondiale sur laquelle il se déploie depuis ses origines. Il y a plus de vingt ans, Dipesh Chakrabarty ouvrait son Rethinking Working Class History sur une discussion de l’idée marxienne selon laquelle « la liberté de contrat (qui articule rapports juridiques et rapports machands) » devait être considérée comme le modèle du capitalisme. Il en concluait que « la figure du travailleur invoquée dans son (celle de Marx) exposition du capital est le témoignage de quelqu’un issu d’une société dans laquelle la notion bourgeoise d’équité est enracinée dans la culture» ((Dipesh Chakrabarty, Rethinking Working Class History. Bengal 1890 to 1940, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989, p. 3.)).
L’ouvrage de Chakrabarty représentait une belle contribution à la déconstruction de ces présupposés marxiens portée par une analyse remarquable du milieu social et culturel des travailleurs des usines de jute au Bengale, ainsi que des formes de mobilisation et de combats politiques qui étaient les leurs.
Bien que l’on doute aujourd’hui que la notion bourgeoise d’équité ait réellement été « enracinée » dans la culture populaire et prolétaire, même dans l’Angleterre de la deuxième moitié du XIXème siècle, le développement ces vingt dernières années de l’histoire globale du travail a permis d’élargir un peu plus notre connaissance (tout en affinant notre sensibilité) de la profonde hétérogénéité des formes de subsomption du travail sous le capital qui a caractérisé le capitalisme historique. Des auteurs comme Marcel van der Linden, pour ne mentionner que lui, ont brillemment démontré comment le travail forcé, dans ses expressions variables, a été (et demeure encore) essentiel à l’ensemble des rapports et des arrangements qui constituent l’histoire et le présent du capitalisme à l’échelle globale. En se fondant sur l’idée que le travail salarié « libre » n’est que l’une des multiples manières par lesquelles le capitalisme transforme la force de travail en marchandise, on voit se dessiner une conception beaucoup plus vaste et complète de la classe ouvrière mondiale dans le capitalisme historique et contemporain. Les travailleurs subalternes, expression que Van der Linden privilégie, « forment un groupe bigarré, incluant des esclaves, des métayers, des petits artisans et des salariés. Ce sont les dynamiques historiques de cette “multitude” que les historiens du travail devraient selon moi s’attacher à comprendre » ((Marcel van der Linden, Workers of the World. Essays Toward a Global Labor History, Leiden et Boston: Brill, 2008, p.32)).
Compte tenu de l’importance qu’occupe le travail forcé (et de la variété des formes intermédiaires entre travail forcé et travail « libre ») au sein des nouvelles perspectives ouvertes par l’histoire globale du travail, il est important de se rappeler que l’image de l’esclavage lui-même a été profondément revue ces dernières décennies grâce à des recherches précisant les travaux pionniers réalisés dans les années 1930 par des intellectuels et militants radicaux noirs tels que W.E.B. Du Bois et C.L.R. James. Les historiens de l’esclavage en Amérique ont par exemple largement souligné le fait que les rapports de production dans les plantations étaient constamment négociées voire contestées par les pratiques subjectives des esclaves, ce qui permet de mettre à jour quelques similitudes troublantes – malgré de profondes différences – avec les dynamiques du travail salarié.
Il s’agissait dans les deux cas de relations négociées, écrit Robert Steinfeld, dans lesquelles les sources fondamentales de pouvoir des travailleurs étaient similaires : le pouvoir de se soustraire au travail et celui de travailler le moins dur et le moins bien que possible ((Steinfeld, Coercion, Contract, and Free Labor, p. 8. Parmi les travaux récents sur l’esclavage aux États-Unis, le livre de Stephen M. Best, The Fugitive’s Property. Law and the Poetics of Possession, Chicago et London: University of Chicago Press, 2004, est particulièrement important pour notre analyse. Il discute longuement des moyens par lesquels le droit esclavagiste et la propriété intellectuelle, en tant que « sphères extérieures à la propriété réelle et favorisant l’extension de la propriété dans le domaine du fugace et de l’évanescent, permettent de redéfinir l’essence même de la propriété dans l’Amérique du XIXème siècle. » (p. 16). Sa discussion des « deux corps de l’esclave » et de la distinction faite par de nombreux thuriferaires de l’esclavage entre la personne de l’esclave, qui ne devait pas être considérée comme une propriété, et son travail, qui devait l’être (voir par exemple, p. 8-9) est encore plus importante pour l’analyse critique des concepts marxiens de « force de travail » et de travail salarié « libre » que je développe ci-dessous.)).
Des enquêtes explorant les multiples tentatives d’apprivoisement de la « bête coolie » en Asie du Sud-Est, pour faire écho au titre de l’ouvrage de Jan Berman ((Jan Berman, Taming the Coolie Beast. Plantation Society and the Colonial Order in Southeast Asia, Dehli et New York: Oxford University Press, 1989.)), ont mené à des résultats similaires.
Il est évident que cet important champ de recherche constitue une fois de plus un défi théorique radical. En clair, et contrairement à ce que soutiennent Marx et l’économie politique classique, le travail salarié « libre » ne peut plus être présenté comme un modèle ou une norme capitaliste. En combinant les suggestions de Marcel van der Linden et celles de Yann Moulier Boutang, il serait plus juste de parler d’une multiplicité de formes de travail « dépendant », allant de l’esclavage au travail informel, et du travail salarié au travail formellement indépendant ((Voir Yann Moulier Boutang, De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, Paris, PUF, 1998 et Marcel Van der Linden, Workers of the World , op. cit. p. 33 pour la discussion du concept de Cornelius Castoriadis de « d’hétéronomie institutée » mentionné dans le texte.)).
Aux moyens multiples par lesquels la force de travail est transformée en marchandises et subsumée sous le capital correspond une variété instituée de formes et de rapports sociaux de dépendance et d’« hétéronomie ».
À mon sens, c’est dans ce contexte qu’il faut lire l’interprétation que propose Chakrabarty du concept de travail abstrait dans Provincialiser l’Europe. Avant tout, notons que dans la critique marxienne de l’économie politique, cette notion endosse des rôles différents et prend des sens variés qui n’ont pas tous été examiné dans l’ouvrage de Chakrabarty. Il est essentiel de remarquer que le « travail abstrait » permet, par exemple, l’imagination et la représentation de l’unité parmi les « travailleurs du monde », tandis que l’indifférence à toute sorte spécifique de travail qui le constitue ouvre la voie à l’une des définitions les plus mémorables de l’antagonisme imprégnant la société capitaliste : le fait que le travail soit à la fois la « pauvreté absolue comme objet » et « la possibilité générale de richesse comme sujet et activité » ((Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 dit « Grundrisse », op. cit.)). Pour Marx, le phénomène devient possible simplement à partir du moment où le travail constitue subjectivement « la même totalité et abstraction en soi » qui caractérise le capital. Et c’est sous cet angle qu’il est capable d’imaginer l’activité humaine au-delà du travail et de concevoir un « royaume de liberté », au-delà de la « nécessité », au-delà du travail déterminé « par [la] nécessité et opportunité imposée de l’extérieur » ((Karl Marx, Le Capital, Livre III, Paris, Éditions sociales, 1977, p. 742.)).
Toujours est-il que l’analyse théorique du « travail abstrait » que propose Chakrabarty dans Provincialiser l’Europe me semble représenter un seuil fondamental pour toute discussion du problème. Dissociant le « travail abstrait » du « travail concret » pour mieux l’opposer au « travail vivant », l’historien permet de comprendre les différents moyens par lesquels le capital capture un travail qui – puisque vivant – est par essence marqué par la multiplicité. Cette multiplicité ne doit pour autant pas être confondue avec l’hétérogénéité des modes de subsomption (de prise et de capture) de ce travail vivant sous le capital. Cette dernière découle plutôt de la diversité des « rencontres » (pour reprendre une catégorie marxienne dont la signification a été soulignée par Louis Althusser dans ses écrits les plus tardifs) entre le capital et le travail ((Voir Louis Althusser, « Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre » in Écrits philosophiques et politiques, Tome I, Paris, Stock/IMEC, 1994, p. 553-591.)).
L’enjeu de ces rencontres est l’imposition violente de ce que Chakrabarty appelle l’ « herméneutique du capital », du travail abstrait comme mesure de la valeur et comme élément clef pour déterminer « comment le capital lit l’activité humaine » ((Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe, op. cit., p. 110.))
4. Une histoire de vie ou de mort.
Quelques pages avant la dernière citation à laquelle j’ai fait référence, Chakrabarty avance la même idée d’une manière légèrement différente. « Marx décode le travail abstrait » écrit-il, comme la « grille herméneutique à travers laquelle le capitalisme exige que nous lisions le monde » ((Ibid., p. 106. Je souligne.)). C’est ce moment d’interpellation (pour utiliser une fois encore la terminologie althusserienne) qui met la constitution du sujet au centre même de la scène sur laquelle le capital rencontre le travail vivant. On pourrait ajouter que pour Marx le travail abstrait n’est pas seulement la mesure grâce à laquelle le travail en tant que tel est évalué et exploité par le capital dans le procès de production. « Le travail abstraitement humain » est en outre le squelette « fantomatique » (la « substance sociale ») de la forme-marchandise, l’objectivité spectrale qui donne forme à la sphère de circulation et réitère l’interpellation capitaliste par l’appel et la séduction des marchandises bien après la journée de travail ((Voir Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 53-54.)).
Du point de vue de la constitution du sujet, une première réponse à la question posée dans le titre de cet essai devient possible, au moins à un niveau « épistémique ». On peut dire qu’il y a au moins trois histoires du travail, auxquelles correspondent différents processus de subjectivation ainsi que différentes luttes. Premièrement, l’histoire qui est formée par l’interpellation du capital, qui correspond à la nécessité dans laquelle se trouve le capital d’utiliser le travail abstrait comme mesure et comme « grille herméneutique » afin de « lire » l’activité humaine et de la traduire dans le langage de valeur.
Deuxièmement, l’histoire formée par les rencontres instables de multiples modalités de susbsomption du travail sous le capital qui caractérise différentes constellations historiques et géographiques du capitalisme.
Troisièmement, l’histoire formée par l’hétérogénéité constitutive du travail vivant lui-même, qui se cristallise dans des formations politiques, sociales, culturelles mobiles tout en restant ouverte à cet élément de singularité qui défie la possibilité même de représentations historique, théorique et politique.
À sa manière, c’est là ce qu’avait bien vu Gayatri Spivak lorqu’en 1985, elle écrivait que « le subalterne est nécessairement la limite absolue du lieu où l’histoire est logiquement mise en récit » ((Voir Gayatri Chakravorty Spivak, Les subalternes peuvent-elles parler ?, Paris, éditions Amsterdam, 2009.)). Cela ne devrait pourtant pas nous effrayer, car un tel défi n’a rien de nouveau. En 1904, Max Weber écrivait déjà que « la vie […] se manifeste “en” nous et “hors” de nous par une diversité absolument infinie de coexistences et de successions d’événements qui apparaissent et disparaissent. » Et même lorsque nous nous concentrons sur un objet simple dans le but de le saisir intégralement, ajoutait-t-il dans une veine presque spinoziste, sa singularité nous échappe puisque la multiplicité des objets qui le constituent (« l’absolue infinitude de sa multiplicité ») tend à faire exploser son unité et à frustrer les efforts que nous faisons pour le décrire une fois pour toute. Il y a un moment d’arbitraire et d’irrationnel (Weber dirait de « foi ») dans la constitution de tout « objet de recherche » ((Voir Max Weber, « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales » in Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965, p. 125-126. Disponible en ligne sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/essais_theorie_science/essais_theorie_science.html)).
Si notre méthodologie et nos pratiques de recherche doivent refléter l’hétérogénéité radicale du travail vivant, il est encore plus important de favoriser un cadre théorique qui nous permette d’écrire des histoires du travail qui rendent compte des différents niveaux de temporalités qui les traversent.
À chacun des trois niveaux que j’ai schématiquement distingués, nous pouvons retrouver la trace des luttes et des résistances (centralisées ou autonomes) qui ont interrompu et modifié le « développement » du capitalisme. Comme l’a par exemple montré John Chalcraft, cela implique de « pluraliser le capital ». Je m’accorde avec lui pour dire que les « multiples régimes de production et d’exploitation » qui constituent l’histoire et le présent du capitalisme doivent être étudiés par delà tout « biais économiciste » parce que leur construction ne repose pas seulement sur « la forme-marchandise mais aussi sur la guerre, l’État, la construction d’empires, la lutte politique, la citoyenneté, le rapport capital-travail, la syndicalisation, le racisme, le genre, et ainsi de suite» ((John Chalcraft, ‘Pluralizing Capital, Challenging Eurocentrism: Toward Post-Marxist Historiography’, in Radical History Review, 91, 2005, p. 13–39, p. 28.))
Cette insistance sur les éléments de multiplicité et de pluralité ne doit cependant pas nous mener à sous-estimer ou à effacer le moment d’unité qui appartient au concept et à la logique même du capital. C’est là ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari appellent son « axiomatique» ((Gilles Deleuze et Felix Guattari, Mille Plateaux,Paris, éditions de Minuit, 1980 p. 580. Il est utile de rappeler que la domination de cet axiome produit, selon Deleuze et Guattari, une « isomorphie » qui doit être étudiée à la fois « intensivement » (ce qui signifie, au sein de chaque « formation sociale ») et « extensivement » (c’est-à-dire à l’échelle mondiale du capitalisme moderne). Mais, comme Deleuze et Guattari nous le rappellent, l’ « isomorphie n’implique nullement l’homogénéité »: elle permet plutôt, « et même incite », écrivent-ils, une grande hétérogénéité sociale, temporelle et spatiale. On peut voir ici un parallèle intéressant avec l’insistance de Chakrabarty sur les « caractéristiques communes » que présente le capitalisme mondial en même temps que sur le la singularité qui caractérise « chaque exemple de développement capitaliste ».)) : la nécessité de traduire l’activité humaine dans le langage de la valeur à travers la « grille herméneutique » du travail abstrait, autant que l’ensemble des rapports sociaux qui émergent de cette nécessité.
M’appuyant sur Chakrabarty, j’ai utilisé jusqu’à maintenant le concept de travail vivant comme contrepoint du travail abstrait. Comme on le sait, ce concept a été complètement développé par Marx dans les Grundrisse, où il l’utilise pour distinguer « le travail comme subjectivité » du travail « passé », du travail « mort » qui est objectivé dans les machines. Chakrabarty discute la relation entre ce concept marxien et la doctrine hégélienne de la « vie » dans la Logique. La menace de « démembrement » de l’unité du « corps vivant » pourrait bien avoir été une des préoccupations principales de Marx lorsqu’il il développe le concept de travail vivant, et nous pouvons suivre la trace de cette préoccupation dans les pages mémorables qu’il dédie à l’histoire de la machinerie et de l’industrie moderne dans le livre I du Capital.
Je tends néanmoins à lire la section consacrée à la vie dans la Science de la logique d’une manière qui diffère légèrement de celle proposée par Chakrabarty. Il me semble important de souligner l’insistance de Hegel sur la souffrance comme « prérogative des natures vivantes » (das Vorrecht lebendiger Naturen) : c’est à travers la douleur, explique Hegel, que les natures vivantes découvrent qu’elles « sont en elles-mêmes leur propre négativité » et que « cette négativité existe pour elles ». C’est la raison pour laquelle, comme l’a montré Eugene Fleischmann dans son interprétation de la Logique, Hegel peut écrire dans l’Encyclopédie que la mort, n’est pas seulement la menace de « démembrement » du corps vivant mais aussi sa « vérité » puisque « la mort de la vitalité singulière seulement immédiate est la venue au jour de l’esprit (das Hervorgehen des Geistes)» ((Voir Eugène Fleischmann, La science nouvelle ou La logique de Hegel, Paris, Plon, 1968, ch. 11 et G.W.F. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, Tome I La science de la logique (1827 et 1830), §. 222, Paris, Vrin, 1970, p. 453)).
Lorsqu’on garde en tête cette connexion entre l’analyse hégélienne de la vie, des « natures vivantes » et des corps d’un côté, et le traitement qu’il réserve à la douleur et à la mort de l’autre, on peut imaginer que Marx n’était pas totalement satisfait de l’introduction du concept hégélien de vie et de ses conséquences douteuses dans sa conceptualisation du travail. Même si Marx partageait à coup sûr l’insistance de Hegel sur la finitude des corps vivants, la référence à la « venue au jour » de l’esprit et son rapport à la mort ne pouvait que lui apparaître comme une justification de la distribution inégale de la « douleur » au travail entre des sujets construits comme égaux. Dans la Phénoménologie de l’esprit, la mort, le « maître absolu » jouait déjà un rôle crucial – à travers la médiation de la « peur » – dans la pertubation du champ unitaire de la subjectivité qui se trouvait ainsi scindée en « eslcave » et en « maître ». Mais dans la « grande Logique » comme dans la version abrégée qu’en propose l’Encyclopédie, la mort tend plutôt à recomposer le domaine de la subjectivité au sein de la « venue au jour » de l’esprit. Nous pouvons dès lors supposer que cette insatisfaction à l’égard des développements hégéliens constitue l’une des raisons qui ont poussé Marx, après l’écriture des Grundrisse, à se tourner vers le grand interlocuteur de Hegel dans la section de la Logique consacrée à la « vie » : Aristote. Le nouveau concept qu’introduit Marx dans le Livre I du Capital, celui de force de travail (Arbeitskraft), révèle des traces évidentes de cette médiation aristotélicienne, qui était déjà visible dans l’utilisation de la notion de « capacité de travail » (Arbeitsvermögen) dans les Grundrisse ((Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 dit « Grundrisse », op. cit. Pour une analyse détaillée, voir Michel Vadée, Marx penseur du possible, Paris, Meridiens Klinksieck, 1992, p. 269–291)).
Ce qui m’intéresse ici, c’est que le concept de force de travail résume aussi bien l’abstraction générée par le capital à travers le procès de marchandisation que la multiplicité caractéristique de la « vie ». D’une certaine manière, la tension et l’antagonisme entre le travail abstrait et le travail vivant est ainsi réinscrite dans le concept de force de travail, laquelle est déjà « habitée » par le capital à travers la forme-marchandise. Seulement, comme l’a notamment montré Paolo Virno dans son analyse de la nature « biopolitique » de la force de travail, la multiplicité de la vie est dorénavant présentée comme une puissance distinct du travail en acte ((Voir Paolo Virno, Le souvenir du présent. Essai sur le temps historique, Paris, éditions de l’éclat, 1999. Comme l’écrit Marx : « L’usage de la force de travail, c’est le travail proprement dit.L’acheteur de la force de travail la consomme en faisant travailler son vendeur. Celui-ci devient ainsi en acte une force de travail en action, alors qu’il ne l’était auparavant qu’en puissance. » Karl Marx, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 199.)). « Par force de travail ou puissance de travail, écrit Marx, nous entendons le résumé de toutes les capacités physiques et intellectuelles qui existent dans la corporéité, la personnalité vivante d’un être humain, et qu’il met en mouvement chaque fois qu’il produit des valeurs d’usage d’une espèce quelconque » ((Ibid., p. 188)). La distinction entre force de travail et travail est cruciale pour la fondation de la théorie marxienne de l’exploitation, puisqu’elle ouvre un espace entre le contrat, par lequel la force de travail est marchandisée et échangée contre le salaire, et l’ « exercice » ou la « consommation » de sa valeur d’usage dans le procès de travail (dans « l’antre secret de la production »), au cours duquel est produite plus de valeur que celle qui est rémunérée en salaire ((Ibid., p. 188.)).
Bien que le concept de « force de travail » ait souvent été considéré (et discrédité) comme « économiciste », je pense que le fait de souligner ses dimensions « biopolitiques » et « potentielles » pourrait nous amener à développer et à approfondir les tensions, la violence ainsi que les lignes d’antagonisme et de conflit qui découlent de l’inscription de la vie dans le capital. Dès lors que l’on découvre que la capture et le commandement exercé sur la vie en tant que telle, dans sa forme potentielle, est au cœur du capitalisme, l’opposition même entre approches « économiciste » et « culturaliste » doit être dépassée. La production de subjectivité pourrait alors émerger comme le principal terrain d’analyse critique, historique et contemporaine, du capitalisme. Comme on le sait, l’opposition entre l’argent et la force de travail relève en effet pour Marx d’une opposition entre différentes modalités de subjectivation : celle dans laquelle le rapport du sujet au monde est médiatisé par le pouvoir social accumulé sous la forme d’argent et celle dans laquelle ce rapport dépend de la puissance d’agir (potency) du sujet. Dès lors que l’argent et la force de travail sont considérés sous ce point de vue, la frontière même entre l’économie et la culture commence à s’effacer ((Voir Sandro Mezzadra, ‘Bringing Capital back in: A Materialist Turn in Postcolonial Studies?’, in Inter-Asia Cultural Studies, 12(1), 2011, pp. 154–164.)).
Ce qui rend la force de travail particulièrement importante pour notre discussion de la constitution du sujet, c’est que cette notion renvoie en outre au processus nécessaire de séparation (d’abstraction) entre les « capacités physiques et intellectuelles » et leur « contenant » (le « corps vivant ») qui précède logiquement les rapports de production capitalistes. Comme on le sait, ce processus de séparation traverse les corps et les « âmes » (Marx parle d’une « une dépense productive de matière cérébrale, de muscle, de nerf, de mains, etc. ((Karl Marx, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 50.))») sur la scène de la soi-disant « accumulation primitive ». Mais une lecture non « historiciste » de cette scène nous a déjà mené à suivre la trace de sa répétition continue à travers l’ensemble du développement capitaliste. Même si la tension entre la vie et la mort (le « travail mort » accumulé sous la forme de capital fixant la norme de la « vampirisation » du vivant) se trouve rejoué à l’intérieur du concept de force de travail, le travail vivant se pose toujours comme un excès nécessaire, comme un extérieur constitutif, pourrait-on dire, du rapport capitaliste lui-même.
5. Mondialiser la situation postcoloniale
Comme l’a récemment souligné Nicholas De Genova, les termes qu’emploie Marx pour décrire le travail comme activité vitale – l’énergie, l’agitation, la mobilité, le mouvement – revêtent une importance particulière à l’ère des migrations et de la mobilité sans précédent du travail vivant ((Nicholas P. De Genova, ‘The Deportation Regime. Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement’, in Nicholas P. De Genova and Nathalie Peutz (eds), The Deportation Regime: Sovereignty, Space and the Freedom of Movement, Durham, NC: Duke University Press, 2010, p. 33–65, p. 40)). Réduire cette énergie à la mesure du travail abstrait, discipliner ce mouvement, c’est produire l’ensemble des conditions politiques, légales, sociales et culturelles qui assurent « l’offre » continue de marchandises force de travail sur le « marché du travail ». La distinction entre la force de travail et ses « porteurs » (les corps vivants) nous permet de saisir analytiquement l’espace dans lequel opère « la production sociale de la différence » (Lowe), notamment à travers des critères tels que le genre et la race. Ceux-ci façonnent radicalement (c’est-à-dire structurellement et originairement et non de façon secondaire) le rapport qu’entretient chaque sujet à sa force de travail, la modalité sous laquelle chaque sujet singulier accède à sa « puissance d’agir » (“potency”). C’est pourquoi le concept de force de travail, tel que je le lis chez Marx et au-delà de Marx, ne nous renvoie ni à un concept abstrait de travail ni à une image universelle de la classe ouvrière comme sujet politique homogène. L’offre de force de travail comme son exploitation par le capital peuvent emprunter de multiples chemins – correspondant à l’hétérogénéité des modes de capture et de subsomption du travail vivant sur laquelle j’ai insisté plus haut. Partant, nous pouvons utiliser le concept de force de travail sans nous référer nécessairement ni exclusivement au contrat de travail salarié ou au « sujet porteur de droits ».
Il devrait dorénavant être clair que je ne propose pas un pur et simple retour au Marxisme ou aux concepts marxiens en tant que tels. Quoique je sois convaincu qu’ils contiennent toujours un potentiel critique puissant et souvent inaperçu, je suis bien conscient des défauts qu’ils comportent et qu’ont bien mis en lumière Marcel Van der Linden et Karl Heinz Roth dans leur contribution éditoriale au livre important qu’ils ont récemment publié en Allemagne. S’appuyant sur les résultats de l’histoire globale du travail qu’ils combinent à une longue tradition de critique féministe, ils montrent de manière convaincante que les concepts marxiens de classe ouvrière et de travail sont élaborés à partir d’un unique segment de la population laborieuse mondiale, si bien que ces notions s’avèrent incapables de saisir la diversité des expériences subjectives du travail dépendant sous le capitalisme. Roth et Van der Linden nous incitent en outre à prendre en compte le fait que la distinction clé entre travail et activité n’existe même pas dans de nombreux langages non-européens, ce qui rend l’usage « transculturel » de ces concepts problématiques, ce qui ne signifie évidemment pas qu’un tel usage soit impossible ((Voir l’introduction et le chapitre conclusif des éditeurs in Marcel van der Linden et Karl Heinz Roth (ed.), Über Marx Hinaus. Arbeitsgeschichte und Arbeitsbegriff in der Konfrontation mit den globalen Arbeitsverhältnissen des 21. Jahrhunderts, Berlin et Hamburg: Assoziation A, 2009, p. 7–28 et 557–600.)).
Le concept même de force de travail que j’ai essayé de réinterpréter du point de vue de la constitution du sujet à partir de la lecture proposée par Chakrabarty du rapport entre travail abstrait et travail vivant, n’est en aucun cas immunisé contre les défauts qui dérivent de l’insistance marxienne sur le salariat « libre » en tant que relation de travail standard sous le capitalisme. C’est en effet précisément pour soutenir cette thèse que Marx a élaboré le concept de force de travail. Le fantôme de l’esclavage a hanté Marx dès le début de son engagement dans la critique de l’économie politique. « Le prolétaire », écrit Engels en 1845 dans La situation des classes laborieuses en Angleterre, est « en droit comme en fait, l’esclave de la bourgeoisie ; elle peut disposer de sa vie et de sa mort » ((Friedrich Engels, La situation des classe laborieuses en Angleterre, Paris, Éditions Sociales, 1960, p. 76-77. Disponible en ligne sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_friedrich/situation/situation.html)). Avec la distinction entre travail et force de travail, Marx croyait avoir enfin posé les jalons d’une théorie du rapport entre travail et capital susceptible de saisir à la fois la spécificité du capitalisme moderne, fondé sur le travail « libre » et non sur l’esclavage, et la réalité de l’exploitation qui soutient ce rapport. Contrairement à sa dévalorisation « marxiste » comme élément simplement « superstructurel », le droit jouait un rôle constitutif dans l’argument de Marx.
Pour que son possesseur puisse vendre [sa force de travail] comme marchandise, écrit-il, il faut qu’il puisse en disposer, qu’il soit donc le libre propriétaire de sa puissance de travail, de sa personne. Lui et le possesseur d’argent se rencontrent sur le marché, et entre en rapport l’un avec l’autre, avec leur parité de possesseurs de marchandises et cette seule distinction que l’un est acheteur, l’autre vendeur : tous deux étant donc des personnes juridiquement égales ((Karl Marx, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 188.)).
Comme on le sait, le contrat de travail salarié « libre » implique la rencontre entre des sujets « égaux » et est présenté par Marx comme un contrat par lequel une marchandise spécifique, la force de travail, est achetée et vendue. Cependant, comme l’a notamment montré Thomas Kuczynski, si l’on garde à l’esprit la définition marxienne de la force de travail, et notamment le fait qu’elle est inséparable de son « contenant », le corps vivant du prolétaire, on comprend aisémment qu’il est logiquement impossible de vendre la force de travail comme une marchandise sur le « marché du travail ». L’acte même de vendre présuppose l’aliénation d’un bien, et cette aliénation n’intervient que dans le cas que l’auteur du Capital entendait précisémment extraire de la dynamique standard du capitalisme moderne : l’esclavage ((Thomas Kuczynski, ‘Was wird auf dem Arbeitsmarkt verkauft?’, in Marcel van der Linden et Karl Heinz Roth (éd.), Über Marx Hinaus, p. 363–379. Le premier à avoir élaboré cette critique fut à ma connaissance Franz Oppenheimer dans Die soziale Frage und der Sozialismus. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Marxistischen Theorie, Jena:Verlag von Gustav Fischer, 1912, p. 119–122.)).
Pour que ce rapport perdure, il faut que le propriétaire de la force de travail ne la vende jamais que pour un temps déterminé, car s’il la vend en bloc, une fois pour toutes, il se vend lui-même et il se transforme alors d’être libre en esclave, de possesseur de marchandise en marchandise ((Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 188.)).
Mais vendre un bien « pour un temps déterminé » est un type juridique de contrat bien particulier, et il nous faut garder en tête non seulement le fait que Marx se montrait non seulement très prudent dans ses usages terminologiques et conceptuels, mais aussi que les études de droit qu’il avait poursuivit dans sa jeunesse en faisaient un juriste aguerri. De ce point de vue, il est frappant qu’il ait développé une construction juridique aussi étrange, dans laquelle le fantôme de l’esclavage est inscrit au cœur de la structure du travail salarié « libre » ((Les analogies entre esclavage et salariat étaient bien sûr un enjeu clé des discussions sur le travail en Europe et aux États-Unis au XIXème siècle. L’expression « esclavage salarié » circulait beaucoup dans ces discussions et Marx l’a également employé. Comme l’a justement souligné David Roediger dans The Wages of Whiteness, cette expression, telle qu’elle était notamment utilisée aux États-Unis avant l’Émancipation, avait ceci d’ambigüe qu’elle tendait à dresser une opposition entre le travail blanc « libre » et le travail noir servile. Cependant, il ne faut pas oublier que ses significations étaient beaucoup plus complexes. Elles renvoyaient au problème de la propriété de soi, qui a joué un rôle crucial dans le développement du libéralisme depuis John Locke, ainsi qu’à la question de l’achat, de la vente et de la propriété de biens humains. « De diverses façons, écrit par exemple Amy Dru Stanley, les porte-paroles du travail utilisaient le problème pour faire valoir l’absence de différence réelle entre la liberté des rapports marchands et l’esclavage. Ils soutenaient non seulement que les esclaves salariés étaient incapables de vendre du temps de travail sans vendre leurs personnes, mais aussi que la vente en question – à un maître ou autre – durait toute la vie. À mesure que les longues heures de la journée s’étiraient de semaines en années et jusqu’à perpétuité, le statut du salarié se rapprochait de celui de l’esclave. » (Amy Dru Stanley, From Bondage to Freedom. Wage Labor, Marriage, and the Market in the Age of Slave Emancipation, New York: Cambridge University Press, 1998, p. 93). Le livre de Stanley est particulièrement important car il place le mariage et la vie au foyer au côté du travail dans la discussion critique de la « liberté de contrat » aux États-Unis après l’Émancipation: bien que la discussion de ce problème dépasse largement la portée de cet article, il est important de rappeler ici l’accent mis par les militantes et universitaires féministes pendant les deux derniers siècles sur les analogies entre l’esclavage, le mariage et le contrat de travail.)). Plutôt que d’achat et de vente, il semble donc plus précis de parler de cession, d’embauche ou de location de force de travail : on s’ouvre ainsi la possibilité de comprendre les modalités hétérogènes de subsomption du travail vivant qui, comme je l’ai souligné plus haut, caractérisent le capitalisme historique. Ceci nous permet en outre de saisir un autre fait important, à savoir le rôle joué par la multitude d’ « intermédiaires » et d’organisations légales, informelles ou illégales, qui interviennent entre les travailleurs et les employeurs. On m’accordera aisément qu’il s’agit là de dimensions constitutives non seulement du façonnement historique du capitalisme, mais aussi du capitalisme mondial contemporain. Une fois libéré de son lien unilatéral au salariat « libre » et considéré sous l’angle de la vie comme puissance, le concept de force de travail rend compte de la « capture » de la valeur produite par la coopération sociale hors du procès de production, qui caractérise de plus en plus le capital financier : on est alors en mesure de saisir théoriquement l’extension du travail non payé dans le cadre des processus contemporain de précarisation et de flexibilisation du travail ((Voir Andrea Fumagalli et Sandro Mezzadra (éd.), Crisis in the Global Economy: Financial Markets, Social Struggles, and New Political Scenarios, New York: Semiotext(e), 2010 ainsi que Andrew Ross, Nice Work if You Can Get It: Life and Labor in Precarious Times, New York et London: New York University Press, 2009.)).
Les trois histoires du travail que j’ai tenté d’esquisser dans cet article nous orientent donc vers l’analyse critique de la composition contemporaine du travail vivant. Comme je l’ai déjà souligné, Provincialiser l’Europe génère un nouveau regard sur l’Europe elle-même. La crise du fordisme a rapidement produit à l’intérieur des ancien territoires « métropolitains » l’hétérogénéité radicale des relations de travail qui a longtemps caractérisé le monde colonial, ouvrant ainsi un espace à l’intérieur duquel il y a un sens à parler de « capitalisme postcolonial ». C’est notamment – quoiqu’en aucun cas exclusivement – dans la gestion, le suivi et le contrôle du travail migrant qu’apparaissent les traces d’une « accumulation primitive » répétée. Ce n’est pas seulement le cas en Europe. Dans plusieurs de ses écrits récents, Ranabir Samaddar a par exemple décrit l’hétérogénéité profonde des relations de travail qui traversent la composition du travail vivant dans l’Inde contemporaine, faisant ainsi apparaître un type différent de mondialisation, que nous pourrions appeler une mondialisation subalterne, qui accompagne la mondialisation capitaliste ((Ranabir Samaddar, ‘Primitive Accumulation and Some Aspects of Work and Life in India in the Early Part of the Twenty-First Century’, Economic & Political Weekly, 44(18), 2 May 2009, p. 33–42. Voir aussi The Marginal Nation. Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal, New Delhi and London: Sage, 1999 ainsi que The Materiality of Politics, 2 vol. London, New York and Delhi: Anthem Press, 2007, notamment le volume I, chapter 5 (‘Stable rule and unstable populations’).)).
Migration et mobilité jouent un rôle clé dans cette mondialisation subalterne. Corrélativement, les régimes de contrôle du travail migrant produisent des effets sur les conditions ainsi que sur les différentes figures et positions qui constituent le travail vivant contemporain.
Le capitalisme mondial est de plus en plus défini par ces éléments d’hétérogénéité, par la contemporaneité et le rapport structurel entre la « nouvelle économie » et les ateliers clandestins, la corporatisation du capital et l’accumulation sous des formes « primitives », les processus de financiarisation et le travail forcé. Dans ces conditions, la référence de Samaddar à la « mondialisation de la situation postcoloniale » indique élégamment la direction dans laquelle devrait s’engager le développement d’une théorie du « capitalisme postcolonial ». Suivant encore une fois la remarque de Chakrabarty, il nous faudra garder à l’esprit le fait que « le capitalisme mondial présente des caractéristiques communes, même si chaque exemple de développement capitaliste possède une histoire unique. » Partant, une théorie critique du capitalisme postcolonial se doit de manier les concepts « universels » avec précaution. L’adjectif « postcolonial » lui-même désigne la pertinence de diverses échelles, lieux et histoires dans la structure contemporaine du capitalisme, lesquelles sont souvent perdues dans les théories du capitalisme « mondial ». Pour développer cette théorie, il sera donc nécessaire, pour employer les mots de Chakrabarty dans son introduction à Provincialiser l’Europe, de « reconnaître qu’il est “politiquement” nécessaire de penser en termes de totalités [et de] pertuber la pensée totalisante en faisant jouer des catégories non totalisantes » ((Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe, op. cit., p. 61.)) C’est là une tâche particulièrement importante lorsqu’on essaye de décrire et d’anticiper les dynamiques de formation du sujet, des mouvements et des luttes qui combattent le capitalisme, produisant de manière localisée et située les conditions de son dépassement. Loin de chercher d’anciennes ou de nouvelles figures subjectives de l’universel, il nous faudra bien plutôt enquêter sur les tensions et les processus conflictuels de production de conditions communes qui ouvrent la possibilité de nouvelles manières d’habiter le monde. À l’âge de l’anthropocène, cette tâche est peut-être plus urgente que jamais ((Il s’agit évidemment là d’une référence à Dipesh Chakrabarty, « Le climat de l’histoire : quatre thèse » disponible en ligne sur http://www.revuedeslivres.fr/le-climat-de-l%E2%80%99histoire-quatre-theses-par-dipesh-chakrabarti/)).
Texte initialement paru dans Postcolonial Studies 14(2), 2011, pp. 151–170.
Traduit de l’anglais par Marina Heide et Baptiste Le Breton.