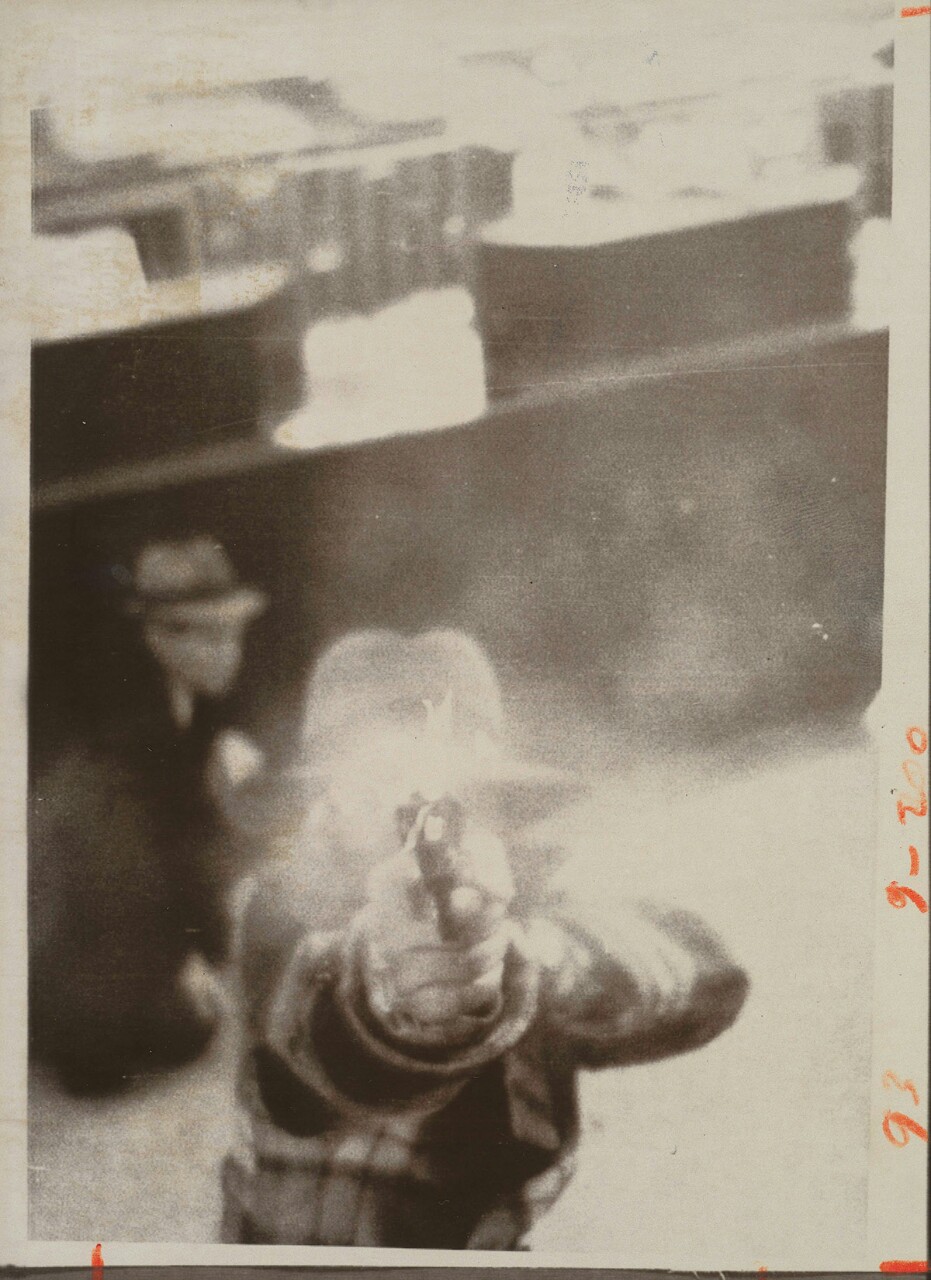Ils sont bien trop nombreux
Ceux qui attendent leur tour
Ernst Bloch
Introduction : la thèse.
Je reprends ce que j’écrivais, il y a déjà dix ans, pour le numéro inaugural de la revue Utopie critique : « La question de la révolution demeure posée. Elle est celle de son actualité. Que l’on jette un voile pudique dessus ou qu’on en parle plus, sa présence s’entête, vieille et jeune à la fois, comme l’oppression. Et ce n’est pas une utopie, sauf à préciser, au sens qu’Ernst Bloch a donné au mot, que ce rêve-là est une tendance du réel, qu’il est inscrit dans le quotidien des rapports capitalistes de production, à la fois sous la forme de la nécessité de leur dépassement et contre les régressions dont ils sont porteurs. L’idée de révolution n’est pas plus inactuelle qu’elle ne l’était au temps de Marx. Au contraire. Il convient même de tirer parti des illusions qui étaient les siennes. Marx n’était guère éloigné de penser que le capitalisme pouvait sombrer du jour au lendemain. Lui et Engels se sont trompés en 1848 et ils en ont convenu. A leur différence, nous avons, nous, une longue expérience des révolutions et nous savons ce qu’ils ignoraient : qu’elles peuvent être rouges, roses, blanches ou noires. Cette expérience nous épargne, dans sa richesse de tendances et contre-tendances, autrement dit de contradictions et surdéterminations, d’avoir recours à quelque vade-mecum que ce soit. Et c’est tant mieux ».
Ce jugement était quelque peu anticipé et, sans doute, pour l’époque, passablement optimiste. Il s’agissait de résister. Aujourd’hui, il me paraît strictement adéquat à la situation. Telle est la thèse que je voudrais exposer.
I Un monde de violence.
Le siècle qui vient de s’achever peut être caractérisé par un paradoxe inouï. Il présente, d’un côté, le visage du Progrès, dans une accumulation de découvertes, d’inventions et de révolutions scientifico-techniques, dans tous les domaines de la recherche, sans précédent. D’un autre côté, il a été celui de la barbarie la plus accomplie, de la mort de masse, provoquée par les guerres et les exterminations ethniques et politiques, à toutes les formes de souffrances également massifiées, qu’il s’agisse de la généralisation de la torture, des déportations de populations ou des famines dûment organisées. Nul besoin de recourir aux subtilités dialectiques pour comprendre à quel point sont intriqués et dépendants l’un de l’autre les deux aspects. Qui oserait prétendre que l’industrialisation du meurtre n’a pas profité davantage des bonds scientifiques que les thérapeutiques médicales ou la protection de l’environnement ? On conquiert l’espace et on détruit les sols. Le même pays qui investit des milliards dans un porte-avion nucléaire laisse s’envoler ses taux de chômage et de pauvreté. On ne tarit pas sur les Droits de l’Homme pendant que des centaines de milliers d’enfants sont condamnés au travail forcé et parfois à la prostitution. On ouvre des restaurants pour chiens cependant qu’en Afrique des populations entières sont condamnées par le sida. Tout cela est connu et a été cent fois décrit, sans doute, mais la vérité tapie derrière le paradoxe l’est moins : savoir que l’humanité est enfin parvenue à un stade de développement l’autorisant à en finir avec la rareté, qui fut son lot des millénaires durant. L’accumulation de richesses de toutes sortes, de la production de légumes frais à la santé, à l’éducation et au confort de l’habitat, peut assurer la satisfaction des besoins les plus élémentaires et créer les conditions, pour tout individu, d’une existence débarrassée des famines, des pandémies et des oppressions. En principe.
Le siècle qui commence paraît n’avoir rien à envier au précédent. Il se prépare, tout au contraire, à en aggraver les nuisances. Ne retenons qu’un trait de sa modernité. L’insécurité, assure-t-on, règne partout… quand les conditions sont enfin réunies d’une civilisation pacifiée et pacifique. En principe. Le discours de l’insécurité constamment ressassé chez les puissances occidentales remplit une double fonction. Il enregistre et majore le fait d’un incontestable accroissement de la violence : délinquance dans les villes, à l’école, dans les transports publics, dont il dissimule l’origine sociale. Il autorise le pouvoir, sous le prétexte d’une montée de l’extrême-droite, à renforcer les organes répressifs (augmentation du nombre de policiers et de gendarmes, ouverture de nouveaux centres de détention), à restreindre les libertés (flicage électronique des citoyens, procédures de contrôle accrues), à verrouiller l’entrée du territoire (chasse aux migrants, expulsions brutales) et à criminaliser les exclus (sans-papiers, chômeurs, pauvres). Ainsi ni l’augmentation du nombre des prisons, qui se voit attribuer un secrétariat d’État à cette seule fin (France), ni leur passage au privé, ne suffisent à enrayer leur surpeuplement. L’incarcération, socialement sélective et ouvertement raciale (États-Unis) remplit la fonction de régulation qui reviendrait de droit à des politiques démocratiques. Or, une nouvelle violence s’est fait jour qui a son lieu d’élection au sein des rapports de travail. Il ne s’agit pas seulement de la catégorie de fraîche date des « travailleurs pauvres », mais d’un phénomène d’une ampleur considérable, baptisé « harcèlement moral ». Les titres des ouvrages qui lui sont consacrés sont éloquents : Le Harcèlement moral. La violence perverse au quotidien, Harcèlement au travail, Souffrance en France, Terreur au travail, Violences au travail : agressions, harcèlements, plans sociaux. Afin d’imposer la conformité aux critères d’employabilité, de flexibilité, de mobilité et de précarité, le « nouveau management » opère la « destruction systématique des identités », individuelles aussi bien que collectives, liquidant ainsi l’ancien salariat et ses normes (stabilité des postes, garanties de promotion, hiérarchies, syndicalisation), au profit d’une complète soumission aux intérêts de l’entreprise. La sociologue Danièle Linhart relève : « C’est un renversement dans l’histoire de la classe ouvrière. Alors qu’elle s’est toujours définie comme exploitée, elle se présente désormais à la société comme victime ». Tout salarié est menacé de subir le sort de ces « salariés kleenex » qui sont jetés à la rue, à la suite de « plans sociaux », qualifiés de « dégraissages », autrement dit de licenciements, dont le nombre et la brutalité caractérisent « la violence organisationnelle ». Selon deux rapports du Bureau International du Travail, la France est « en tête des pays avancés pour la violence au travail » et l’INSEE « estime que sept millions de travailleurs sont concernés par ce fléau ». « Les comportements d’autodestruction se multiplient comme conséquence d’une telle « déshumanisation du monde du travail ». Les observateurs, de surcroît, n’excluent pas l’apparition en France, comme aux États-Unis, d’actes d’agression de folie meurtrière de salariés licenciés retournant sur leur lieu de travail pour se venger ». Une consultation spécialisée sur la souffrance au travail a dû être ouverte à l’hôpital de La Timone à Marseille. Des psychiatres de Barcelone ont, pour leur part, diagnostiqué, sous le nom de« Syndrome d’Ulysse », les graves troubles psychiques qui affectent, de façon spécifique, les travailleur migrants. On sait, par ailleurs, ce qu’il en est du « harcèlement sexuel » et de la considérable augmentation du suicide des jeunes désormais rattaché à « la difficulté à vivre ». Le commerce, quant à lui, y trouve largement son compte : une publication spécialisée vient de sortir un dossier consacré au « big bang du marché de la sécurité » qui révèle que « le business de la peur » représente 6 milliards de dollars et 158.000 emplois, et que particuliers, entreprises, communes et les États eux-mêmes comptent parmi ses clients.
II La guerre comme politique.
Les attentats contre les tours jumelles du World Center de New York, en septembre 2001, sont venus à point pour légitimer, avec le discours du terrorisme, la politique hégémonique des États-Unis, élaborée de fait bien antérieurement, et déjà illustrée par la première guerre du Golfe. Il s’agit de s’opposer à toute tentative, de quelque pays qu’elle vienne, de développement autonome ou d’indépendance politique et économique, susceptible singulièrement de soustraire des ressources énergétiques au contrôle de la superpuissance. On a pu ainsi suivre les lignes géostratégiques qui se confondent avec le tracé des oléoducs et des gazoducs, existant ou en projet, des ex-républiques soviétiques du Sud de l’actuelle Russie, ou de la Tchétchénie, à l’Afghanistan, au Pakistan et au cours du Danube, mais également en Afrique (Angola) et Amérique latine (Venezuela). On s’emploie moins à ménager ses propres réserves (Alaska) qu’à empêcher de grands concurrents de s’en procurer dans l’avenir (Chine). Le discours du terrorisme, qui n’est autre, en fait, que l’invention d’un ennemi en miroir, le boomerang Ben Laden formant le réciproque d’Enron, ambitionne d’installer durablement ce que ses initiateurs appellent eux-mêmes « la guerre globale ». Ce « global » doit s’entendre au double sens, géographique, de globe, et sémantique, d’englobant. « Justice sans limites » et « liberté immuable », les expressions qui l’accompagnent le soulignent. Cependant les proclamations éthiques enjoignant à « l’Amérique » la mission d’apporter et de défendre dans le monde la démocratie et la liberté, ne sauraient faire illusion. Elles sont du même ordre que la phraséologie religieuse de la « croisade du Bien » contre « l’axe du Mal ». L’actualité rend visible la vérité cachée : la guerre, de fait, exprime la modalité d’existence, qui n’a cessé de caractériser les États-Unis, sans doute depuis leur création, en tout cas depuis le second conflit mondial. Elle en est venue, sous nos yeux, à ne même plus s’embarrasser de références morales et renonce à se couvrir du respect des Droits – de l’Homme, international ou États de. Faute de parvenir à se faire sacraliser par les manipulations ordinaires (cf. l’attaque contre l’Afghanistan), la volonté arrêtée de frapper l’Irak s’affranchit même des institutions censées la garantir, – Assemblée générale de l’ONU, Conseil de sécurité, Union européenne, etc. L’invraisemblable concept de « guerre préventive », qui n’a en commun avec la prévention médicale que l’expression cousine de « frappes chirurgicales », autorise, dans le déni affiché du droit, les décisions les plus arbitraires. Ici, l’ultimatum exige un changement de gouvernement, là les tapis de bombes sont censés accoucher de la démocratie, ailleurs, les pires blocus déclarent s’exercer en faveur des peuples. Aux mailles du soupçon, nul ne saurait échapper, ni les alliés vilipendés au moindre désaccord, ni les féaux châtiés à tout écart. Persuasion et débat ne sont plus de mise, quand gouvernements, parlements et opinions peuvent s’acheter. Il n’empêche. Le chevalier blanc peut bien se draper dans sa pureté, elle n’est plus qu’arrogance, qui le laisse seul face au refus du monde entier, dans sa violence enfin mise à nu. La formidable leçon d’un tel vis-à-vis est loin d’être épuisée. Mais il convient d’abord de prendre la mesure de la menace. La guerre comme politique possède sa propre logique :
1. La priorité est accordée aux budgets militaires. Celui des États-Unis a été majoré de 48 milliards de dollars au lendemain du 11 septembre. Il avoisine les 379 milliards et le Pentagone devrait disposer de 160 autres milliards d’ici une décennie.
2. L’affectation de ces sommes bouleverse les autres postes et réoriente les choix économiques et sociaux. Les scenarii d’usages alternatifs seraient trop faciles à proposer.
3. Elle impose, en particulier, une militarisation de l’économie, aussi bien sur le plan national que sur le plan international et géostratégique.
4. Le choix de la superpuissance entraîne des dispositions analogues dans les pays développés, c’est à dire les impérialismes subalternes. Il soumet les non-développés, « en voie de développement », ou « émergents », c’est à dire les néo-colonisés, à des coercitions financières sur leur gestion encore plus draconiennes, par le biais des organismes supranationaux à son service (FMI, OMC, Banque mondiale, accords régionaux divers).
5. L’affranchissement du commerce des armes par rapport à tout contrôle s’en trouve entériné. On sait que le traité dit de « non prolifération », que les États-Unis ont refusé de signer, n’a jamais été respecté. Les grandes puissances ne se sont pas gênées pour vendre à tour de bras des armes de « destruction massive », – nucléaires, chimiques et biologiques, jusqu’à des groupes non-étatiques, qui peuvent en disposer comme bon leur semble, y compris pour des actions « terroristes ». La Nuclear Posture Review signalait récemment que la doctrine concernant l’usage des armes nucléaires avait été revue au Pentagone, afin de favoriser l’utilisation éventuelle sur des bunkers, dit-on, de mini-bombes atomiques. Ce qui faisait dire à un observateur : « Nous sommes dans la pire des situations, celle d’un monde incontrôlable ». A l’occasion de l’imminence de l’attaque contre l’Irak, le Vatican en personne évoque le danger d’une « troisième guerre mondiale ».
6. Ajoutons que la guerre comme politique, habillée en mobilisation « patriotique », présente le notable avantage de servir d’écran tantôt aux scandales financiers, révélateurs de l’actuel fonctionnement du capitalisme (E.U.), tantôt aux réformes de politique intérieure les plus conservatrices (France).
Le terrorisme se vend aussi bien que la sécurité : le Président de la Lloyd’s de Londres déclare dans un entretien que sa compagnie est parvenue à éponger le débours occasionné par les attentats du 11 septembre et que les affaires reprennent; il commente : « le marché de la couverture anti-terroriste est aujourd’hui en pleine expansion dans le monde entier, mais il est le théâtre d’une très vive compétition ».
Décidément Polémos demeure « le maître de toutes choses ».
III Le constat des faillites.
Le discours de la sécurité et le discours du terrorisme que j’ai distingués, par simple commodité, sont plus qu’étroitement associés. Le premier prétend viser aussi le terrorisme, qui lui assure une couverture honorable et l’inscrit dans la mondialisation. Le second, dans sa version yankee, ne se fait-il pas le soldat de la« sécurité mondiale » ? Ensemble, ils expriment la détermination la plus fondamentale de notre temps, celle de la violence, promise à un solide marché, en effet, et à un bel avenir, puisqu’elle revêt toutes les formes de conflictualité, – entre nations, entre peuples, entre ethnies, entre communautés, entre religions, entre civilisations, entre classes, dans l’économie, dans la politique, dans l’idéologie, dans l’alimentation, dans la culture et l’agriculture, dans la rue, dans l’école, au stade, dans la famille, dans le couple, dans l’atelier, dans l’entreprise…
Le système assurément, les rapports capitalistes de production parvenus au stade de la globalisation, pudiquement encore appelé néolibéralisme, est en cause. Point n’est besoin d’y insister. Sauf à relever, on doit bien cette concession aux paranoïaques du Pentagone, qu’il a porté à son point de perfection la psychose manichéenne de l’opposition Bien/Mal, qui se renverse pour rendre désormais aussi éclatants qu’indubitables les dualismes dominants et dominés, exploiteurs et exploités, maîtres et esclaves, riches et pauvres, qu’ils soient d’ancienne ou de nouvelle facture. Ce diagnostic est général. Il fait l’objet de toutes les études et analyses, des plus mesurées aux moins complaisantes, consacrées à la mondialisation/globalisation. Elles incitent, en premier lieu, à prendre la mesure, fût-ce brièvement, des faillites qu’il a provoquées.
1. La plus récente est celle du libéralisme. On se souvient des ovations qui ont accompagné la chute du mur de Berlin, cet épisode symbolique marquant la fin des pays du socialisme réellement existant en Europe. C’était à qui saluerait avec le moins de retenue tout à la fois le triomphe de l’économie de marché, la démocratie « tout court », dont il était évident qu’elle lui était consubstantielle, la fin des idéologies, singulièrement du communisme, stigmatisé, d’un même mouvement, comme criminel et utopique. La disparition de l’adversaire de la guerre froide, du concurrent, dont les manoeuvres mettaient le monde en danger, ouvrait la voie à un avenir de progrès et de paix. Du côté des vaincus, et j’entends sous ce vocable tous ceux qui s’étaient, à un moment ou à un autre, et à la mesure de leurs moyens, associés au projet de construction d’une société plus juste, et non les chacals empressés à tourner leur veste et à transformer en sex-shops les maisons du Parti, du côté des vaincus (dont j’étais), rancoeurs et amertumes le disputaient aux conduites de deuil et aux culpabilités. soigneusement orchestrées et amplifiées par les récents convertis. Or, quelques années ont suffi, une maigre dizaine, pour que retombe l’enthousiasme et que les cris de joie s’étranglent dans les gorges. L’élargissement du fossé des inégalités, au Nord comme au Sud, les drames assimilables à une descente aux enfers vécus par les peuples ex-socialistes, sans parler de la multiplication des conflits armés et des agressions dues aux puissances « démocratiques », ont eu raison des attentes les plus modestes. L’existence d’un ennemi s’avérant indispensable aux faire-valoir libéraux, le musulman a remplacé le communiste. Compétition de modèles de développement et coexistence pacifique ont cédé la place à la guerre globale et intronisé l’impérialisme le plus puissant. Là encore, le temps n’a pas cessé de se rétrécir. Comme le remarque I. Wallerstein, il n’a pas fallu dix huit mois pour que l’administration Bush dilapide le capital de sympathie acquis avec les attentats et se retrouve elle-même isolée diplomatiquement.
L’exemple de l’Argentine suffirait à lui seul à signer l’acte de décès des espérances (néo)libérales : un pays riche, ayant triomphé de la dictature militaire, engagé dans un « miracle » économique, ami des États-Unis et excellent élève des instances financières internationales, qui sombre, corps et biens, comme un galion du XVIe siècle.
2. Est-ce à dire qu’il faille, en contre partie, regretter l’époque du « camp socialiste » ? Bien que nombre de sondages et d’enquêtes d’opinion dans les nations libérées de la « dictature bolchevique » attestent d’un sentiment de nostalgie largement répandu, en comparaison du passage au capitalisme réellement existant, il ne saurait être question de retenir cette réponse. Elle ne donne pas seulement dans une impasse, elle reconduit la méconnaissance de ce qui fut sans doute le foyer de l’effondrement : la prise de distance totalement insuffisante de la part des régimes socialistes avec le modèle « occidental »,, savoir, entre autres aspects, le productivisme économique et le monopole politique attribué à l’exécutif. Ce n’est pas ici le lieu de conjuguer facteurs internes et facteurs externes pour expliquer l’échec, ni de faire le tri entre positif et négatif. De fort sérieuses études en ont dit l’essentiel. Je me contenterai de proposer à la réflexion deux jugements, qui n’ont pas épuisé leurs leçons. Le premier est emprunté à György Lukacs prenant, dans son livre laissé inachevé de 1968, une bonne avance sur l’histoire à venir, quand il démontrait que le stalinisme n’avait pas plus représenté l’alternative à la démocratie bourgeoise que la démocratie bourgeoise ne représente l’alternative au stalinisme. Le second renvoie à une provocation d’Ernst Bloch déclarant, lors d’un entretien télévisé, peu avant sa mort : « le pire des communismes vaut mieux que le meilleur capitalisme ».
3. La social-démocratie et les partis qu’elle influence ont, eux aussi, chanté victoire, à la chute du mur. Ils en furent effectivement les premiers bénéficiaires, en termes d’accession au pouvoir. La carte de l’Europe vira au rose. Les réformistes l’emportaient enfin sur les « totalitaires » (on ne disait plus « révolutionnaires »). En France, par exemple, le Parti Socialiste tenait sa revanche du congrès de Tours. Et, avec lui, une meute d’idéologues fraîchement ralliés en 1981 et depuis, envahissaient les médias, réécrivaient l’histoire au profit des vainqueurs et proféraient anathèmes et oukases. La démocratie « tout court » et le marché avaient trouvé leurs hérauts. Ils ne craignaient pas de défier le capitalisme en personne. On ne parlait plus que « d’économie mixte », devant assurer le triomphe du secteur public sur le secteur privé, de « participation des travailleurs », « d’Europe sociale » et même de « guerre humanitaire ». Le règne du droit allait commencer, – État de droit, Droits de l’Homme, Droit international. Ledit capitalisme hélas avait la vie plus dure qu’il ne paraissait et les adversaires n’étaient pas de taille, – à moins qu’ils n’aient pas été des adversaires… Toujours est-il que le privé dévorait le public, à coup « d’introduction du capital » et de « prise de participation », qu’enflaient les pourcentages de sans-emploi, que l’Europe dressait ses morceaux les uns contre les autres, que les aventures militaires s’entêtaient à semer la mort, les destructions et le chaos et que le droit, suivant une irrésistible pente historique, persistait à servir le plus fort. L’embellie fut de la sorte de courte durée. À son tour, et bien plus rapidement que prévu, l’alternative social-démocrate déposa son bilan. Précisons bien : l’alternative, en tant qu’idéal, programme et promesse, et non pas les individus qui s’en étaient affirmés les maîtres d’œuvre. Ceux-là, au contraire, n’éprouvaient guère d’états d’âme et entendaient bien se maintenir dans les étriers. Ils n’étaient nullement coupables, seulement réalistes. Le sort leur avait été funeste et ils avaient dû s’incliner devant des pesanteurs qui excédaient leurs forces. Ainsi s’imposa l’idée que les « lois » du marché avaient en commun avec celles de la nature qu’elles obéissaient à la fatalité (ou à la nécessité, si l’on préfère), et que « l’État ne peut pas tout » (L. Jospin). Or, une fois que les « socialistes » eurent accompli la tâche de faire digérer au peuple les mesures les plus impopulaires, il ne restait plus à la droite qu’à reprendre le travail, en revenant « aux affaires ». S’ouvrit, de la sorte, et se perpétue le temps des « bras cassés ». Je n’y insisterai pas. Mais je relèverai deux effets concomitants de la vague social-démocrate. Elle a emporté, avec elle, les partis communistes « occidentaux », selon les modalités diverses de l’absorption, ouverte ou feutrée, des fractures internes ou des scissions. Tous ne périrent point, mais tous furent atteints. Leurs ralliements aux gagnants, qu’ils aient été stupides, opportunistes ou pervers, loin d’assurer leur survie, ont accéléré leur décadence. En France, la « Mutation », empêtrée dans l’expérience de la « Gauche plurielle », s’est traduite par un score de 3,5 %, lors de la dernière consultation électorale. A l’inverse, « Rifondazione communista », en Italie, offre le contre-exemple d’une transition réussie. À l’échelle européenne, l’affaire fut encore plus rondement menée. Les anciens P.C. de l’Est ne se sont guère embarrassés de scrupules doctrinaux. Leur transformation, du jour au lendemain, en P.S s’est immédiatement attelée aux gestions libérales et jetée dans la voie capitaliste de « développement ». On a vergogne d’en inférer a posteriori en quoi pouvait consister leurs convictions communistes… Il est juste de dire qu’en regard les groupes qui ont voulu préserver leur identité n’ont réussi, en se murant dans le ressassement des formules anciennes, qu’à légitimer la mue des dissidents et, dans l’opinion, qu’à corroborer le glissement du réformisme à l’acceptation de l’ordre dominant.
4. Les tentatives dites de « Troisième voie » ne méritent guère la halte. Celle du tandem Tony Blair/Anthony Giddens, dont Gerhardt Schröder s’était un temps réclamé, qui se présentait comme originale dans le courant social-démocrate, a fait long feu. Les velléités françaises de « nouvelle gauche » et autres calembredaines, qui étaient plus conjoncturelles et électoralistes que théoriciennes, également. Au sein de préoccupations fort différentes, puisqu’elles sont religieuses, on peut repérer, à partir du même constat de situation, une démarche analogue, savoir qu’il faut écarter les deux directions aussi néfastes l’une que l’autre pour l’humanité, du capitalisme et du communisme. Deux illustrations en ont été produites simultanément. L’une émanait du pape Jean-Paul II, dont il est indéniable qu’il combattit pour la fin des régimes de l’Est, l’autre du cheikh Tourabi, inspirateur d’un islam intransigeant et peut-être du terrorisme qui devait frapper les États-Unis. Les conclusions qu’ils tiraient de leur rejet commun étaient évidemment dissemblables. Le premier y voyait le triomphe de l’Église, le second celui de l’Islam, l’accord se retrouvant sur une unique option, – le fondamentalisme.
5. Une mention enfin pourrait être accordée aux organisations se réclamant de la pensée trotskiste, qui, au lendemain de la chute du mur, se sont légitimement prévalu de leur attitude anti-stalinienne de la première heure. Elles n’ont réussi cependant une entrée remarquée sur la scène politique, en particulier en France, des années plus tard (début 2000) qu’à la faveur de l’échec des politiques social-démocrates, révélateur d’un blocage de conjoncture qu’elles avaient anticipé dans leurs analyses. On sait, d’autre part, qu’il n’a jamais existé historiquement d’expérience politique de ce courant.
Samir Amin dresse, dans son diagnostic du « capitalisme sénile », un bilan de faillite assez proche du précédent, quand il écrit : « Ayant épuisé leur potentiel de développement, les trois modèles en question (le Welfare State à l’Ouest, le soviétisme à l’Est, la construction nationale moderniste au Sud) se sont effondrés sans que des alternatives nouvelles permettant aux États, peuples et nations d’aller plus loin ne se soient (encore) cristallisées ».
IV L’alternative révolutionnaire.
On peut, bien sûr, souhaiter que le monde ne connaisse aucune sorte de changement et se satisfaire de l’état de choses existant. Ce qui, après tout, forme le credo des pouvoirs en place, qui emploient au maintien de l’ordre dominant toutes les forces qui sont en leur possession. Et on se gardera d’oublier que lesdites forces n’ont jamais été aussi considérables, – militaires, financières, diplomatiques, culturelles, ou idéologiques, servies par des appareils de communication pratiquement inaccessibles à d’autres qu’eux. Or, nous sommes, hic et nunc, sujets du royaume de TINA, pour reprendre l’impérissable formule de Mme Thatcher, – « There is no alternative », dont les thuriféraires les plus dévoués ne sont pourtant pas les princes qui nous gouvernent, ni les multinationales qu’ils représentent, mais bien les cohortes d’idéologues chargés de nous faire prendre les vessies pour des lanternes, le marché pour la démocratie, la contrainte pour la liberté, le hamburger pour de la nourriture et le goulag pour l’enfant de Marx. Pour ceux-là, nos sociétés ne souffriraient pas d’un « déficit de démocratie », selon l’antienne social-démocrate, mais bel et bien d’un « excess of democracy » (respectons la langue d’origine). Dégraissez-moi ça !, comme dirait l’excellent Michael Moore.
Si l’on croit, par contre, nécessaire le changement pour conjurer les périls mortifères du « nouvel ordre mondial », force est désormais de convenir que l’alternative n’est pas derrière nous, mais devant.. Elle exige de reconsidérer la seule voie demeurant ouverte, celle qu’offre le concept de révolution.
« Reconsidérer » cela ne veut pas dire remettre en marche une machine arrêtée, ni réutiliser un outil ancien. Cela veut dire conjointement détecter la panne, si une panne s’est produite, et penser à neuf. « Rendre son acuité » au concept de révolution, ou le « rendre à son acuité », renvoie à une double portée sémantique. D’une part, il s’agit de la réappropriation de la radicalité : on met en question le cours des choses, on refuse l’évolution, les corrections, les aménagements. A l’interpretiert, la XIème Thèse oppose le verändern, qui ne se réduit pas à la vague transformation, ni même à la métamorphose, en ce qu’il s’en prend aux formes elles-mêmes. La volonté de changer ne peut exclure le détruire. On le voit clairement avec l’État. La révolution ne vient pas se nicher dans la forme de l’État bourgeois/capitaliste, pour remplacer le personnel politique en fonction, élaborer un nouveau programme et prendre des mesures d’urgence, en maintenant ses appareils. Le problème n’est pas celui du conducteur, mais de la machine. C’est elle qu’il faut changer et vraisemblablement mettre à la casse : La Commune a apporté la preuve que « la classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession de la machine d’État (Staatsmachine) telle quelle et la faire fonctionner pour son propre compte ». Le vocabulaire n’est pas avare en mots forts pour expliciter le « changer » : Zerstörung (destruction), brechen (briser, casser), zerbrechen (mettre en pièces). D’autre part, le procès révolutionnaire est toujours en situation. S’il en va déjà ainsi dans la recherche scientifique où le surgissement d’une théorie nouvelle est tributaire du champ conceptuel d’où elle est issue avant de le révolutionner, à plus forte raison dans la société, où l’histoire nationale, les mentalités, la structure économique, la forme politique du pouvoir et le rapport de forces entre les classes interdisent strictement l’élaboration d’un modèle à prétention universalisante. On évoquera, à la rigueur, des « paradigmes », au sens retenu par Kuhn. L’idée du modèle, déjà récusée par Lénine, telle qu’elle fut échafaudée par l’Internationale Communiste, préconisant à tous les partis de son obédience, l’application de la révolution d’octobre, est elle-même historique. Étroitement dépendante de l’État post-révolutionnaire et de ses moyens de contrainte, qu’ils relèvent de dispositifs policiers ou de l’inculcation idéologique, les traitements nécessairement divers subis par les tentatives de copier le modèle ne représentent nullement des fautes tactiques ou stratégiques imputables à des mésinterprétations doctrinales, mais bien des écarts vis-à-vis de sa mise en recette dominante, donc de la dogmatique, c’est à dire d’une attitude proprement religieuse. Le vocabulaire, en ce domaine, est tout aussi significatif : discipline, fidélité, confession (« autocritique »), hérésie (« révisionnisme »), apostasie (« trahison »), excommunication (« exclusion »), etc. Ajoutons que révolution n’est pas non plus révolte, œuvre de spontanéité et de durée limitée. Robespierre, en son temps s’élevait déjà contre ceux qui déclaraient achevé le procès révolutionnaire : « je ne crois pas, disait-il, que la révolution soit finie ». Une fin est-elle seulement envisageable, hormis le coup d’arrêt qui consacre les nouveaux maîtres ?
« Une seule solution, la révolution ! », criaient les soixante-huitards. Ils avaient raison. Mais ils étaient en avance. Alors que dans le monde d’aujourd’hui, c’est bien la solution qui s’impose. Mais, la révolution pourquoi faire ? Comment en finir avec le système ? Sur la leçon de l’acuité, la réponse ne saurait désormais laisser subsister de doute : la démocratie représente la voie, le moyen et la finalité, de la révolution.
1. Le (néo)libéralisme est l’adversaire de la démocratie. La marchandisation généralisée qui réduit à l’extrême les espaces d’autonomie des individus, au point que les plus démunis en sont réduits à vendre leurs propres organes, après leurs femmes et leurs enfants, est incompatible avec les procédures démocratiques censées assurer le libre développement. Les gouvernements des pays les plus « avancés » sont passés maîtres dans les manipulations électorales (découpages géographiques, pourcentages prédéterminés et excluants) et l’invention de dispositifs qui attribuent aux exécutifs, parfois soustraits à tout vote, la prééminence sur le législatif, ravalé au rang de chambre d’enregistrement, et sur le judiciaire, limité à l’exercice d’une justice de classe. En France, la constitution gaulliste, tout d’abord dénoncée comme « coup d’État permanent » (F. Mitterrand), est rapidement devenue le cadre consensuel indiscuté de la droite à la gauche. M. G. W. Bush dirige une superpuissance qui cherche à assujettir le monde à son arbitraire, sans avoir été régulièrement élu. Deux phénomènes attestent de la régression démocratique, ou, comme certains politologues s’enhardissent à le constater, du « déficit démocratique ». On a d’abord, l’aveu du langage. Depuis la chute du mur, qui a porté au pinacle la démocratie « tout court », on assiste à une véritable débauche de « citoyen » : il n’est de débats et de comportements que « citoyens », l’entreprise est proclamée « citoyenne » et le chien lui-même se voit décerner l’épithète. On rivalise de « citoyenneté », européenne ou mondiale. Porto Alegre a mis à la dernière mode municipale, la démocratie « locale » et « participative ». L’esprit « républicain » règne. La « parité » fait florès, et même l’égalité, – homme-femme, vieux-jeune, immigré-indigène, arabe-juif, homo-hétéro… C’est à qui « écoutera », « communiquera », « échangera », « partagera »… L’abstentionnisme électoral, qui concerne toutes les démocraties « occidentales », et dont les taux n’ont cessé de croître ces dernières années, est un second élément. On sait que les monarques républicains ne représentent guère que le tiers de leurs électeurs. On y insistera pas, sauf à préciser qu’il est maintenant entendu que cette attitude ne relève pas de l’indifférence, mais qu’elle exprime une volonté politique de refus du système en place.
2. Le politique, tel est le fond du problème. Le (néo)libéralisme est son fossoyeur. L’assimilation de la démocratie au marché, qui donne tout pouvoir à l’économie et à la maximisation du profit, éconduit la politique au bénéfice de la gestion. Le « citoyen » n’est que la marionnette de l’actionnaire. Le raffinement des technologies de la publicité, qui anoblit les antiques « réclames », et du marketing, dont la polyvalence « lance » un artiste de variété, un romancier, un manager, un sénateur ou un premier ministre, comme une marque de savonnette ou de couches-culottes, habille les désirs de consommation, qu’elle crée à longueur de rayons de grande surface, des séductions les plus persuasives. À l’individu dépossédé et robotisé, on va jusqu’à offrir les produits « personnalisés » qui lui rendront une âme. Vente, achat, spectacle, dont les corps, de femmes notamment, sont les « porteurs » favoris, annulent les ultimes barrières entre public et privé, exposé et intime. Le social ne résiste pas davantage. Il perd ses bastions les plus solides : la gare, le bureau de poste, l’école, la maternité, déclarés non rentables, tombent dans les poubelles du laisser faire libéral. Les « acquis sociaux » les suivent, assimilés qu’ils sont à des franchises corporatistes. Stopper l’infection qui menace de mort la démocratie, réanimer tout simplement le processus de démocratisation, revient à casser l’idée que la gestion se substituerait à la politique. Autrement dit à rétablir la souveraineté populaire. À engager la révolution.
3. À ceux qui affirment, du haut de tribunes strictement réservées à leurs propres prêches, que la révolution n’a rien à faire avec la démocratie et que la Terreur ou le goulag lui sont consubstantiels, il n’est pas nécessaire d’objecter les leçons de l’histoire ou les puretés doctrinales, encore moins des intentions, qui seraient lisibles. Le regard sur le désordre mondial actuel suffit. Notons, en outre, que les contempteurs de LA révolution considérée comme repoussoir définitif et les tenants du modèle universel moulent la même farine idéologique.. Démocratie et révolution ont partie liée. Au point, voilà qui vaut pour l’histoire et pour la théorie, de ne plus être dissociables.
On sait que dès le Manifeste, dont un Antonio Labriola disait qu’il « ne fut pas et ne prétendit pas être le code du socialisme ou le catéchisme du communisme critique, ou le vade-mecum de la révolution prolétarienne », Marx et Engels soulignent cette indissociation : « le premier pas dans la révolution ouvrière est la constitution du prolétariat en classe dominante, la conquête de la démocratie ». Il est remarquable que cette phrase succède à celle qui énonce que « la révolution communiste est la rupture la plus radicale [das radikalste Brechen] avec les rapports traditionnels de propriété ». La démocratie est la meilleure arme pour en finir avec la propriété privée. Engels disait déjà, dans ses Principes du communisme : « la démocratie ne serait d’aucune utilité au prolétariat si elle ne servait pas immédiatement à faire adopter d’autres mesures s’en prenant directement à la propriété privée et assurant l’existence du prolétariat ». C’est pourquoi « les communistes peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique : abolition [Aufhebung] de la propriété privée », et qu’ils « travaillent partout à l’union et à l’entente des partis démocratiques de tous les pays ». Car le prolétariat, fut-il seul « révolutionnaire jusqu’au bout », en tant que Besitzlos [privé de propriété] ne jouit nullement de l’exclusivité de la révolution. Au contraire, et ceci est également une constante chez les fondateurs, il ne peut vaincre que grâce aux alliances qu’il noue, – avec la petite bourgeoisie, avec la paysannerie ou avec la bourgeoisie elle-même. La conviction de Lénine n’est pas différente. Au temps de la première révolution russe, en 1905, avançant « le mot d’ordre de république démocratique », il qualifie le prolétariat de « combattant d’avant-garde de la démocratie ». « La situation même du prolétariat, en tant que classe, l’oblige à être démocrate avec esprit de suite », il « n’a à perdre que ses chaînes, il a un monde à gagner, avec la démocratie ». Et voici l’enseignement majeur, qui a transcendé les conjonctures et en mesure le caractère révolutionnaire, depuis un siècle : « Qui veut marcher au socialisme par une autre voie que celle de la démocratie politique en arrive infailliblement à des conclusions absurdes et réactionnaires, tant dans le sens économique que dans le sens politique ». Ne lâchons pas cette logique. En dépit des finasseries, des reniements ou des niaiseries qui ont prévalu jusque dans les milieux communistes, elle fait de la conquête du pouvoir politique la tâche incontournable et de la dictature du prolétariat la « forme enfin trouvée » du nouvel État démocratique, qui n’est, de fait, plus que « demi-État », « État-Commune », « État-non État » ou « État à bon marché ». « Les soviets ouvriers et paysans constituent un nouveau type d’État, un type nouveau et supérieur de démocratie ; ils sont la forme que revêt la dictature du prolétariat, un moyen d’administrer l’État sans la bourgeoisie et contre la bourgeoisie. Pour la première fois, la démocratie est ici au service des masses, au service des travailleurs, elle a cessé d’être une démocratie pour les riches, ce qu’elle reste dans toutes les républiques bourgeoises, même les plus démocratiques ».
4. À provoquer un face-à-face aussi brutal entre dominants et dominés, l’actuelle mondialisation confère un relief particulier à ces thèses. En précisant qu’elle est inhérente au développement capitaliste et sa vocation la mieux assurée depuis ses origines, ainsi que le Manifeste l’avait également établi, je mentionnerai brièvement deux conséquences de son caractère globalisant :
a/ Celle des luttes : le prolétariat mondial, car il faut bien nommer ainsi les nouveaux millions de travailleurs tombés sous les rapports capitalistes de production, et, plus généralement, l’immense masse des dominés, ne connaissent plus qu’un seul ennemi, les politiques (néo)libérales. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, sans sous-estimer les disparités nationales ou régionales et les contradictions issues de la concurrence, l’homogénéisation étend ses plaies communes, – pauvreté, inégalités, exclusions. Et les discriminations touchent partout les mêmes catégories : enfants, jeunes, femmes, étrangers.
b/ Celle des champs : la domination, notamment rapportée à l’impérialisme de la superpuissance, s’est efforcée et a, en grande partie, réussi à ne laisser aucun espace hors de son contrôle hégémonique, – financier, commercial, militaire, diplomatique, scientifique, technologique, communicationnel, alimentaire, sanitaire, ou culturel. Il est révélateur d’un tel état de choses que la création cinématographique soit l’ultime lieu où l’on (la France) défende quelque « exception ». La voie paraît enfin prohibée, de la sorte, à la traditionnelle (et mauvaise) habitude des partis ouvriers, dont les programmes sérialisaient les tâches, selon une hiérarchie mécaniste : – les prolos d’abord, – la locomotive, ensuite les wagons, paysans, jeunes, femmes, intellectuels, artisans, employés ; des wagons qui, des années après la « révolution », n’avaient pas tous quitté la gare ; on peut aussi lire : l’économie, confondue avec le productivisme, puis le reste de la superstructure.
5. Faire confiance à l’histoire, c’est admettre ce truisme, que les situations changent, que les répétitions sont rares et que les concepts ont à épouser le mouvement. Les classes apprennent. Les bourgeoisies ont fait leur profit, tactique et intellectuel, des luttes qu’elles ont provoquées. Leurs idéologues ont lu Marx, Lénine et Gramsci. La force de leur résistance au changement tient à la fois au système qui n’en finit plus de dépasser ses crises grâce à des équilibres retrouvés, et à la connaissance acquise de l’adversaire. De leur côté, les opprimés, pas seulement ceux du « premier monde », n’ont pas payé en vain de sueur, de larmes et de sang le prix de leurs expériences et des combats qu’ils ont livrés. La conscience démocratique, sous la mondialisation, n’est plus ce qu’elle était au siècle dernier, ni dans les années 20 ou même 50. L’info circule. Si étroits que soient contrôles et tutelles, la radio, le cinéma, la télé laissent au moins passer les nouvelles. Je sais que les métallos coréens ont engagé une grève dure, que les noirs, aux E. U., sont dix fois plus nombreux en prison que les blancs, que tel PDG a foutu le camp au soleil avec la caisse… Fanon observait déjà, dans ses Damnés de la terre, que les colonisés connaissaient fort bien les noms les plus imprononçables des leaders du Tiers-monde (il citait, par exemple, Soupha Nouvong, Souvanna Phoumah), en dépit des énormes distances qui les séparaient de leurs propres conditions de vie. Les solidarités se répondent. Les exigences montent. Les lycéens qui descendent spontanément dans les rues pour clamer leur colère contre les agresseurs de l’Irak sont animés d’une indignation morale. Ils n’ont hérité ni mémoire, ni expérience de leurs aînés et pourtant sans cet arrière-plan, ils seraient amorphes. En 68, n’avons-nous pas connu les rudes secousses qui ravalaient nos convictions au banc des idées reçues, et nous renvoyaient aux apprentissages ? Le vouloir de démocratisation est aujourd’hui la chose la plus répandue. C’est une première victoire.
V. Des résistances.
Ainsi le procès révolutionnaire ne se décrète pas et son programme n’existe que dans son acte. Si l’on apprend de la révolution, comme de tout acte créateur, il est plus difficile de l’enseigner, encore qu’une dialectique soit possible. Il n’en demeure pas moins que son objet, la conquête de la démocratie, dépend de conditions déterminées, c’est à dire de rapports de forces concrets, afférents à l’état et au niveau des luttes de classes et qu’elle obéit à des règles, dont des expériences antérieures peuvent avoir fourni la matrice. On pensera à la théorie du « maillon le plus faible » ou à la structure dite de « double pouvoir », – Commune/Convention pendant la révolution française, Soviets/Gouvernement provisoire dans la Russie de février 1917. Nulle métaphysique là-dedans, pas plus celle de la Bastille que de la Concorde, celle du Grand soir que du petit soir, du Palais d’hiver que du palais d’été. Les recettes appartiennent à l’art culinaire et les applications à la kinésithérapie, point à la politique. C’est ainsi qu’aujourd’hui, comme hier, les contextes conditionnent l’ajustement des luttes : jeter les bases de la démocratie là où elle est encore inconnue, la consolider où elle est faible ou récente, la rétablir où elle a été mise à mal, la défendre en cas d’attaques, l’étendre davantage quand elle est forte, enfin n’avoir de cesse de la pousser « au bout » aussitôt qu’est ouverte la voie révolutionnaire. Or, nous venons de voir, sans optimisme excessif, que l’exigence démocratique, quels que soient le niveau de développement ou la nature du pouvoir (entendons : de l’exploitation), a désormais atteint une maturité incomparablement supérieure à ce qu’il en était il y a quelques décennies. Ne voit-on pas partout les classes dominantes faire preuve de prudence, en couvrant leurs mauvais coups du manteau des droits ?
1. Quoi que prétendent les thuriféraires des constructions supranationales et du dépassement des ringardises de frontières, en service commandé du capital apatride, le cadre national représente le lieu indépassable des luttes pour la démocratisation. Au nom de plusieurs raisons, que je me borne à rappeler :
a/ Les entreprises multi- ou trans- nationales, autant que n’importe quelles autres de taille moindre, – petites, moyennes, commerces ou artisanat – sont assujetties au cadre national. Il n’est pas seulement leur domicile et leur carte d’identité, comme le rappellent régulièrement leurs classements dans la compétition mondiale et le hit-parade de leurs prouesses boursières qui font se rengorger les patriotes, ils peuvent moins que les autres se passer de leur État national. Il est bien connu qu’au niveau des « personnalités », les osmoses et les cumuls sont monnaie courante entre public et privé. Les « grands commis de l’États », la disgrâce électorale ou la retraite venues, s’en vont « pantoufler » dans les conseils d’administration, dont fréquemment et sans états d’âme sont membres leurs alter ego en activité. C’est bien pratique quand il s’agit de rafler les appels d’offre et, à une autre échelle, pour l’obtention de subventions, d’allégements fiscaux ou d’épongeage de dettes. Une fonction essentielle de l’État de classe ne consiste-t-elle pas à contenir et à faire pression sur la force de travail afin qu’elle s’inscrive dans les normes propices au capital ? L’État n’est-il pas le garant de l’équilibre entre les classes, grâce au dialogue entre « partenaires sociaux » et à la préservation de « la paix sociale », au profit… du profit ? En France, le MEDEF, organe du patronat, est considéré comme le premier parti de la droite. Aux États-Unis, le vice-Président, Dick Cheney emporte le marché de la reconstruction en Irak, avant même, notons-le, que ce pays ne soit détruit. Quand l’entreprise se porte bien, elle exporte ses bénéfices vers des paradis fiscaux, quand elle est malade, l’État vole à son secours, efface ou renfloue, et quand ses dirigeants ne parviennent pas à échapper aux poursuites et à la mise en accusation (pour fraudes, malversations, escroqueries, détournements, etc.), les magistrats sont là pour prononcer des non-lieux. La corruption généralisée et l’imbrication entre argent, crime et politique sont devenues des banalités. Au besoin, on ne craint pas de recourir à la force armée, dans les ex-colonies par exemple, afin de maintenir les intérêts nationaux des multinationales.
b/ Le cadre national reste le lieu, par excellence, de l’exercice démocratique, si dévié et si perverti soit-il. Au niveau de la Communauté européenne, le pouvoir ne réside nullement dans le Parlement de Strasbourg, qui n’assure que l’alibi électoral et la façade représentative, il est entre les mains des responsables des divers exécutifs qui n’ont pas de comptes à rendre et de hauts fonctionnaires, qui gèrent sur dossiers, dans l’arbitraire le plus légal. Recrutements, promotions, salaires et primes se décident entre soi. Du gel des terres au contingentement du beurre et de la viande bovine, des « aides » à l’agriculture, qui ruinent la petite paysannerie, à la protection des tankers hors service, les intérêts satisfaits ont peu à voir avec les mesures favorables à une Europe « sociale », dont la mise en œuvre est toujours différée. Les « souverainistes », vilipendés par les « européistes », ne sont pas si mal nommés : la souveraineté populaire, ne dispose pour son expression d’aucun autre champ que celui de la nation. Les constitutions, assurément caduques, qui l’ont couchée dans leurs professions de foi ne sont plus que l’ultime verrou juridique à faire sauter devant la liberté d’entreprendre. Mazzini opposait déjà « l’Europe des peuples » à « l’Europe des rois ».
c/ N’oublions pas enfin que, dans un monde globalisé, l’échelon national, comme l’échelon supranational (Europe, ALENA, Mercosur…), ne sont que des secteurs du procès hégémonique général, mais c’est au sein de ces secteurs que les luttes démocratiques doivent être menées, sous peine de ne pas sortir d’une abstraction stérile. Le national, dont le local lui-même qui en forme souvent le modèle réduit, ne se substitue en aucun cas au régional plurinational, ni au mondial, il demeure l’avant-poste combattant qui leur interdit de se comporter comme des entités autonomes. « Bien qu’elle ne soit pas, quant au fond, une lutte nationale, la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie en revêt cependant la forme. Le prolétariat de chaque pays doit, bien entendu [natürlich], en finir avant tout avec sa propre bourgeoisie ». En bref, « L’État-nation, relèvent justement James Petras et Henry Veltmeyer, loin d’être affaibli par la mondialisation, est devenu un soutien politique essentiel pour faire circuler son message ». Les luttes qui prennent pour objet « la contre-révolution mondialiste » ne peuvent échapper au cadre national.
d/ Il n’en va pas autrement pour l’Europe. On voit mal, sauf à prophétiser, comment les indispensables luttes démocratiques sauteraient par-dessus les États-nations. La présence d’un Parlement ne suffit nullement à les épuiser. Les contacts répétés entre syndicats et leur union face à des objectifs communs auraient un retentissement et jouiraient d’une efficacité bien plus considérable. Ils demeurent toutefois bien modestes, sinon inexistants.
2. Revenons précisément à la mondialisation pour en dégager un nouvel aspect. Elle fait se lever, dans tous les pays, sans cesse en plus grand nombre protestations, ressentiments et révoltes, que l’on regroupe sous le vocable général d’anti-mondialisation, auquel a succédé plus récemment celui d’altermondialisation. La seconde expression semble plus ambiguë que la première. Si elle signifie que la mondialisation en cours présente un caractère irréversible et qu’il convient de lui en opposer une autre, on a affaire à une proposition à la fois banale, – on ne fera pas tourner l’histoire à l’envers – et trop courte, – de quelle mondialisation s’agit-il et que veut-on en faire ? Admettons que le phénomène dit « mondialisation » ou, à l’anglo-saxonne, « globalisation », décrive ce « village planétaire », dont se gargarisent les amateurs de neutralité sémantique, où biens, personnes, marchandises et informations circuleraient librement au bénéfice de tous (ce qui est loin d’être le cas), se proposera-t-on de renverser, en saine comptabilité, son passif en actif, en convertissant, par exemple, les crédits militaires en budget de la santé, ou en rendant l’ONU à sa vocation de maintien de la paix ? Déjà, de l’adoption de la taxe Tobin, cependant obstinément refusée, à l’annulation de la dette des pays sous-développés, l’affaire n’est pas simple. Il en va ici comme nous avons vu qu’il en allait de l’État : on change le personnel ou on casse la machine ? Or, on constate, au rythme des rencontres internationales, dont Porto Alegre est le symbole, qu’est passablement étendue la mosaïque des courants politiques constituant l’anti-(alter-)mondialisation. Personne, à l’exception des durs et purs du (néo)libéralisme, ne veut en être absent. On tient, au contraire, à s’y faire remarquer, de la droite tolérante à la palette des sociaux démocrates, aux dits « tiers-mondistes » et aux extrêmes-gauches. Alors quel autre monde ? Sans doute, l’évolution fait apparaître une radicalisation et des protagonistes et des revendications, mais comment la lire, comment faire le tri entre le bon grain du Brechen et l’ivraie des rapiéçages ? L’observation de la lutte de classes internationale est le seul critère. Elle relaie les antagonismes nationaux et s’y relie, dans l’objectif de convergences, dont le programme n’est pas plus préétabli que celui de la révolution. Le principe des résistances ne saurait être cherché ailleurs.
3. Quelles sont-elles ? Il serait présomptueux de dresser une liste, nécessairement lacunaire. On peut seulement suggérer quelques lignes directrices, dans le fil de notre propos, sans redouter d’énoncer des banalités, dont on sait que leur rappel est souvent utile.
a/ Dans le cadre national, la mise en crise du système et des institutions qui le manifestent, y compris sous leurs formes symboliques, passe d’abord et avant tout par l’insistance sans relâche concernant les procédures démocratiques, à rappeler, à défendre, à élargir, des plus humbles (la consultation pour le maintien d’une crèche) aux plus ambitieuses (l’abrogation de la Constitution de la Vè République). On tient là un véritable programme et la ligne de démarcation clivant entre accumulation de réformes (potentiellement dangereuses) et compromis conjoncturels (régressifs). La dénonciation de toutes les formes de violence est tout aussi inlassable, où qu’elles se rencontrent. Les plans de privatisations qui désarticulent chaque fois davantage les conditions de travail n’en sont pas exclues. Au rang des priorités figureront la conquête de l’égalité pour les femmes ; de la citoyenneté pour les étrangers. Quelques thèmes porteurs se détachent : refuser tout brouillage idéologique confondant droite et gauche, notamment à l’occasion d’un conflit comme la guerre du Kosovo ou de questions dites « de société », telle le sécuritaire, même s’il est patent que la gauche « plurielle », en France par exemple, a depuis belle lurette renoncé à se distinguer de la droite. On a là une des conditions du rejet de la prétendue fatalité de l’économique et de la posture politico-idéologique des « bras cassés » qui l’accompagne et en multiplie les effets. Le respect des principes de transparence et de publicité des décisions est exigible à tout instant. La considération des subjectivités, encore si malmenée naguère, offre un contre-feu à l’individualisme niveleur, charrié par le libéralisme économique. Après tout, pour faire la révolution, il faut en avoir envie. La suspicion enfin à l’égard des consensus, qui ne sont qu’endoctrinement passif ou servilité, ne doit pas craindre d’identifier et de nommer des ennemis de classe, qu’ils soient hommes politiques, patrons, idéologues ou artistes de variétés. Mais un catalogue n’est pas de mise ici.
b/ Hors du cadre national qui n’est, bien sûr, pas une extériorité véritable, puisque la globalisation emboîte tous ses secteurs, la vieille règle, si opportunément oubliée des confusionnismes de toute obédience, tient toujours et s’impose sans tolérer d’exception : « les communistes appuient en tous pays tout mouvement révolutionnaire contre l’ordre social et politique existant ». Cette règle exige comme sa conséquence l’élaboration d’un nouvel internationalisme, dans lequel mouvement, réseau et forme-parti ne seraient pas exclusifs les uns des autres Inutile d’en dire davantage. A chacun d’y trouver sa boussole.
c/ La situation actuelle créée par l’agression impérialiste contre l’Irak appelle encore une ou deux remarques, eu égard au bicéphalisme de combat dominants/dominés, porté à sa tension extrême précisément par la globalisation. Il ne s’agit pas de se livrer, à l’instar des stratèges en chambre et des journalistes empressés à vendre la guerre « américaine », à un examen des forces en présence, sauf à saluer, comme il le mérite, l’héroïsme du peuple irakien, passé, quant à lui, sous silence. Nous restons dans l’optique des luttes, mondialisées elles aussi. L’événement majeur de ces derniers mois consiste dans l’isolement des États-Unis. Pour la première fois, le patron de la triade est perçu pour ce qu’il est, le flic universel muré dans son mépris des autres et au-dessus des lois. Soumissions et complicités se défont. En témoignent l’attitude des gouvernements qui se sont prononcés contre la guerre et surtout l’opinion internationale, en vérité les peuples, clamant leur refus de l’hégémonisme. En dialecte texan, nous pourrions avancer que « les jeux sont faits » (« Game is over ») et la donne tout à fait nouvelle : la rupture opérée par l’antiaméricanisme, enfin libre de s’exprimer, et dont le flot charrie les alluvions des colères à venir. Second constat : le colosse est atteint. Il est malade, point uniquement de son arrogance, mais de sa caisse, car il va devoir acquitter seul, cette fois, le coût de sa guerre, un coût qui viendra grossir une dette déjà monstrueuse. Des surprises sont à en attendre. On ne donnera pas toutefois dans l’illusion d’une banqueroute fatale. Les anciens associés le resteront, loin de constituer une dissidence, ils reconduiront la triade, en négociant de nouvelles alliances (le processus est en cours). Ces impérialisme subalternes et concurrents useront de la marge d’autonomie conquise pour servir leurs propres intérêts, en accroissant zones d’influence, marchés et profits. Défions-nous de la dénonciation de l’unilatéralisme « américain », si prisée dans les cercles dirigeants, elle en appelle moins au polycentrisme des autonomies, qu’elle ne se fonde sur l’arrière-pensée d’un impérialisme à plusieurs côtés. Il serait vain, pour les travailleurs et les dominés en général, d’en attendre des retombées « libérales » internes. Ils feront plutôt les frais de nouvelles contradictions. Contentons-nous de penser que de nouveaux espaces s’ouvriront aux luttes anti-mondialisation, dans un contexte plus favorable. Les tenants et aboutissants n’en sont pas disponibles.
Conclusion : Perspectives.
1. La tâche de « rendre son acuité au concept de révolution » ne saurait, sous peine de se rétrécir à une déclaration de (bonne) intention, se passer de protocoles de mise en œuvre. Elle se heurte, partant, à un paradoxe. Elle est nécessaire, urgente, actuelle et pauvre en moyens de diffusion. Comment convaincre nos concitoyens, en particulier les premiers intéressés que sont les travailleurs, mais certes point eux seuls, de passer de la résignation à l’action, de crever les carcans de l’idéologie dominante, quand les accès aux médias de masse, autre conséquence de la globalisation, sont si étroitement verrouillés ? Que peuvent une affichette, un tract, une brochure, un journal, une revue ou un livre tirés à quelques centaines, voire à quelques milliers, d’exemplaires, face à la grande presse d’un Rupert Murdoch ? Quelle commune mesure entre un meeting (intelligent) faisant salle comble et une émission d’information (débile) touchant des millions de téléspectateurs ? Ce n’est pas que fasse défaut la littérature (ouvrages et revues) sur des questions, telles que la violence au travail, la guerre impérialiste ou les malfaisances de la mondialisation, elle est, au contraire, nombreuse et souvent excellente, mais elle se voit barrée par les censures. Car la censure, d’être insidieuse et inavouée, n’en sévit pas moins dans nos démocraties de libre expression. On évoque parfois les possibilités offertes par le net et les divers moyens d’échange électronique, ils sont certes démocratiques, mais ils ne concernent qu’une petite minorité d’utilisateurs. Exiguë, la voie d’une réplique au défi existe, qui conjugue la prise de conscience, ou lutte idéologique, et la pratique politique, ou mobilisation militante. Les résultats, on le sait de longue expérience, n’obéissent pas au volontarisme, ils sont les produits du rapport de forces. Les barricades de 1968 ont fait davantage pour la lecture des auteurs marxistes, dont les éditeurs les plus conservateurs se disputaient les droits, que n’importe quelle propagande politique. Les grandes grèves de 1995 commencent à hanter l’horizon théorique et pratique du nouveau millénaire. Et, qui sait, l’esprit de Bandung va peut-être souffler à nouveau.
Ajoutons que l’acuité se niche aussi dans la langue. Des vocabulaires ont fait leur temps, pas forcément « de bois », mais inaudibles aux jeunes oreilles. Les mutations de conjonctures ont imposé styles et mots. La réalité concrète est en train de remettre au goût du jour sous les plumes les moins accueillantes : classes, lutte de classes, capitalisme, impérialisme et même révolution, à peine sorti des métaphores du marketing et du scientifico-technique pour revenir au politique. Quelle autre conceptualisation en effet, que celle issue de Marx pourrait permettre le présent ?
2. Une dernière remarque concernant la violence révolutionnaire : son adéquation à la situation engendrée par le capitalisme globalisé est indiscutable. Elle est pourtant rejetée avec une indignation véhémente par l’éventail complet des « familles politiques », exception faite pour des secteurs de l’extrême-gauche. Les faillis cherchent sans doute dans ce déni la rémission de leurs péchés. Las, en délestant la nacelle du « Grand soir », de la dictature (du prolétariat) ou de l’internationalisme (prolétarien), on croit prendre de la hauteur et se refaire une virginité sans pouvoir enrayer la chute. « Spirale », ou « cycle », la violence, dépouillée de tout épithète, est élevée au rang d’entité métaphysique dans les discours dominants du terrorisme et de la sécurité. Tous attendent de ce consensus sacralisé, qui convoque la morale, le droit et la religion, l’enfouissement de la violence réelle inhérente aux rapports sociaux du système. Face à une telle muraille de mauvaise foi, on a vergogne à rappeler quelques évidences. Contrairement à ce que le choeur des « belles âmes » tente d’inculquer, l’action violente n’est jamais l’objet d’un choix. En règle générale, la violence, qu’elle soit individuelle ou collective, surgit de la souffrance. La donner comme un choix, c’est cacher sa source. Les « partisans de la violence » y sont acculés par un destin qu’ils n’ont nullement élu. S’agissant singulièrement des dominés, il est de la dernière indécence de leur imputer une violence dont toute l’histoire prouve qu’ils sont les premières victimes. Il est vrai que la viande humaine est concernée, qu’elle souffre et que le sang souille la rue. Ce qui n’est pas le cas à la Banque et (très) rarement dans un ministère. Car la violence réprouvée vient du démuni, du pauvre, de l’exclu, de tous ceux qui « n’en peuvent plus » et n’ont d’issues que barrées. Le jeune palestinien qui se fait sauter avec sa bombe artisanale dans une discothèque israélienne tue moins de « civils innocents » que s’il se trouvait aux commandes d’un bulldozer, d’un char ou d’un avion chargé de missiles, ou encore penché sur une carte d’État-major dans quelque Q.G. Sa technologie se réduit à son corps. Sa vie est tout ce dont il dispose pour défendre la terre qu’on veut lui voler. Le peuple qui voit en lui un héros a raison. Son nom figurera sur la dalle érigée au centre d’Al Qods, capitale de son futur État. La violence dominante a beau jouer à l’offensée en parlant de « représailles », c’est la violence dominée qui est réplique, jamais à l’initiative. La violence de l’opprimé est libératrice, celle de l’oppresseur est brutalité comme Jean Genet l’avait bien vu.
Ni le procès révolutionnaire, ni la guerre d’indépendance, ni la dictature démocratique ne présupposent des formes de violence ouverte. Elles ne sont pas inscrites dans leur nature. Les leur impose la puissance répressive de l’ordre établi. Si l’alternative était possible, il ne fait pas de doute que la voie pacifique serait préférée. Et quoi qu’en pensent les violents s’élevant contre la violence, elle demeure à l’horizon. Or, on l’aura compris, la logique de la globalisation actuelle limite à l’extrême les marges d’intervention. Les endormissements, les résignations, et les soumissions n’auront qu’un temps. Les conditions sont d’ores et déjà réunies pour qu’éclatent, aux endroits les plus inattendus, soulèvements de masse, insurrections, révoltes sanglantes ou actes « terroristes » » que les bonnes consciences vilipenderont de leurs cris d’orfraies. Aux révolutionnaires d’entendre la désespérance et de la répercuter en vouloir de changer le monde existant.
Le Pecq, France
Janvier-mars 2003
Texte initialement publié sous le titre de « Rendre son acuité au concept de révolution ». Republié ici avec l’aimable autorisation des ayants-droits de l’auteur.