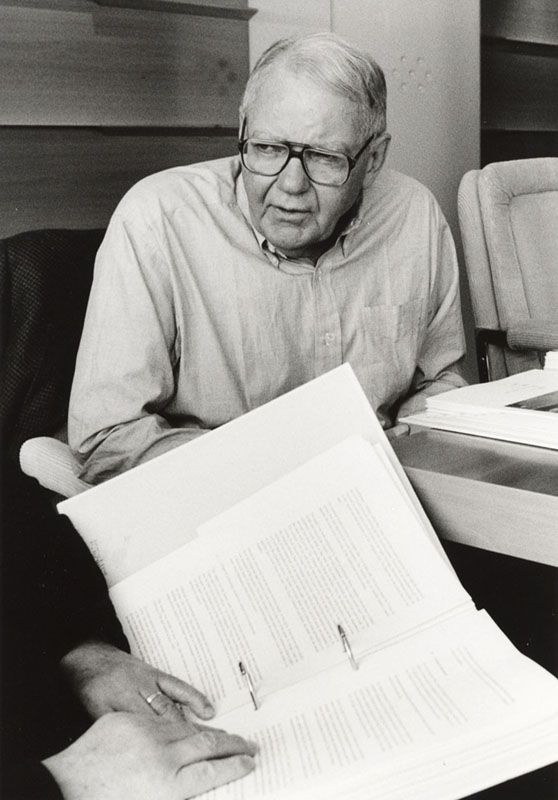Quelle philosophie de l’histoire ?
Stathis Kouvélakis (S. K.) — La ligne de force de ton projet théorique, tel que tu l’exposes dans la première partie de Political Unconscious ((Fredric Jameson, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, London : Routledge, 2008 (1e éd. 1979) )), vise à construire un appareil interprétatif totalisant, qui intègre la quasi-totalité des modèles d’interprétation textuels existants (de la psychanalyse à l’herméneutique traditionnelle en passant par la sémiotique, le formalisme, etc.). Cet appareil global dépasse donc de loin les frontières de la seule tradition marxiste, en précisant immédiatement que tu accordes une prééminence à ses concepts. Ce primat du marxisme découle de son statut de théorie de l’histoire et des modes de production qui lui assigne la place du « métacommentaire ultime », apte à « envelopper » l’ensemble des autres commentaires en leur accordant une validité locale.
La théorie marxiste à son tour sera envisagée dans la multiplicité de ses traditions et de ses composantes. En 1971 tu publies Marxism and Form ((Fredric Jameson, Marxism and Form. Twentieth-Century Dialectical Théories of Literature, Princeton : Princeton University Press, 1971)), qui est une présentation systématique de ce que tu nommes la « tradition dialectique ». Une décennie plus tard, dans Political Unconscious, tu opères une confrontation, toujours dans un but de synthèse, entre cette tradition allemande et l’apport d’Althusser. C’est une tentative qui, du moins à ma connaissance, n’a pas d’équivalent. Une synthèse entre ces deux traditions, considérées comme totalement exclusives l’une de l’autre, en particulier en France, ne va naturellement pas de soi.
Prenons comme point de départ l’usage que tu fais de la « philosophie de l’histoire ». Cette catégorie, que tu considères comme incontournable, semble liée à une conception de l’histoire comme « récit » (narrative) ou plus précisément comme « séquence de modes de production », séquence qui dans son déroulement formerait l’ultime « horizon herméneutique ». Cette démarche ne connote-t-elle pas le retour à une figure classique de la philosophie de l’histoire qui tombe sous le coup de la critique althussérienne de toute vision téléologique et évolutionniste ? N’est-elle pas également indissociable d’un concept de temps homogène et linéaire, que tu rejettes par exemple chez Lukács dès 1971, et qui s’oppose en tout point à la temporalité singulière et différentielle du mode de production ?
Fredric Jameson (F. J.) — La formulation que j’ai utilisée dans Political Unconscious, selon laquelle la succession des modes de production formait un récit, était maladroite et prêtait à confusion. Au niveau d’une philosophie de l’histoire, il n’y a pas de « récit » à raconter : c’est bien la conceptualité du mode de production qui permet de produire des récits plus locaux. Quant à l’évolutionnisme, aux États-Unis, on est en train de repenser la problématique darwinienne, grâce notamment au travail de S. J. Gould. La notion d’évolution chez Darwin est évidemment très ambiguë mais le sens originel était clairement anti-téléologique. On pourrait aussi remettre en valeur l’affinité que Marx lui-même a ressentie pour la théorie darwinienne sans succomber à un archaïsme idéologique.
Il faut avant tout se souvenir de la manière dont Marx historicise son projet. Il signale très exactement les conditions de possibilité qui ont permis l’apparition du matérialisme historique. C’est, pour l’essentiel, la généralisation du travail salarié et l’universalisation des rapports marchands. Seul le mode de production capitaliste permet de reconstruire la séquence des modes de production antérieurs. Ce projet généalogique, différent d’un récit diachronique, est une construction rétrospective à partir de l’expérience du capitalisme actuel. Ce que Marx a su dire de son époque, nous avons d’autant plus de raisons de le penser maintenant, à la lumière d’un capitalisme peut-être plus pur qu’au temps de Marx, qui rend possible une vision encore plus nette de la nature des sociétés antérieures. On peut difficilement éviter de penser en termes de séquence et de diachronie, en termes narratifs. Il n’est pas possible pour l’esprit humain de se libérer de cette « forme vide » de la Darstellung. On peut cependant créer une sorte de « métapensée » supérieure à la tendance narrative et diachronique, qui explicite les conditions de possibilité de ce récit. C’est ce que j’appelle pour ma part la dialectique : penser en termes quasi-narratifs, tout en se rendant compte que c’est une forme qui comporte sa part d’erreur et de mirage mais dont il est impossible de se libérer complètement.
Sur ce point le rôle d’Althusser me paraît avoir toujours été très ambigu. Les althussériens les plus conséquents à l’époque sont ceux qui ont fini par se dégager de l’althussérisme en le faisant éclater en post-marxisme. Le cas de Barry Hindess et Paul Hirst, qui ont tiré les conséquences de certaines tendances objectives latentes dans la réflexion d’Althusser et ont fini par liquider le marxisme, est de ce point de vue significatif. Il y avait toujours chez Althusser une volonté de liquider les aspects germaniques et dialectiques de la tradition marxiste. Si l’on avance suffisamment loin dans cette direction, on se retrouve avec quelque chose qui n’est plus le marxisme. Les descriptions althussériennes de l’histoire, les conséquences tirées par Hindess et Hirst de la théorie des modes de production peuvent aller dans ce sens-là.
Si le refus de la téléologie signifie que rien n’est inévitable, que l’histoire est faite de discontinuités et de conjonctures et surtout de contingences, je veux bien. Mais s’il conduit à l’interdiction d’imaginer un mode de production autre que le mode de production capitaliste, à réduire le socialisme à une vision idéologique, ma réponse est négative. Le fondement ultime de la conceptualité des modes de production est, à mes yeux, de faire apparaître que si le capitalisme est un mode de production, alors il peut y en avoir d’autres : de produire donc, sinon l’idée d’un socialisme possible, du moins une « case vide » pour un système différent de l’actuel et de ceux du passé.
S. K. — Si l’on applique toutefois ton mot d’ordre « historicisons toujours » (always historicize) à l’intervention d’Althusser, il faudrait constater qu’elle s’inscrit en réaction à des interprétations fortement téléologiques, largement dominantes pendant les années soixante, qui cherchaient des garanties a priori d’un avenir socialiste. Dans ce cas, le socialisme n’était plus une « case vide », mais le fruit d’une nécessité historique contenue dans la séquence ordonnée des modes de production.
F. J. — Le Capital, c’est l’une de ses leçons, nous indique qu’à l’intérieur du capitalisme quelque chose se développait qui lui était antagonique, et qui aurait pu, sous certaines conditions et dans certaines conjonctures, se réaliser. Il faut garder cet aspect de Marx pour ne pas revenir à un socialisme complètement utopique : objectivement, à l’intérieur de ce système, il y a des tendances à autre chose. Mais personne ne peut fournir de garantie à la réalisation de ces tendances. Althusser a eu raison de critiquer une telle acception de la téléologie. D’un autre côté, le but de l’idée de mode de production n’était pas de garantir un avenir mais de produire au moins le concept d’une alternative logique, d’un système autre rendu possible par la description structurelle du capitalisme.
Conscience de classe et utopie
S. K. — Reprenant une vision de l’utopie proche d’Ernst Bloch, tu énonces cette thèse volontairement provocante : « toute idéologie est utopique ». Tu considères que les éléments utopiques présents dans toute idéologie, y compris, quoique sous une forme dégradée, dans les idéologies les plus ignobles (on peut penser aux éléments utopiques contenus selon Adorno dans l’antisémitisme), renvoient selon toi à l’affirmation d’un sentiment de solidarité organique propre à la communauté. Tu accordes même, autre thèse provocante, une prééminence logique à l’idéologie des dominés par rapport à celle des dominants, prééminence qui résulterait de la solidarité qui s’établit à l’intérieur de la communauté des dominés. Comment éviter alors la rechute vers une conception organiciste du rapport social et une représentation métaphysique de la classe comme Sujet, opposée à la vision relationnelle propre au matérialisme historique ?
F. J. — Le danger de ces formulations consisterait dans l’idée d’un éclatement absolu de l’humanité en une multitude de petits groupes, chacun donc de son idéologie. Ma façon de penser la dynamique des groupes a toujours été très liée à la Critique de la raison dialectique de Sartre. Cela suffit à indiquer à quel point il faut réintroduire, lorsque l’on parle de l’idéologie et de tel moment de la formation d’un groupe, une sorte de développement « physiologique » du groupe lui-même. Cette idée d’historicité du groupe était toujours contenue dans les formules de Marx, dans l’idée de la différence entre la classe en soi et la classe pour soi. Sartre l’a développée en élargissant le continuum temporel et les stades du développement possible d’un groupe, de sorte que la correspondance entre les moments de sa constitution (ou de sa désagrégation) et le statut conceptuel de telle ou telle idéologie en ressorte clairement. Dans un état sériel, les idéologies sont présentes à titre d’objets inertes qui survivent à leur moment de production et flottent à très grande distance de l’expérience des multitudes. Quand un véritable groupe commence à se constituer, la production d’idéologie est beaucoup plus vive et directement liée à l’expérience du collectif. Il y a justement des temporalités multiples dont il faut respecter la complexité : d’un côté les temporalités de la constitution/désagrégation des groupes et, de l’autre, les temporalités des idéologies, de leur conceptualité, de leur réification ou de leur réinvention.
Tu as raison de souligner l’aspect provocant de ces thèses, mais l’un de leurs objectifs était de sortir du moralisme. Ce dernier présente le double défaut d’être étranger à une véritable politique et inutile par rapport au marxisme qui est une des rares théories politiques à pouvoir se passer d’un point de vue moral, c’est-à-dire à s’appuyer sur des stratégies moralisantes. Au moment où une idéologie est vivante et saisit l’imagination des masses, la présence des éléments qui fournissent une certaine vision de l’avenir est indispensable. Ceci vaut autant pour les moments du lynchage et du racisme que pour les autres. Une idéologie se doit d’être collective dans sa nature même. Il s’agit d’un concept forgé pour remplacer des notions moins utiles, comme celle de valeur sociale, dans le but de penser le rapport entre la représentation et le groupe. Son statut est autre que celui de l’opinion personnelle qui est une façon de participer à cette conceptualité collective, l’idéologie. C’est uniquement dans l’espace délimité par l’idéologie que les individus peuvent communiquer ou transmettre leurs opinions qui, de ce fait, se réorganisent en forces sociales et collectives objectives. Toute idéologie doit comporter, afin d’être vivante, un élément utopien tant dans sa forme que dans son contenu.
Il s’agit cependant de moments très instables. Les idéologies sont immédiatement confisquées aux fins de divers mouvements. Les exemples auxquels on songe toujours, ce sont les éléments socialistes ou révolutionnaires du nazisme ou du fascisme italien, il y a eu une « gauche » dans ces mouvements, pour laquelle le cadre abstrait de ces idéologies comptait moins que l’élément utopien, élément qui a été par la suite épuré et expulsé du mouvement en question, comme en Allemagne. Si on veut réellement se confronter au fascisme, au racisme ou même aux nationalismes actuels, il faut prendre au sérieux ce qui faisait et continue à faire leur énergie secrète. Si on les considère simplement comme des aberrations ou des pathologies, la source de leur force reste une énigme et les alternatives deviennent impensables.
Du point de vue de la dynamique du groupe, la conscience de classe est d’abord la conscience d’une classe subalterne. C’est une leçon de la Critique de la raison dialectique de Sartre qu’il me semble possible de soutenir d’une manière plus générale. La conscience de la classe dominante est une réaction à la formation de la conscience de classe des dominés. La perception du danger que ce nouveau groupe en voie de constitution représente, la peur qui traverse les possédants et les riches les amène a prendre brusquement conscience de leur solidarité collective. Cette solidarité collective est beaucoup plus fragile à mon avis que l’autre.
S. K. — Tu établis une identité entre « idéologie » et « conscience de classe » qui pourrait conduire à une vision essentialiste de l’idéologie. Certes, tu définis avant tout l’idéologie comme forme, en mettant l’accent sur sa plasticité et sur l’unité du « code-maître » (mastercode) propre à un mode de production. La notion de conscience de classe, dans la mesure où elle implique une transparence de la classe à ses représentations et à ses pratiques, n’entraîne-t-elle pas une vision anthropomorphique des catégories du collectif ? En affirmant le primat de l’idéologie des dominés, ne présupposes-tu pas une identité originelle, une sorte d’« état de nature » dans lequel les dominés affirmeraient leur solidarité organique de groupe, préservés des effets du code-maître ? La production des formations idéologiques des dominés ne se fait-elle pas toujours déjà dans un « trop-plein » d’idéologèmes sécrétés par les structures du mode de production lui-même, ce qui permettrait d’expliquer pourquoi l’idéologie disons « spontanée » des dominés est toujours une reprise du code-maître d’un mode de production (ou d’une pluralité de codes renvoyant à une articulation de modes de production dans la synchronie)?
F. J. — II y aurait sur ce point des recherches historiques à poursuivre. Je pense notamment aux travaux de l’école de Negri d’un côté et aux historiens indiens de l’école dite « subalterne » (subaltern studies), de l’autre. Tous deux se sont intéressés, quoique de façon différente, au problème de la « spontanéité » et à ce qui se trame réellement derrière cette apparence et cette émergence subite de nouveaux acteurs idéologiques, de nouvelles formes de praxis.
Le schéma présenté dans Political Unconscious visait, sinon à sortir de ce dilemme concernant la conscience de classe, du moins à le multiplier et à le complexifier à l’aide de trois niveaux analytiques : celui d’une logique « événementielle » (terme utile qui n’existe pas en anglais et que j’ai dû remplacer par « politique »), celui de la classe et celui du mode de production. Si on fait intervenir ces trois niveaux, on peut réintroduire la complexité nécessaire et constater que ce que l’on appelle la « conscience de classe » qui, en tant que telle, est très intermittente, n’est qu’un niveau parmi d’autres. Il ne se définit nettement qu’à certains moments. Ensuite il est happé par le système et se transforme en une série de réifications, qui retombent dans la société et n’ont plus cette transparence. Il existe tout de même des moments de cohésion, essentiellement des moments révolutionnaires, où les groupes sont capables d’atteindre un niveau d’activité collective et de lucidité, qui corresponde à ce que tu appelles la transparence. Mais ces moments sont rares dans l’histoire.
Tu sembles dire qu’un schéma narratif, où il y aurait un moment d’origine, puis un développement ou une décadence ne peut rendre compte de ce processus. Effectivement tu as beaucoup mieux caractérisé cela en parlant de ce contexte dans lequel se produisent justement les moments de créativité idéologique. Tu as souligné, pour parler en termes sartriens, cet espace sériel qui constitue l’horizon même de toute expérience de groupe. Tu as inévitablement raison, ce n’est pas une origine mais plutôt une émergence dans un milieu saturé d’idées et de pratiques sociales. Pour reprendre la formule sartrienne, cette conscience tend, sinon à se désagréger en sombrant dans la mer de sérialité qui l’entoure, du moins à se laisser capter par des institutions et des forces qui la transforment en alibi ou en propagande. Il y a là de ma part une idéologie, pour ainsi dire, du primat du groupe. Je vois mal comment il pourrait y avoir une politique sans une conviction fondamentale quant à la possibilité de l’activité collective.
Il est certain que ce point de vue peut très facilement glisser vers le populisme, l’ouvriérisme ou vers le tiers-mondisme, dont j’ai été taxé lorsque j’ai reformulé cette conception de l’idéologie par rapport aux cultures du tiers-monde. À notre époque, c’est d’un point de vue global qu’il faut se placer, à partir du clivage entre le centre dominant et la périphérie dominée. Ce serait là la position privilégiée de la culture du tiers-monde par rapport à celle du centre, qui est à mon sens actuellement dénuée de contenu et presque sans valeur. Elle ne survit que de façon parasitaire aux dépens des cultures minoritaires du centre (voir la cannibalisation de la culture noire aux États-Unis), ou même du tiers-monde en général. Le centre est désormais stérile et c’est en Amérique latine ou en Chine qu’il se ravitaille en production culturelle vivante. Le même schéma est ici à l’œuvre : ce n’est ni au centre, ni d’en haut, que la production culturelle se fait véritablement mais dans les espaces dominés, du fait d’une expérience collective qui y existe bel et bien alors qu’elle a disparu dans le centre. C’est là une constatation autant empirique que théorique, et elle peut se vérifier dans les grands centres urbains du premier monde, qu’il s’agisse de Tokyo, de Paris ou de New York. Je vois bien ton objection par rapport à la transparence. Il est possible d’élaborer des modèles de la transparence et de la conscience collective moins simplistes mais il me semble difficile de s’en passer totalement, et c’est une autre constatation empirique aussi bien que théorique, car les grandes prises de conscience collective existent dans l’histoire. L’usage du terme de « conscience de classe » s’impose pour des raisons historiques. Son abandon serait un acte de soumission dans la lutte idéologique actuelle, lutte qui se mène aussi entre des langages différents. Nous avons notre langage et la « conscience de classe » en fait partie. Du point de vue théorique, c’est l’assimilation de cette conscience à la conscience individuelle qui fait problème, mais qui n’est en rien nécessaire. Nous disposons d’éléments venant de théories beaucoup plus complexes qui lient l’expérience collective à sa conceptualité sans renvoyer à des modèles de Sujet ou de conscience. Je me réfère de nouveau à la dynamique du groupe chez Sartre comme modèle qui se passe de la notion de Sujet centré. Mais il y en a d’autres : le modèle de l’idéologie chez Althusser n’est pas suffisamment élaboré, mais il représente une tentative intéressante d’établir une distance entre la conscience individuelle et ce que l’on nomme idéologie ou conscience de classe.
Ce sont là les problèmes théoriques les plus intéressants qui n’ont pas encore trouvé de solution. Au moment où la notion de sujet individuel est déconstruite, revenir à la subjectivité collective et en créer de nouvelles semble hors de portée. C’est pourtant ce qu’il faut faire. Les options posées par ce que l’on appelle aux États-Unis le post structuralisme, à savoir le dilemme entre le vieux sujet centré de l’individualisme et le sujet décentré et schizophrène du post-moderne, occultent néanmoins une troisième alternative : celle d’une subjectivité collective qui est déjà décentrée par le fait même d’être collective, sans être pour autant schizophrène.
S. K. — La catégorie de « conscience de classe » me semble poser problème y compris, peut-être même surtout, pour l’analyse des moments révolutionnaires, ceux du « groupe-en-fusion » pour rester dans la terminologie sartrienne. L’idée de maîtrise des pratiques véhiculée par le présupposé de transparence la rend hautement problématique, ne serait-ce qu’en raison de l’opacité du langage. Ne faudrait-il donc pas penser une forme de pratique, agissante et produisant des effets tout à fait réels, comme un processus de construction de forces sociales radicalement distinct de l’idée de maîtrise par un Sujet, un processus qui s’alimente précisément des décalages entre les pratiques elles-mêmes et entre les pratiques et leurs représentations conscientes et non d’un mouvement « progressif-régressif » tel que tu l’as reconstruit ?
F. J. — L’association de la transparence à cette formulation de la conscience de classe provient d’une conception de la conscience en termes réflexifs et individuels. Or, il ne s’agit pas d’une conscience réflexive : la prise de conscience n’est pas un moment où l’histoire s’arrête et où un groupe dit « c’est nous le peuple, nous sommes solidaires les uns des autres ». C’est plutôt un acte, une conscience non-réflexive où le contenu de la conscience de classe est toujours à distance de l’expérience individuelle des membres du collectif.
Tu as posé deux options : l’une serait cette notion originaire de transparence, l’autre serait fondée sur les décalages, les discours. Il vaudrait mieux situer ces deux options par rapport à la pratique politique ou à l’expérience historique. J’ai insisté sur le caractère organiciste de la collectivité dans une conjoncture où il ne subsistait plus beaucoup de traces ou même de souvenirs de la pratique collective. Rappeler le fait de l’expérience du groupe, que j’ai même pu caractériser d’ontologique (au sens où, par l’expérience du groupe, l’individu accède à un autre niveau de l’Être), visait à maintenir vivante l’idée de collectivité à une époque où son expérience même semble avoir disparu. J’ai songé, concernant les États-Unis, à la distance qui nous sépare des années soixante. Quand ces expériences sont vivantes, on a probablement besoin de les analyser autrement. L’aliénation du langage, les obstacles posés par la réification des idéologies, tout ce que tu as évoqué sous le terme de décalage entre alors en jeu. Je ne vois pas de contradiction théorique, car je suis très éclectique et mon éclectisme consiste à douter de la réalité de ces modèles conceptuels. Les modèles sont toujours à distance d’un réel qu’il est impossible de « toucher ». Ce point de vue permet de distinguer entre les usages de ces différentes théories. J’éviterai donc de répondre théoriquement à ta question.
Capitalisme et modernité
Michel Vakaloulis (M. V.) — De nos jours, toute une constellation de notions, comme modernité, modernisme, modernisation, sans oublier le Moderne, l’adjectif qui est devenu substantif, semble s’être imposée. L’instabilité définitionnelle de la terminologie du Moderne amène à s’interroger sur le statut théorique du terme modernité. Une conceptualisation de la modernité dissociée de la théorie marxiste du mode de production capitaliste constitue-t elle un programme de recherche tenable ?
F. J. — La seule raison de parler d’un concept de modernité indépendant du mode de production capitaliste résiderait dans la perspective d’une modernité socialiste. Mais comme cette perspective ne semble pas être à l’ordre du jour, on peut désormais identifier beaucoup plus étroitement la modernité et le capitalisme. Je serais tenté d’introduire cependant quelques distinctions portant sur le triangle terminologique modernisation-modernité-modernisme. La modernisation peut être envisagée comme un processus technologique directement lié au capital : ce qu’on appelle modernisation dans les sciences sociales ou la politique étrangère a toujours été un euphémisme pour le capitalisme, l’impérialisme, etc. Elle forme en ce sens le contexte par rapport auquel la culture et la conscience individuelle et collective sont appelées à se définir. La modernité serait un outillage subjectif et caractériserait les transformations pénibles de mentalité de ceux qui se confrontent à ce moment historique armés de modes de vie et d’habitudes provenant d’un stade antérieur. Le modernisme serait alors la réaction culturelle et artistique à ces deux processus, plus particulièrement à celui de la modernisation. Nombre de projets modernistes se définissent par le besoin de réagir à cette destruction, aux problèmes d’ordre existentiel concernant les conduites de vie, la ville, etc.
Cette distinction tripartite peut également nous être utile dans l’analyse du postmoderne. Dans cet ordre d’idées, la post-modernisation englobe les nouvelles technologies de communication, la postmodernité désigne une mentalité et le postmodernisme une réaction artistique et culturelle. Mais ici il faut remonter dans le temps pour ne pas sauter, faute d’une terminologie adéquate, un premier moment du capitalisme distinct de ceux du moderne et du postmoderne. Je proposerai à cette fin le terme de sécularisation comme premier moment du capitalisme, celui des Lumières, le moment de l’effacement de l’Ancien Régime. Il s’agit d’une sorte de « nettoyage » d’éléments sacrés issus d’un autre mode de production. La sécularité renverrait à la mentalité mixte de ceux qui, formés dans l’Ancien Régime, doivent maintenant faire face à une situation autre. Le sécularisme désignerait les réactions culturelles à la science, aux divers réalismes littéraires et aussi à tout un ensemble de constructions philosophiques.
Si l’on réintroduit ce premier moment, la tendance du concept de modernité à s’autonomiser et à tout phagocyter se trouve circonscrite. La modernité devient ainsi un moment historique singulier, ce qui permet de voir, comme le souligne Perry Anderson ((Cf. Perry Anderson, « Modernity and Révolution », New Left Review, 1984, n°144, p. 114-123. repris dans Perry Anderson, A Zone of Engagement, London : Verso, 1992)), qu’à l’époque moderne (la période grosso modo entre la révolution de 1848 et la fin de la deuxième guerre mondiale) l’élément proprement moderne représente une enclave réduite dans des sociétés largement prémodernes. Le triomphe de la bourgeoisie reste très limité en ce qui concerne son poids social spécifique et son rôle politique, jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. C’est alors qu’une révolution bourgeoise a lieu un peu partout : à l’est de l’Europe, en Allemagne (on a pu dire que Hitler c’est le moment de la révolution bourgeoise en Allemagne), tout ce qui restait des structures de l’Ancien Régime et de la domination idéologique de l’aristocratie est définitivement balayé. Même en Europe occidentale dans l’entre-deux-guerres, la force de l’aristocratie est loin d’être négligeable. Par conséquent, restreindre la modernité à cette période-là, permet de l’envisager comme une tendance, si l’on veut triomphante, mais ô combien minoritaire.
S. K. — Quelle est la production culturelle qui caractérise le moment de la sécularisation ?
F. J. — C’est le réalisme, envisagé non pas comme une représentation adéquate du monde extérieur mais plutôt comme une façon de se défaire de modèles de récit et de subjectivité, hérités du passé et essentiellement tributaires de l’aristocratie ou de la paysannerie, c’est-à-dire de la société agricole préindustrielle. Le réalisme est une forme culturelle active qui subvertit ce qui subsistait des modèles narratifs et culturels de l’Ancien Régime. L’effet dit réaliste serait le résultat de cette subversion. Or, les productions réalistes semblent se figer et se présenter comme images fidèles du monde, dès qu’on passe à l’époque moderne, et il devient, dès ce moment-là, difficile de rappeler leur force active et « moderne ».
M. V. — Une précision. Tu as défini la modernité en termes de mentalité. Est-ce que tu conçois la mentalité comme relevant d’une conscience réflexive ? Faut-il la situer au niveau des mœurs, comme attitude dans la sphère des idées, ou comme l’équivalent de l’expérience ?
F. J. — On en revient à l’idée de la transparence. Abandonnons le terme mentalité s’il suggère l’idée de la transparence. Mais il faudrait voir les problèmes, dilemmes et contradictions intériorisés par les sujets dans l’obligation de réorienter leur pratique dans un monde en voie de modernisation. La modernité, ce ne sont pas d’abord des réponses mais des problèmes : des confusions et des antinomies posées au sujet moderne qui ne dispose pas encore de paradigme et d’outils conceptuels pour les affronter. Tout ceci est loin d’être réflexif. Il s’agirait plutôt d’un matériau subjectif, disparate et travaillé par différentes solutions possibles. Les modernismes seraient autant de projets qui s’emparent de ces matériaux subjectifs pour en faire quelque chose.
M. V. — Au niveau de la norme esthétique ou plus globalement au niveau de l’expérience quotidienne ?
F. J. — Les deux à la fois, dans la mesure où l’esthétique est aussi la production de l’expérience quotidienne en partant des paradigmes artistiques, mais aussi sur le plan idéologique. Les modernismes sont des réactions qui viennent en réponse à cette confusion qu’est la mentalité moderne.
M. V. — Une deuxième précision. J’ai l’impression que tu conceptualises de manière étroite le terme de modernisation en le définissant comme processus technologique. S’il en est ainsi, le processus de modernisation politique est évacué : aujourd’hui toute une pléiade d’intellectuels « théorisent » l’État de droit comme point culminant de la modernisation et achèvement de la révolution démocratique. Les procès de mise au travail, les régimes à usine, la transformation des systèmes productifs, bref la modernisation économique, sont également passés sous silence. Tous ces processus ont indubitablement un support technologique mais on ne saurait les réduire au facteur technologique. Comment analyser par exemple la modernisation taylorienne qui bouleverse l’organisation capitaliste du travail en termes purement technologiques ? Il en est de même de la mutation de la matrice spatio-temporelle : la constitution historique d’une expérience urbaine n’est pas l’expression d’un processus technique. D’une manière générale, le champ de la modernisation déborde largement son « support » technologique ou l’application de la science dans le processus productif.
F. J. — Ta question présuppose que je sépare la technologie et la forme de modernisation…
M. V. — Ma question suggère que, peut-être, tu accorderais le primat à la modernisation technologique par rapport aux autres formes de modernisation.
F. J. — Le terme de technologie est certainement piégé et tend à s’autonomiser au risque de glisser vers un déterminisme purement technologique. Mais ce n’était pas du tout le sens de mon propos. Mon intention était par contre d’identifier un certain régime de production industriel avec les innovations technologiques qu’il sécrète et qui lui permettent de surmonter ses crises. Comme Mandel je distinguerais trois étapes du développement capitaliste, chacune comportant sa propre base technologique. Cette périodisation me semble incontournable. Une fois qu’on l’a établie, il faut sortir de la diachronie pour rétablir une coupe synchronique et constater la coexistence des éléments provenant de temporalités différentes. Cette idée de coexistence d’éléments non-contemporains est très utile pour analyser des situations concrètes très diverses comme, par exemple, l’existence aux États-Unis d’un tiers-monde au sein même du Premier. On peut ainsi réintroduire une certaine complexité dans notre approche des temporalités à l’œuvre, et notamment des logiques et des productions culturelles.
Par rapport à la-dite modernisation politique — une sorte de technologie dans le domaine du droit et de l’État —, ces conceptions remontent non pas aux modernes mais à ce que j’ai appelé le premier moment du capital : le moment des Constitutions, du sécularisme, celui d’une première réflexion quant aux formes possibles d’un État laïque appelé à prendre la relève des monarchies et des formes de l’Ancien Régime. Le retour actuel à la philosophie politique est complètement idéologique. Le mot d’ordre d’une démocratie à la fois économique et réelle était essentiel. Seulement, le mot démocratie, aux États-Unis du moins, a été tellement corrompu par le système qu’il est devenu inutilisable. Pour la majorité des Américains ce mot signifie : Républicains ou Démocrates. Pour ceux qui essaient de penser une véritable démocratisation de l’existence collective, le mot démocratie n’est pas encore un véritable concept.
S. K. — Tu te démarquerais donc y compris des penseurs « radicaux » comme Samuel Bowles et Herbert Gintis ((Samuel Bowles & Herbert Gintis, La démocratie post-libérale, Paris : La Découverte, 1988)) qui préfèrent le mot démocratie à celui de socialisme pour définir leur projet, en expliquant que c’est le mot socialisme qui est piégé car perverti par le stalinisme, le goulag, etc. ?
F. J. — Je ne suis pas d’accord avec leur analyse. C’est une question pragmatique, qui dépend d’une évaluation politique, mais pour moi il en va tout à fait autrement. Je pense que le grand apport du marxisme a été de mettre l’accent sur ce que je suis très content d’appeler la dimension économique. Remplacer une terminologie essentiellement économique par une terminologie essentiellement politique équivaut à mon avis à une régression. Je dirai même qu’à notre époque un discours politique représente toujours un déplacement par rapport à l’économie politique. J’ai beaucoup d’admiration pour le travail de Ernesto Laclau et Chantal Mouffe sur le plan de l’analyse de la dynamique des groupes ((Ernesto Laclau & Chantai Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Londres : Verso, 1985)). Mais leur problématique, purement politique, évacue l’élément économique. Au niveau politique, selon eux, il peut certes y avoir des conjonctures où un problème économique occupe le devant de la scène et puis d’autres où il bat en retraite. Mais au niveau de l’analyse d’un système social, cette démarche conduit à une vision très limitée du politique.
Je dirais la même chose de la terminologie du pouvoir chez Foucault. Parler du pouvoir exclusivement en termes de domination tend à privilégier, si j’ose dire, les épiphénomènes : des processus d’une durée plus limitée qui tiennent à la conjoncture politique. C’est la tendance prédominante à l’intérieur de la gauche actuelle : mettre l’accent sur telle ou telle lutte immédiate ou locale. Faute d’articuler cette lutte locale avec le système en général, on finit par perdre le capitalisme de vue, l’idée de la politique devenant une attention perpétuelle à la critique des institutions. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, mais à ce moment la perspective anticapitaliste s’éloigne.
M. V. — À l’encontre des « intellectuels librement flottants » (free floating intellectuals), qui proclament la mort des utopies et l’épuisement du projet de libération sociale, en brûlant souvent les divinités discursives de leurs anciennes amours, tu proposes une théorisation systématique du postmodernisme en tant que logique culturelle du capitalisme avancé. Est-ce que tu crois que l’avènement du postmodernisme en tant que « mouvance » culturelle qui prend la relève du modernisme connote la fin de la modernité ?
F. J. — Nous ne maîtrisons pas l’usage de ces termes dont l’extension admet des variations. Si l’on accepte la périodisation proposée auparavant, nous vivons la fin du moderne, mais aussi la fin de la modernisation.
M. V. — C’est la fin du procès modernisation en tant que tel ou la fin d’une phase de la modernisation correspondant à l’âge monopoliste du capitalisme ?
F. J. — Selon le scénario-catastrophe décrit par Robert Kurz ((Cf. Robert Kurz, Der KoIIaps der Modernisierung, Leipzig : Reclam, 1994 (1e éd. 1991) )), c’est la fin de la modernisation tout court. J’entends par ceci la fin de la possibilité de moderniser la technologie, la fin de l’organisation du travail, de la forme de l’entreprise et de l’usine telles qu’elles existaient à l’époque du capitalisme industriel. Non seulement le tiers-monde est confronté à l’impossibilité absolue de rattraper les autres, mais le Premier monde commence à régresser par rapport à sa propre modernisation (voir le spectacle des États-Unis qui perdent leurs industries, la capacité de production de valeurs classiques, tout ce qui représentait la modernisation dans son acception canonique).
Concevoir le postmoderne comme la fin de la modernisation comporte des conséquences qui vont très loin. La postmodernisation (les technologies postmodernes telles l’informatique ou les techniques de communication) ne s’inscrit pas dans le prolongement de la modernisation : n’étant pas un mode de production de valeurs, elle s’avère incapable de satisfaire les besoins élémentaires de la population et de la nation. La fin de la modernité est une hypothèse féconde dans la mesure où elle dresse un état des lieux véritablement catastrophique : une crise multiple, l’absence de possibilités de modernisation, la disparition de la production des valeurs. C’est uniquement à ce titre que l’on est autorisé à se servir de la formule stricte de la fin de la modernité. Sinon on peut adopter un autre modèle dans lequel coexistent trois courants différents évoqués précédemment. Il devient alors simpliste d’évoquer une fin du moderne comme s’il s’agissait d’époques closes et étanches. Mais l’autre formule n’est pas inutile pour celui qui veut expliquer les aspects les plus frappants de l’actualité où une richesse extraordinaire côtoie une pauvreté sans précédent.
M. V. — La thématique de la fin de la modernité correspondant au scénario catastrophe équivaut à une description de la réalité sociale où le projet d’émancipation n’a plus de place. S’il en est ainsi, affirmer la fin de la modernité ne serait-ce pas la preuve avouée de la démission politique et intellectuelle ?
F. J. — Oui, mais ce n’est pas toujours le cas : pour certains, surtout aux États-Unis, les mots d’ordre du postmoderne et du refus du moderne sont libérateurs. Le moderne est alors identifié avec des structures de domination, patriarcales ou autres, et la fin du moderne correspond en conséquence à une situation de libération. C’est un paradoxe auquel il faut se confronter lorsqu’on essaie de penser le postmoderne. En un sens, on peut légitimement évoquer les aspects populaires ou populistes, en tout cas un certain pluralisme, qui caractérisent le postmoderne. C’est pourquoi je préférerais utiliser la formule de Robert Kurz qui parle de fin de la modernisation.
Vers une critique du capitalisme postmoderne
M. V. — Ta théorisation du postmoderne, défini par Jean-François Lyotard comme « incrédulité à l’égard des métarécits », se veut totalisante. En d’autres termes, tu proposes une approche systématique d’un phénomène qui résiste à la systématisation et qui souffre intrinsèquement d’une implosion définitionnelle. De surcroît, tu essaies d’historiciser un phénomène qui évacue d’emblée l’horizon de l’historicité. En quoi ton approche mérite-t-elle de s’inscrire dans une perspective de totalisation ? Quelles sont les « raisons d’être » qui fondent cette perspective ?
F. J. — C’est à désespérer, ou à rire, du mot totalité. Sartre parle de totalisation parce que la vision de la totalité est impossible. Nous essayons donc de faire la somme, de projeter et de déduire à partir d’une vue limitée de la réalité, du fait même que nous ne sommes pas dans la position de Dieu pour embrasser le monde d’un seul regard. La totalisation implique au contraire l’impossibilité d’une vision totalisante.
M. V. — Ce qui constitue un paradoxe.
F. J. — II y a un deuxième paradoxe qui tient au capitalisme, premier mode de production à être plutôt centrifuge que centripète. Ce qui le caractérise, c’est son aspect privé : son antisocialité. La description des effets qu’il produit doit se faire en termes résolument antisystématiques ou de dispersion, ce qui rend la description du capitalisme particulièrement difficile. C’est pour réconcilier ces impératifs en apparence contradictoires que Marx et d’autres ont inventé cet abus de langage qui s’appelle la dialectique.
Or ces contradictions sont d’autant plus exacerbées à l’époque actuelle que le capitalisme est mondial. S’agissant du système national ou même de l’impérialisme, on pouvait imaginer que les représentations dites scientifiques possédaient toujours une valeur épistémologique, alors qu’à l’échelle mondiale une description à prétention totalisante paraît hors de portée. L’analyse des modes de production est un problème de représentation avant même d’être un problème scientifique. C’est ainsi qu’on peut rejoindre l’analyse d’Althusser sur l’idéologie. Parler de représentation implique qu’elle est déjà problématique : si une représentation était véritablement possible, on ne parlerait plus en termes de représentation. La crise de la représentation est en fait à l’origine des tentatives de totalisation, par définition partielles mais néanmoins incontournables.
Sartre, quant à lui, identifie totalisation et praxis : la totalisation est ce qui se fait lors de toute praxis dans la mesure où celle-ci implique un déplacement de l’empirique vers un cadre plus vaste. Il est donc exclu que l’on puisse penser le monde sans essayer de totaliser. Le capitalisme actuel s’efforce pourtant de disqualifier toute vision globale afin de pouvoir se concentrer sur l’immédiateté technocratique qui correspond à sa logique intrinsèque de dispersion.
Le moteur d’une totalisation possible est l’expérience de groupe. Au fur et à mesure que cette expérience devient difficile, les possibilités de totalisation se compliquent. Ma stratégie consiste à voir la double face de l’historicité. Un aspect de Marx, je l’ai déjà évoqué, consistait à expliquer qu’une certaine pensée n’était possible qu’à partir de conditions historiques précises. J’ai essayé pour ma part, non pas de promettre une vision totalisante, mais de repérer les mécanismes qui entravent toute tentative de penser en termes de système ou de totalité : se mettre à distance de sa situation pour repérer combien nos points de vue sont étriqués et entreprendre ainsi une analyse des conditions de non-possibilité.
M. V. — Le postmodernisme, loin d’être à tes yeux une simple idéologie, un simple effet stylistique ou de surface, thématise les nouvelles formes hégémoniques de production culturelle au sein du troisième stade de l’accumulation capitaliste. Ton analyse matérialiste fait donc la navette entre ce moment du développement capitaliste et la mutation des mentalités, des mœurs et des logiques culturelles. Tu proposes une cartographie cognitive des phénomènes que le terme postmodernisme fédère, comme indissociable de virtualités de résistance et de critique radicale. Peut-on utiliser à cette fin les armes des postmodernes de manière homéopathique ?
F. J. — La reconstitution postmoderne du capitalisme multinational implique aussi la reconstitution à une échelle radicalement autre, difficile à saisir aujourd’hui, de la classe ouvrière. La vitesse des communications et la globalisation extraordinaire forment l’autre aspect des transformations du système. C’est le commencement d’une époque de spéculation financière étonnante où l’argent circule instantanément de par le monde, détruit tout un pan d’industrie, impulse la spéculation foncière en faisant des ravages dans l’économie et la vie urbaine. Mais en même temps ces mutations permettent d’envisager un réseau international entre intellectuels et militants de gauche beaucoup moins provincial qu’à l’époque moderne et qui permettrait la constitution de mouvements politiques ou du moins de contacts intellectuels féconds. Malgré leurs spécificités, tous les pays du monde sont confrontés — à des moments et à des degrés différents — à une même situation, et ceci transforme également l’objet de l’étude et les possibilités des intellectuels. Dans les conditions actuelles, ce serait déjà quelque chose si l’on pouvait imaginer un nouveau rôle pour les intellectuels.
M. V. — Une internationale de cerveaux, non-timorés ?
F. J. — Oui. L’activité de l’intellectuel ne dépend pas seulement du développement de son propre pays mais aussi d’un dehors. Par exemple, l’existence de l’Union soviétique, quoi qu’on puisse penser de son régime, ouvrait un espace aux intellectuels. La globalisation postmoderne peut être utile pour reconstituer cette distance.
M. V. — Le système devient aujourd’hui de plus en plus l’Innommable : des qualificatifs divers, subtilement forgés pour produire un effet d’éviction, font écran. Tout en reprenant le mot d’ordre des années soixante « nous devons nommer le système », tu proposes une analyse des conditions sociales et discursives qui conditionnent le retrait des tentatives de nomination. Est-ce un phénomène nouveau ?
F. J. — Le capitalisme a toujours fui sa nomination. Un langage symbolique qui le nomme est déjà un signe de radicalité : c’est un effort de cerner un mode de production afin de produire des alternatives logiques. Comme le disait Brecht, le public doit comprendre que ce qu’il prend pour un état de choses naturel et éternel est un effet historique, le résultat des actions humaines. Il peut de ce fait être modifié. Dès qu’on cerne le foisonnement de différentes pratiques sous la rubrique disponible de postmoderne, il devient possible d’explorer de nouvelles voies.
Ceci dit, le langage a son autonomie. Malgré mon effort de stabiliser la terminologie du postmoderne, celle-ci, du fait même de son caractère autonome (il en va de même du moderne), se prête à des usages qui m’échappent. Elle cesse d’être le nouveau nom du capital pour devenir autre chose qui est plutôt un alibi du capital. C’est le danger de toute théorie du postmoderne. Rien n’est fixé d’avance dans le domaine discursif. Je dirais même que l’effort de stabiliser une terminologie est sans doute un effort moderne. L’une des caractéristiques du postmodemisme est d’inventer des stratégies dont la mobilité défie toute maîtrise durable. C’est pourquoi, en fin de compte, le terme de capitalisme est préférable.
M. V. — Tu suggères en fait que l’Innommable est un effet de naturalisation du capitalisme : de son autocompréhension comme « Fin de l’histoire ».
F. J. — Exactement. L’éternisation du capital consiste dans l’idée que les autres moments du passé n’étaient pas différents du présent.
S .K. — Pour nommer le système, ne faut-il pas avoir déjà en vue autre chose ?
F. J. — Sans doute, mais on peut le dire autrement : si on est capable de nommer le système, c’est effectivement qu’on a autre chose en vue. L’idée qu’on s’est faite du socialisme porte les stigmates de circonstances historiques très particulières, certaines de ses acceptions sont inutilisables. L’essentiel du travail reste à faire.
Paris, 28 juin 1993
Entretien réalisé par Stathis Kouvélakis et Michel Vakaloulis, initialement paru dans Futur antérieur, n° 21, 1994.