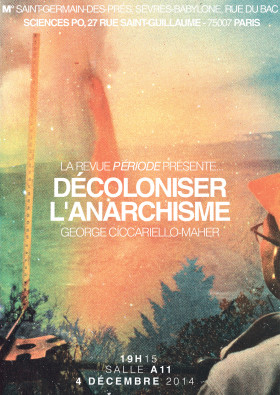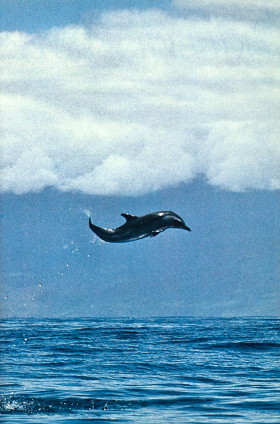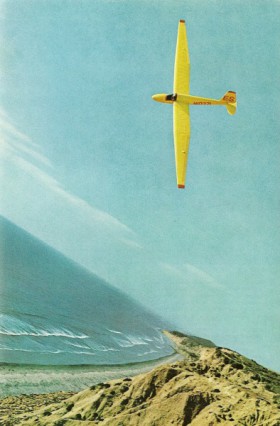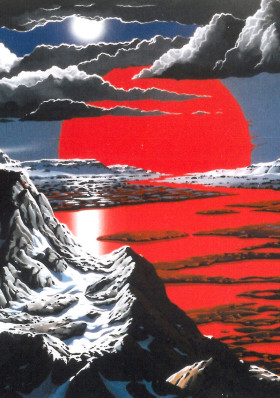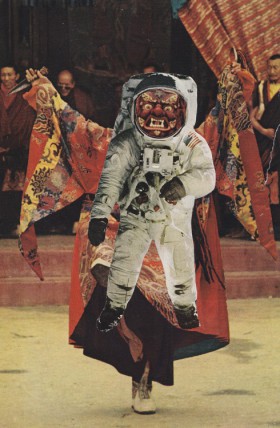Genèse d’un repas, ou l’économie mondiale dans une boîte de thon
En 1978, Luc Moullet réalisait un film qui tend à représenter les rapports de production à l’échelle mondialisée. Aujourd’hui, à l’heure où la théorie sociale est animée par l’enjeu de la totalité et sa représentation, l’article d’Audrey Evrard décrypte ce film, Genèse d’un repas, pour en détailler l’apport essentiel : sa mise en scène novatrice des rapports néocoloniaux dans les chaînes globales de marchandises, la stratification raciale entre travailleurs du Nord et du Sud. Entre critique du consumérisme occidental et du racisme en milieu ouvrier, Genèse d’un repas est au plus proche d’une pratique de « cartographie cognitive » appelée de ses vœux par Fredric Jameson.