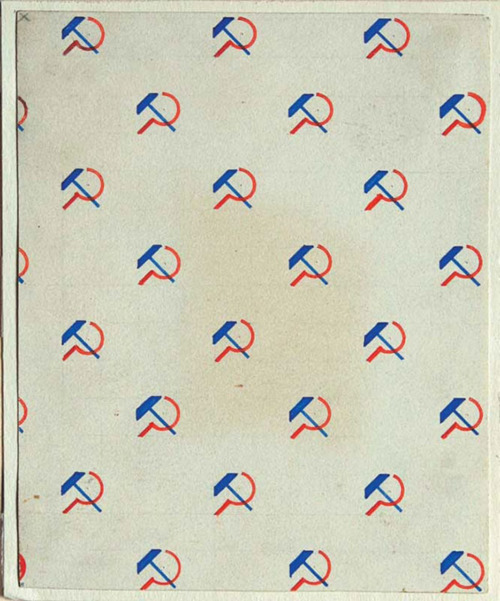Berlin, le 13 juin 1922.
J’ai lu avec intérêt l’article du camarade Duret, dans l’Internationale, au sujet du gouvernement ouvrier. C’est tout de même un bon signe que la Section Française de l’I.C. commence à s’intéresser aux problèmes qui touchent au mouvement allemand. En effet, les problèmes du mouvement allemand, et en particulier celui du gouvernement ouvrier, présentent un intérêt pour toute l’Internationale, et ce n’est pas seulement le droit, mais encore le devoir des camarades français de s’en occuper sérieusement, comme il est, d’autre part, du devoir des communistes allemands de suivre de près les problèmes du mouvement français.
Les mouvements communistes, français et allemand, exercent l’un sur l’autre l’influence la plus directe. Plus que partout ailleurs, il faut qu’il existe, entre la propagande et l’action de nos deux partis, cette « coordination » dont parlent les thèses du 3e Congrès concernant la tactique.
Passons maintenant à la question du gouvernement ouvrier.
Pour les camarades français, la difficulté de bien comprendre ce problème consiste en ceci : que la situation concrète qui a obligé le Parti Communiste en Allemagne (en plein accord avec l’I.C. et pour ainsi dire à l’unanimité) à poser la question du « gouvernement ouvrier » sur le terrain ouvrier, n’existe pas encore en France.
Quelle est la situation concrète ?
Elle est caractérisée par l’existence d’une coalition gouvernementale bourgeoise et sociale dans le Reich et d’un « gouvernement socialiste » en Saxe et en Thuringe. La revendication ayant trait à la formation d’un « gouvernement ouvrier » a été posée comme un mot d’ordre de combat contre la coalition bourgeoise-socialiste, et c’est dans cette situation particulière qu’elle est tout à fait compréhensible.
Cet état de choses n’existe pas encore en France, mais il pourra peut-être exister demain. Tout semble indiquer que les jours du Bloc National sont comptés et que l’étape suivante, très courte peut-être, sera celle d’une coalition gouvernementale radicale-bourgeoise et socialiste.
Et dans ce cas-là, le problème du gouvernement ouvrier deviendra aussi pour la France un problème d’ordre pratique, et c’est comme tel qu’il devra être traité.
Le camarade Duret considère cette question d’une manière abstraite, c’est-à-dire fausse. Il en donne une analyse logique et abstraite, mais nullement concrète et pratique. Il arrive donc à une série de contradictions logiques qu’il est incapable de résoudre.
Je vais essayer de trouver une solution à certaines contradictions logiques qui ont été indiquées par le camarade Duret ; je le ferai par rapport à la situation concrète en Allemagne, mais je ne promets pas de les résoudre toutes et ceci pour une raison bien simple. Seules les antinomies fictives, apparentes, peuvent être résolues. Cependant, le problème du gouvernement ouvrier est plein de contradictions dans son fond même : il contient toute une série d’antinomies dialectiques qui ne pourront être résolues que par un mouvement révolutionnaire effectif et non pas par quelques formules abstraites.
Mais toutes les revendications partielles ou provisoires que nous posons ont le même caractère. On n’en comprendra aucune, si l’on ne se rend pas compte que, toutes, elles recèlent une antinomie réelle ; et cela veut dire simplement que ces revendications passagères constituent des formes du mouvement révolutionnaire et qu’elles ne peuvent être dépassées et supprimées que par ce mouvement lui-même qu’elles ont préparé.
L’incompréhension fondamentale du caractère essentiel du gouvernement ouvrier consiste chez Duret en ceci qu’il le sépare du mouvement élémentaire des masses, qu’il méconnaît complètement que ce gouvernement ouvrier n’est le résultat d’aucun maquignonnage parlementaire, et a sa source dans une puissante vague révolutionnaire.
Duret écrit, dans la conclusion de son article : « Nous ne serons jamais contre un gouvernement ouvrier sorti au cours de la Révolution et qui s’appuierait sur les Conseils ouvriers, émanation même du prolétariat […]. Mais entre un gouvernement qui s’appuie sur les Conseils ouvriers et entre un “gouvernement ouvrier” qui s’appuie sur une majorité parlementaire et créé dans une période de calme plat, il y a un abîme. Il faut savoir distinguer entre les deux ; partisans du premier, nous ne pouvons être qu’adversaires résolus du second ».
Le « gouvernement ouvrier », dont Duret est « adversaire résolu », est un fantôme, produit de sa propre imagination, une caricature, et il est très regrettable que le camarade Duret, avant de s’élever contre le « gouvernement ouvrier », ne se soit pas donné la peine d’établir les faits tels qu’ils sont. Les discussions, les résolutions, les actes du Parti allemand, ne peuvent laisser aucun doute à un observateur consciencieux sur ce fait que le « gouvernement ouvrier » ne ressemble en rien à ce produit du maquignonnage parlementaire dont parle Duret.
Le « gouvernement ouvrier », considéré comme une revendication, constitue justement un moyen pour mettre en mouvement les masses, et il ne peut devenir une réalité qu’autant [sic] que produit d’un mouvement révolutionnaire des masses.
Le problème du « gouvernement ouvrier » fut posé d’abord en Allemagne en connexité avec la lutte pour la saisie des valeurs réelles (confiscation effective des entreprises capitalistes), pour le désarmement de la garde blanche bourgeoise, pour la transformation de la police de protection en une force armée prolétarienne, pour la destruction de la justice bourgeoise, pour l’éloignement des fonctionnaires réactionnaires, etc.
Y a-t-il quelqu’un, bien informé de la situation, qui croie qu’un gouvernement qui accepte de telles revendications puisse être formé « dans une période de calme plat » et qu’il s’appuie seulement sur une majorité parlementaire ?
Mais on nous dit que les Conseils ouvriers font défaut à un pareil gouvernement.
Les Conseils ouvriers ont péri après la première vague de la révolution en Allemagne. La question est de savoir comment ils peuvent être rappelés à la vie. Tout simplement grâce à une propagande pour les Conseils, pour les Soviets [sic] ? Sûrement non, mais uniquement grâce à une action large et profonde des masses, comme résultat non seulement d’une propagande théorique, mais encore de nécessités pratiques, immédiates. C’est le combat pour le gouvernement ouvrier qui fait naître, sous une forme quelconque, les Conseils ouvriers et qui exige une pression particulière et organisée des masses prolétariennes.
C’est pourquoi, en Saxe, nous posons comme condition absolue de la formation d’un gouvernement ouvrier, le principe suivant lequel toute loi, avant d’être votée, doit être soumise à la discussion et à l’approbation des Conseils d’usine du pays.
Il est évident que ces derniers constituent le noyau des Conseils ouvriers politiques et que ces noyaux se développeront forcément en Conseils ouvriers complets dans la bataille pour la réalisation des mesures révolutionnaires prises par le gouvernement ouvrier.
Mais à quoi [sic] encore un Parlement à côté des Conseils ouvriers ? Pour une raison bien simple. Parce que, en Allemagne, il n’y a aujourd’hui que la minorité de la classe ouvrière qui soit convaincue de la nécessité des Soviets, tandis que la majorité croit encore qu’on peut accoler les institutions parlementaires et soviétiques. Seule une expérience pratique peut convaincre cette majorité de la nécessité de rompre complètement avec les institutions parlementaires.
Si nos camarades russes, après la prise du pouvoir par les Soviets, ont encore convoqué l’Assemblée Constituante, c’est uniquement pour prouver pratiquement aux masses qu’on est obligé d’envoyer la Constituante à tous les diables.
Le Parlement et les Soviets existant côte à côte, certes, c’est une contradiction ; mais c’est une contradiction nécessaire et inévitable dans une situation où la majorité de la classe ouvrière est assez forte pour prendre en main le pouvoir, mais ne s’est pas encore débarrassée complètement des illusions de la démocratie bourgeoise. Cette antinomie sera réglée dans la lutte par la vie et non par un raisonnement abstrait.
Notre première tâche consiste donc à livrer une bataille pour les objectifs que la majorité de la classe ouvrière comprend, et pour lesquels elle est prête à lutter.
La classe ouvrière allemande, dans sa majorité, n’est pas encore préparée à combattre immédiatement pour un gouvernement des Conseils. Par contre, il semble que le moment s’approche où elle sera prête à rompre avec les partis bourgeois et à former un gouvernement ouvrier. Et il est ainsi tout indiqué, par la situation concrète, de mettre à l’ordre du jour, en Allemagne, à titre de revendication provisoire, la formation d’un gouvernement ouvrier.
Duret dit encore, en substance : « Vous ne considérez pas les social-réformistes comme capables de lutter même pour les réformes ; comment pouvez-vous vous attendre à ce qu’ils prennent des mesures révolutionnaires contre la bourgeoisie, étant ministres ? Quelle contradiction ! »
Contradiction, en effet : non pas toutefois contradiction due à notre logique, mais antinomie des faits. Personne ne s’attend à ce que les social-réformistes dirigent et mènent à bonne fin une révolution. Cependant, sous la pression des événements, sous la pression de leurs propres partisans, ils seront forcés de faire avec nous quelques pas qui, par la logique même des faits, conduisent plus loin. Ils s’arrêteront à un certain point : quant au mouvement qu’ils ont aidé, bien malgré eux, à déclencher, il les dépassera, s’il est assez puissant, ou bien ils l’arrêteront, s’il est faible. Telle est l’histoire de tous les débuts révolutionnaires. On ne comprend rien à ces changements brusques et à ces contradictions, si l’on n’envisage que la vie parlementaire quotidienne et les périodes historiques calmes.
*****
Empruntons quelques exemples à l’histoire de la Révolution allemande.
Le 9 novembre 1918, à 9 heures du matin, M. Fritz Ebert fut nommé, par le prince Max de Bade, au poste de dernier chancelier du kaiser. Le 10 novembre, il était déjà « commissaire du peuple » de la République allemande.
En l’espace de 24 heures, des millions de bourgeois se transformèrent de royalistes en républicains.
Certainement, ce processus de transformation a ses limites, ses lois propres. Les conducteurs idéologiques des masses sont liés, leur action est limitée par leur propre idéologie. Mais les masses qui les suivent voient plus loin, elles s’abandonnent à la pression des faits, elles changent leur idéologie sous l’influence des événements, c’est-à-dire qu’elles changent leurs chefs.
Pourquoi ne nous bornons-nous pas à exercer notre influence sur les masses elles-mêmes ? La raison en est simple. Les masses sont organisées ou bien elles sont soumises à l’influence des organisations.
Pour déclencher le mouvement, on a besoin des chefs des organisations. On en a besoin tout particulièrement dans les périodes où la tension dans les masses est encore faible. On en a besoin d’autant plus que les masses sont mieux organisées. Lorsque, une fois déclenché, le mouvement se poursuit, devient plus large et plus profond, il rejette ceux qui veulent l’arrêter.
Telle est la marche de tout mouvement révolutionnaire en croissance. Il suffit de jeter un coup d’œil sur l’histoire de la Révolution russe, de mars à novembre 1917, pour trouver une confirmation de ce fait.
Il est évident qu’il ne s’agit point, en l’occurrence, des simples pourparlers diplomatiques avec les chefs social-réformistes. Il s’agit de faire valoir à leurs yeux la pression déjà existante des masses de leurs adhérents, pour renforcer, d’autre part, le mouvement grâce à l’appui des chefs eux-mêmes. Cette méthode n’est point aussi simple que certains de nos camarades français peuvent se l’imaginer. Elle exige une stratégie souple, un changement rapide de méthodes et elle n’a, malgré cela, rien d’artificiel ; elle constitue, au contraire, une conséquence naturelle de la marche des événements.
Quels chefs doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’appliquer cette tactique ? – Nous voulons mettre le prolétariat en mouvement. Il faut donc prendre en considération les dirigeants des organisations politiques ou syndicales qui exercent une influence réelle sur la classe ouvrière et qui s’appuient sur les masses prolétariennes.
Duret demande : « Quelle est la différence essentielle entre les partis social-réformistes et bourgeois radicaux ? Ne poursuivent-ils pas, en réalité, la même politique bourgeoise ? N’exercent-ils pas, les uns et les autres, une influence sur les masses prolétariennes ? »
La question qui nous intéresse, au point de vue du but à atteindre, est tout simplement celle-ci : sur quelles masses s’appuient les partis, les uns et les autres, au point de vue de l’organisation ? C’est cela qu’il faut distinguer.
Un exemple permettra de nous en rendre compte.
Il n’est pas douteux que le Parti allemand du Centre (parti catholique) exerce encore une certaine influence sur les larges masses prolétariennes. Toutefois, sa base, au point de vue de l’organisation, n’est pas le prolétariat, mais la petite bourgeoisie. Il n’entre donc pas pour nous en ligne de compte. Par contre, la base des syndicats chrétiens, au point de vue de l’organisation, est certainement prolétarienne. Leur idéologie n’est pas celle de la lutte de classe, elle est bourgeoise, mais elle n’est pas ouvertement anti-prolétarienne, comme par exemple celle des syndicats jaunes. Ils comptent donc pour l’application de notre tactique.
Les radicaux-socialistes français sont d’essence petite-bourgeoise non seulement par leur idéologie, mais aussi par la base sur laquelle s’appuie leur organisation. Voici pourquoi le front uni prolétarien n’a pas besoin d’eux. Telle est la réponse à la question de Duret sur ce point.
Duret demande encore : « Si l’attitude des social-réformistes, au sein d’un gouvernement ouvrier, est hésitante, paralysante, de quelle façon les communistes, qui participent à un pareil gouvernement, pourront-ils les démasquer ? Et les masses comprendront-elles ? »
Je réponds : les masses prolétariennes comprendront beaucoup mieux que n’ont compris jusqu’ici maints chefs communistes. Elles comprendront si l’on se tourne vers elles. Pour ne pas être entraîné à la remorque par les éléments social-réformistes du gouvernement, il faut que la Parti soit d’une fermeté à toute épreuve, que la fraction parlementaire soit soumise sans réserves à la direction du Parti et, avant tout, que le Parti soit bien organisé et compte de nombreux adhérents. On ne peut pas tenter une telle expérience avec un parti qui n’est ni sûr de lui-même, ni fortement discipliné.
D’autre part, la coalition, à la suite de laquelle le Parti Communiste constitue une cellule du « gouvernement ouvrier », n’est pas éternelle. Un gouvernement ouvrier n’est pas un mariage, pas même une liaison : l’amour n’y joue aucun rôle, mais seulement la raison froide et l’intérêt.
Duret croit qu’un « gouvernement ouvrier » doit donner forcément un regain de crédit au parlementarisme et corrompre parlementairement le Parti Communiste. Quant à ce dernier point, un Parti Communiste qui se laisse corrompre par le parlementarisme, n’est communiste que de nom. Qu’un parti vraiment communiste puisse se servir du Parlement dans l’intérêt de la Révolution, cela est prouvé aussi bien par l’exemple russe après 1905-1906 que, croyons-nous, par celui du Parti allemand. Le danger existe, sans aucun doute, et ce n’est nullement un accident qu’un certain nombre de chefs parlementaires, en Allemagne, soient passés du communisme au centrisme socialiste. Cependant, c’est l’expérience allemande qui prouve le mieux à quel point un Parti Communiste arrive vite et radicalement à bout de ce danger, s’il a la force, l’esprit de décision et la clarté nécessaires.
Un gouvernement ouvrier fera-t-il remonter le crédit du parlementarisme ? Le camarade Duret, en posant cette question, se croit assurément lui-même très révolutionnaire et très antiparlementaire. Il ne s’aperçoit pas qu’il soutient ainsi que les méthodes parlementaires suffisent pour prendre des mesures révolutionnaires dans l’intérêt de la classe ouvrière.
De deux choses l’une : ou bien on admet que les méthodes de la démocratie bourgeoise sont suffisantes pour faire une révolution prolétarienne, pour assurer la domination de la classe ouvrière ; c’est alors et seulement alors qu’on peut redouter que le gouvernement ouvrier ne renforce le crédit du parlementarisme auprès de la classe ouvrière.
Cette hypothèse est contredite par les expériences de deux révolutions : celle de la Commune de Paris et, sur une plus grand échelle, celle de Russie. En tout cas, elle est contraire à la théorie communiste.
Ou bien on admet que le « gouvernement ouvrier » sera forcé de recourir aux mesures d’une dictature prolétarienne et d’en créer les organes ; et alors, il est clair que les institutions parlementaires non seulement n’y gagneront pas, mais y perdront du crédit et, à un certain tournant de la guerre civile, seront jetées par-dessus bord.
Et, ici, revenons au point décisif.
La base de tous les malentendus du camarade Duret, c’est le fait qu’il s’imagine qu’un « gouvernement ouvrier » qui puisse [sic] être formé et vivre dans la banalité quotidienne d’une vie parlementaire. Cependant, si un tel gouvernement est créé, il ne peut l’être qu’avec un programme révolutionnaire de transition, – soutenu par les masses prolétariennes qui sont capables de le réaliser. Un « gouvernement ouvrier » ne signifie point le début d’une idylle parlementaire, mais le commencement de la guerre civile, l’exaspération de la lutte. La première mesure fondamentale prise par un « gouvernement ouvrier » sera le désarmement de la bourgeoisie et l’armement de la classe ouvrière.
Un gouvernement ouvrier sera obligé immédiatement de prendre des mesures tendant à soumettre les entreprises capitalistes au contrôle du gouvernement ouvrier, etc.
Il est évident qu’en face de ces mesures destinées à assurer à la classe ouvrière une position dominante, la bourgeoisie ne se tiendra pas tranquille. Elle utilisera le Parlement comme un champ de bataille pour organiser ses forces. Elle mobilisera, dans ce but, tous les éléments de l’appareil gouvernemental dont elle dispose. Elle mettra en mouvement sa presse.
Il va de soi qu’on ne pourra pas abandonner à l’ennemi, dans la guerre civile, les armes de la tribune parlementaire. On ne pourra laisser à cet adversaire aucune place dans l’administration et dans la justice. La logique même du combat obligera à marcher, pas à pas, vers la destruction de l’appareil d’État, démocratique et bourgeois, depuis le Parlement jusqu’à la justice, etc., et à construire un État prolétarien.
L’avant-garde communiste sait, par raisonnement théorique, que le chemin de la révolution prolétarienne passe par la dictature et elle connaît, dans leurs grands traits, les formes et les moyens de cette dictature. Ces conceptions des éléments avancés de la classe ouvrière facilitent la marche de celle-ci, lui rendent le chemin plus court, mais elles ne peuvent pas remplacer l’expérience pratique des masses elles-mêmes.
La démocratie bourgeoise ne sera pas vaincue par la critique seule que, nous autres communistes, nous émettons à son égard, toute nécessaire et profitable qu’elle soit. Le Parlement et le préjugé parlementaire ne disparaîtront que le jour où la classe ouvrière sera forcée de briser le Parlement afin d’arracher cette arme de la main de l’ennemi.
L’idée principale du « gouvernement ouvrier » est celle que la propagande théorique seule, auprès des masses les plus larges, ne pourra pas conduire à une République des Conseils et qu’elle doit être liée avec la pratique du combat.
Toujours est-il que le « gouvernement ouvrier » est quelque chose d’absolument différent de ce que le camarade Duret s’imagine.
Je crois avoir aussi fourni des preuves que les objections de Duret contre le « gouvernement ouvrier » ne sont qu’en apparence des objections radicales, fondées sur des principes, et qu’en réalité, c’est un doute envers les principes mêmes du communisme qui est à leur base.
Il m’a semblé important de montrer aux camarades français l’incompréhension fondamentale du principe de « gouvernement ouvrier » dont a fait preuve ce camarade, non seulement pour qu’ils comprennent, comme il est nécessaire, la tactique du Parti allemand, mais surtout pour que notre Parti frère français puisse s’initier à la tactique du front unique.
Car les malentendus, dans le fond, sont les mêmes dans l’une et l’autre question.
Première publication dans le Bulletin communiste, 3ème année, n° 27, 29 juin 1922, p. 514-517.