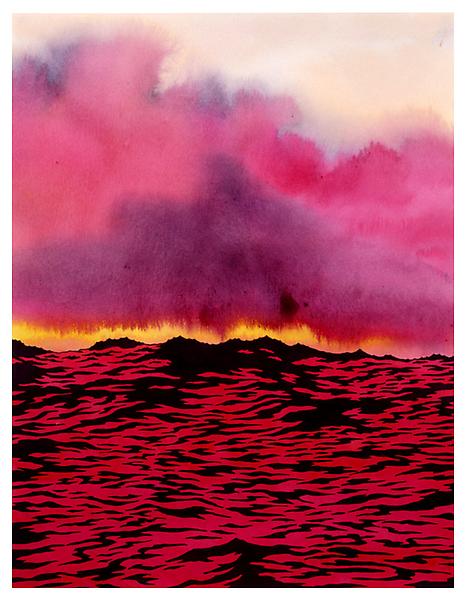Nous nous trouvons actuellement face à deux types de crises très différentes, même si, en fin de compte, leur développement historique doit être traité de concert. À l’Est se déroule une crise révolutionnaire du système social lui-même, qui est en état de désintégration et de transformation en quelque chose d’autre, le plus probable étant le capitalisme. À l’Ouest, la crise de profitabilité des deux dernières décennies a porté atteinte à la santé économique de plusieurs des principaux trusts du système capitaliste, même si elle n’a pas menacé le système lui-même. C’est en explorant dans un premier temps les origines et le développement de la crise à l’Est que nous serons par la suite mieux disposés pour analyser comment les crises respectives de ces deux régions s’interpénètrent et, en particulier, comment le système capitaliste occidental, toujours dynamique bien que touché par la crise, affectera le capitalisme émergent, assez peu dynamique, à l’Est.
Le système bureaucratique
La crise à l’Est puise son origine dans l’incapacité du système social bureaucratique à apporter la liberté et la démocratie ou, plus spécifiquement, à fournir des biens. La plupart des observateurs à l’Ouest, ainsi que les groupes dominants à l’Est, attribuent les difficultés du système à la planification – opposée au marché ; ils croient que la planification en tant que telle ne peut que fonctionner de façon inefficace. Cependant, ces observateurs ne parviennent pas à se rendre compte que l’efficacité du plan ou du marché ne peut être jugée qu’en fonction du système de rapports sociaux dans lequel chacun s’inscrit. L’échec de la planification dans le système bureaucratique doit être comprise au regard de son système de rapports sociaux.
Plus spécifiquement, la bureaucratie s’y est constituée et s’est reproduite comme une classe dominante, en raison de sa capacité à extraire un surplus de la collectivité des producteurs directs, la classe ouvrière. Et cette capacité lui était octroyée par l’usage direct de la force. La bureaucratie s’approprie un surplus, d’abord en organisant la division du travail de façon directe et coercitive, en allouant les facteurs de production (en particulier le facteur travail) à chaque branche individuelle et en s’appropriant les marchandises de chaque entreprise et de chaque branche ; la bureaucratie s’assure ensuite, par la contrainte, que les travailleurs produisent collectivement un surplus supérieur au coût de leur propre reproduction, le coût salarial.
La bureaucratie dépend directement de la coercition dans la mesure où, contrairement aux capitalistes, elle ne peut pas entièrement séparer les travailleurs de leurs moyens de production et de leur subsistance. L’objectif de la bureaucratie dans sa globalité est clairement de maximiser le surplus social total ; plus le surplus social disponible est élevé, plus il est facile de réaliser le(s) but(s) spécifique(s) qu’elle peut se fixer. Afin de maximiser le surplus social total, la bureaucratie juge qu’il est dans son intérêt – elle n’a pas beaucoup d’autre choix – d’embaucher tout travailleur disponible, dans la mesure où chaque travailleur supplémentaire embauché augmente le surplus social (tant que ce travailleur peut individuellement produire un surplus au-delà de son salaire).
Par conséquent, le système économique bureaucratique s’est dans une large mesure développé de manière extensive – en augmentant son surplus par l’emploi de nouveaux travailleurs et en mettant des machines à leur disposition – plutôt que de manière intensive – en transformant les moyens de production auxquels chaque travailleur a accès. Ainsi la classe ouvrière dans son ensemble constitue la ressource productive la plus importante de la bureaucratie, alors que les travailleurs au chômage représentent un gaspillage de ressources.
Les conséquences sont de portée historique. Si les travailleurs ont bien peu de contrôle sur les moyens de production et de subsistance, ils ont tout de même droit à la sécurité de l’emploi. En règle générale, il n’est pas dans l’intérêt de la bureaucratie de licencier ou de renvoyer les personnes. Par conséquent, la bureaucratie ne peut pas utiliser efficacement la dépendance des travailleurs à l’emploi, comme peut le faire le capital, pour les rendre économiquement dépendants d’elle. Au contraire, la bureaucratie doit chercher à contrôler strictement la mobilité du travail de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas tirer profit de la demande insatiable de la bureaucratie pour obtenir des augmentations de salaires auprès de firmes concurrentes. Ainsi, parce que les travailleurs sont fondamentalement fusionnés à leurs moyens de production et de subsistance, il est difficile pour la bureaucratie de les soumettre à un contrôle managérial. À l’inverse, elle doit extraire son surplus des travailleurs par la force, en dernière analyse par un contrôle total sur les forces armées et sur la police. Ce n’est pas un hasard si on trouve des agents du KGB dans toutes les usines.
Ainsi dans le système bureaucratique la force de travail n’est pas une marchandise. Même lorsque – disons pendant des périodes de réforme – les entreprises sont autorisées à mettre une partie de leur production sur le marché, elles ne sont pas strictement dépendantes du marché pour acquérir leurs moyens de production, ni pour leur reproduction, ni pour la vente des marchandises qu’elles produisent. En effet elles ne sont pas soumises à l’exigence de maximisation de leurs profits et elles ne sont pas autorisées à faire faillite. Par conséquent, contrairement au capitalisme, la force de travail dans le système bureaucratique ne circule pas entre des entreprises en concurrence dont la capacité de disposer de travail dépend de leur profitabilité relative et donc de leur capacité à offrir un salaire (elle est déterminée par leur capacité à minimiser le rapport entre leurs coûts et le prix de leur production).
Dans la mesure où la classe dominante bureaucratique doit extraire son surplus par la contrainte directe, la condition nécessaire pour sa domination est l’exclusion effective des travailleurs de la citoyenneté, d’une place dans l’État. La démocratie parlementaire bureaucratique est donc une contradiction dans les termes. C’est donc la forme particulière d’antagonisme entre la classe ouvrière et la bureaucratie – sur le lieu de travail et dans le rapport à l’État – qui constitue l’entrave essentielle à la possibilité pour le système d’assurer une allocation efficace des ressources et une hausse de la productivité. Parce qu’ils ne contrôlent ni leur production (leur surproduit) ni leurs moyens de production, les travailleurs ne sont pas incités à améliorer leur travail ni à fournir aux planificateurs l’information sur leur production locale dont ils ont besoin pour planifier et pour coordonner la production globale. Par ailleurs, comme la classe ouvrière est en un sens fusionnée avec les moyens de production, il est particulièrement difficile pour les bureaucrates et pour les dirigeants de prendre le contrôle du processus productif pour pouvoir, de leur propre initiative, transformer les forces productives.
La rationalité économique de la bureaucratie
C’est en référence à cette structure bureaucratique des rapports sociaux – ainsi qu’aux opportunités et aux limites qu’elle établit – que les individus et les classes déterminent la manière la plus raisonnable de maintenir ou améliorer leur situation. Compte tenu de leurs positions dans la structure, la plupart des travailleurs, tout comme nombre de bureaucrates et de dirigeants, jugent raisonnable d’adopter les trajectoires d’activité économique qui nuisent aux efforts que produit le système pour coordonner et développer les forces productives. Pourquoi en est-il ainsi ?
D’abord, contrairement aux capitalistes, les dirigeants des entreprises ne sont pas incités à introduire de nouvelles techniques ni même à produire en réponse à la demande. Ils ne peuvent pas s’approprier directement les profits de leurs entreprises et les utiliser pour investir ou pour consommer ; ils ne peuvent pas non plus faire faillite si leur taux de profit, et donc leur taux d’investissement, est faible ou inexistant. Contrairement aux capitalistes, ces dirigeants ne subissent pas de pression pour adopter des innovations permettant de réduire les coûts ; ils ne sont pas non plus obligés de modifier leurs pratiques pour produire des biens dont le prix a augmenté en raison de la demande. Le système bureaucratique est ainsi considérablement désavantagé par rapport au capitalisme à la fois en termes de développement des forces productives – c’est-à-dire d’amélioration de la productivité, de l’efficacité – et d’allocation efficace des ressources.
Au lieu de maximiser le taux de profit, les dirigeants individuels cherchent à s’approprier le plus possible de machines, de matériaux et de travail afin de maximiser leur production potentielle. En même temps, ils ont intérêt à dissimuler à l’appareil central de planification les moyens de production dont ils disposent – qui correspondent à la capacité productive réelle de l’entreprise. C’est en maximisant les ressources dont ils disposent – leur capacité productive – et en communiquant à la bureaucratie l’estimation la plus faible possible de cette capacité, que les dirigeants sont dans la meilleure position pour satisfaire les quotas établis par la bureaucratie avec son « plan ». Satisfaire les exigences du plan de la bureaucratie est le meilleur moyen pour les dirigeants de recevoir des récompenses et des promotions.
La seconde raison de l’adoption de ces pratiques par les dirigeants dans le système bureaucratique implique les travailleurs eux-mêmes. Contrairement au capitalisme, les dirigeants dans le système bureaucratique ne disposent pas du meilleur mécanisme pour discipliner le travail au sein du processus productif dans une société de classe, à savoir la menace du licenciement. Parce que leur objectif est de maximiser la production potentielle des entreprises, les dirigeants dans le système bureaucratique sont clairement incités à conserver tout travailleur qui produit ne serait-ce que le surplus minimum au-delà de son salaire. De plus (nous le verrons), parce que la bureaucratie centrale est hostile à ce qu’une entreprise, même la plus inefficace, fasse faillite, y compris si elle produit à perte – elle fournit des subventions supplémentaires aux entreprises « non rentables » pour leur éviter la faillite –, il est souvent dans l’intérêt des dirigeants de conserver les travailleurs ou d’embaucher de nouveaux travailleurs dans leurs entreprises, même s’ils ne parviennent pas à produire plus qu’ils ne coûtent.
Dans une telle situation, les travailleurs sont conscients qu’ils n’ont pas à craindre de perdre leurs emplois en raison de l’insuffisance de leur effort ou de la faiblesse de leur performance. En outre, il est souvent dans l’intérêt du dirigeant de maximiser les salaires, ainsi que d’autres avantages pour les travailleurs afin d’obtenir leur coopération et d’assurer la stabilité. Dans ce contexte, la bureaucratie n’a pas les moyens de connaître les ressources dont disposent réellement les entreprises, puisqu’elle dépend pour cette information des dirigeants et des travailleurs des entreprises, qui n’ont aucun intérêt à la lui fournir. Par conséquent, la bureaucratie est incapable de déterminer le réel degré d’efficacité des entreprises. Il est clair que connaître la quantité produite par les entreprises sans connaître la quantité de leurs moyens de production n’apporte aucune information sur leur rendement.
Plus généralement, parce que la bureaucratie ne dispose pas de critère « objectif » sur lequel se fonder pour mesurer l’efficacité de chaque unité – contrairement aux propriétaires capitalistes –, elle ne peut pas évaluer les dirigeants sur la base du résultat (la rentabilité). Elle est par conséquent obligée d’établir des relations personnelles pour garantir la performance des unités de production. La « corruption » – par laquelle les apparatchiks récompensent / promeuvent leurs partisans dans l’administration d’État et dans les entreprises afin d’obtenir des résultats – devient dès lors indispensable au fonctionnemet du système.
Cela n’exclut pas l’usage de la terreur contre les dirigeants et contre les travailleurs dans le but d’améliorer la performance ; elle est rendue possible par un système d’espionnage industriel et de sanctions pour absence de performance. Toutefois, comme l’ont découvert les seigneurs féodaux et les maîtres d’esclaves, c’est au mieux une manière décente d’extraire la plus-value absolue – c’est-à-dire plus de production avec plus de moyens de production – mais c’est un moyen inefficace pour permettre l’innovation technique nécessaire à l’amélioration de l’efficacité – c’est-à-dire plus de production avec les mêmes moyens de production. Le résultat est que le système « économique » bureaucratique doit fonctionner, à tout niveau, de manière essentiellement « politique ». Cependant malgré son affirmation qu’il utilise l’industrie moderne, son fonctionnement politique ressemble plus à l’ancien régime – qui repose sur un mélange de coercition et de corruption – qu’au capitalisme avancé.
Fonctionnement économique du système
Dans l’ensemble, les trajectoires économiques du système bureaucratique – les lois de son mouvement pour ainsi dire – résultent de trajectoires de comportement que ses individus et ses classes sont contraints d’adopter. Par exemple, il est incapable de planifier au sens strict, non pas parce que la planification est en soi impossible, mais parce que la bureaucratie ne dispose d’aucun moyen pour obtenir l’indispensable coopération des unités du système – ses dirigeants et ses travailleurs –, qui est nécessaire pour maximiser l’information et l’efficacité.
La bureaucratie n’a notamment pas la possibilité d’empêcher ses entreprises d’accumuler du travail, des machines, des matériaux dans le but de maximiser la production potentielle, quelle que soit la demande. De la sorte, le système est fragilisé par une surproduction massive et par l’apparition simultanée de pénuries tout aussi massives. À ce stade, la bureaucratie tente, par essais et erreurs, de réaliser des ajustements en forçant les réallocations nécessaires. Entretemps, elle a beaucoup de mal à générer des innovations, puisque les entreprises ne subissent pas de pression concurrentielle pour réduire les coûts de production. Les forces productives sont ainsi transformées très lentement, la tendance pour chaque unité étant aux des rendements décroissants. À long terme, cela conduit à une croissance encore plus lente. Une présentation schématique du développement historique de ce système permettra de clarifier cette trajectoire.
Évolution historique du système
En URSS, c’est entre le milieu des années 1920 et le milieu des années 1930 que la bureaucratie a consolidé son pouvoir en instaurant un contrôle monopolistique de l’État et un contrôle politique du monopole étatique sur l’économie. Pour le dire simplement, l’économie était hypercentralisée à travers l’État, ce qui a permis à la bureaucratie de contrôler la production sociale et le surplus.
La conformité aux exigences du contrôle bureaucratique est donc le seul moyen de comprendre la collectivisation de l’agriculture dans d’immenses fermes d’État, qui a handicapé l’agriculture soviétique pendant toute une période. De même, les premiers plans quinquennaux avaient notamment pour objectif de soumettre la classe ouvrière à une discipline terroriste, en réaction à la résistance croissante des travailleurs et à ses conséquences dans la production : une réduction en effort et en application au travail.
Pendant la phase initiale de développement – la soi-disant accumulation primitive socialiste – les économies bureaucratiques furent capables d’améliorer à la fois le niveau de productivité et l’efficacité de l’allocation des ressources. Elles ont augmenté la production des travailleurs pour chaque unité de production, en se contentant d’obliger les travailleurs ruraux relativement improductifs à venir en ville, où furent mises à leur disposition des machines de meilleure qualité. Les bureaucrates purent améliorer l’allocation des ressources en se fixant comme objectif la production de quantités déterminées d’un certain nombre très limité de biens finaux – en particulier des armes –, des matières premières indispensables et des biens semi-finis comme le fer, le charbon, l’acier, ainsi que des machines de base. Moins les tâches que se fixe l’économie planifiée sont nombreuses, plus il lui est facile de faire face à son problème de planification.
Or, une fois le transfert de la force de travail de l’agriculture à l’industrie réalisé pour l’essentiel, les gains pouvant être obtenus de l’augmentation de la taille de l’équipement à disposition de chaque travailleur étaient épuisés. Dorénavant, pour transformer leur technique, les économies bureaucratiques devaient dépendre de leurs unités constitutives ; pour toutes les raisons énoncées précédemment, le processus fut au mieux fort hésitant.
Dans le même temps, les régimes bureaucratiques furent de plus en plus contraints de diversifier leurs économies en réponse à la demande insatisfaite des populations en biens de consommation. Or, en agissant de le sorte, ils ont été confrontés aux considérables entraves de leurs économies à la planification – sans parler du niveau de sophistication nécessaire à la planification pour répondre sans cesse aux demandes changeantes des consommateurs. Fondamentalement les économies bureaucratiques ont été paralysées lors de la transition d’une accumulation extensive à une accumulation intensive… les seules issues étaient un tournant vers le capitalisme ou un socialisme démocratiquement planifié.
Économies bureaucratiques et capital mondial
Cependant, le déclin de la productivité ne peut pas en soi rendre compte des récents développements explosifs à l’Est. Alors que toute analyse des systèmes bureaucratiques doit partir de leurs contradictions internes, leurs crises croissantes au cours des deux dernières décennies doivent être envisagées dans le cadre de leurs relations avec le système capitaliste mondial.
Dans un monde où la compétitivité militaire et politique d’États dépend en dernière analyse de la productivité économique, l’incapacité des systèmes bureaucratiques à augmenter leur productivité aussi rapidement que les États capitalistes les a défavorisés pendant des décennies. En consacrant, pour rester à niveau, une proportion croissante de leur PNB à des dépenses militaires inutiles, ces régimes n’ont fait qu’exacerber leur problème fondamental de productivité.
Sous la pression de la course aux armements menée par les États-Unis au cours de la dernière décennie, les économies bureaucratiques ont été contraintes, ne serait-ce que pour rester à niveau politiquement et militairement, de se lancer dans une fuite en avant, alors même que leur productivité continuait à s’effondrer. Ayant acquis une meilleure connaissance du mode de vie occidental et un meilleur accès aux biens occidentaux, les « populations » – en raison d’un assouplissement à la fois des transports et de la circulation de l’information – avaient par ailleurs fait l’expérience de ces disparités de manière encore plus intense et commencèrent à réclamer plus vivement des améliorations de qualité de vie.
Du marché à la crise du marché
La crise actuelle à l’Est puise ses origines immédiates dans l’échec des « réformes de marché » qui ont été mises en œuvre dans les années 1970 et au début des années 1980 ; elles avaient précisément pour intention d’étouffer ces demandes de changement. Un certain nombre d’États bureaucratiques, dont la Hongrie et dans une certaine mesure la Pologne, ont cherché à résoudre leurs difficultés économiques en accordant aux entreprises individuelles une plus grande autonomie par rapport au contrôle central.
En particulier, ils autorisèrent les unités individuelles à prendre leurs propres décisions d’investissement, à acheter et vendre leur production sur le marché et à contracter librement des prêts. Dans le même temps, ils commencèrent à s’ouvrir au commerce international et à contracter des prêts massifs auprès des banques occidentales. Cependant, alors qu’ils espéraient que « le marché » puisse être utilisé pour résoudre leurs problèmes, le résultat fut sans ambiguïté un désastre, démontrant l’impossibilité d’un socialisme de marché situé entre capitalisme et socialisme.
N’étant pas complètement acquis à l’idée de céder le contrôle direct de leurs économies – sur lesquelles elles continuaient à exercer une domination –, les apparatchiks de Hongrie et de Pologne n’introduisirent pas de réformes allant vers le capitalisme. Si ces bureaucraties avaient autorisé aux entreprises de vivre ou de mourir en concurrence sur le marché – une concurrence pour la force de travail, pour les moyens de production et pour la finance, comme le font les capitalistes – elles auraient perdu le contrôle qu’elles avaient sur les économies. Allouer les ressources en fonction de la profitabilité plutôt qu’en fonction du plan aurait laissé les profits entre les mains des capitalistes ayant réalisé les meilleurs investissements. Les bureaucrates à l’Est auraient été réduits à la taille de leurs homologues à l’Ouest, c’est-à-dire capables d’intervenir dans leurs économies, mais uniquement dans la mesure où ils le font en accord avec les impératifs de rentabilité des firmes. En d’autres termes, ils seraient devenus des otages des capitalistes, la nouvelle classe dominante.
Ainsi, même s’ils mirent en œuvre leurs réformes, les bureaucrates conservèrent, à la fois en Hongrie et en Pologne, un contrôle direct sur d’importantes industries. Ils continuèrent également à fixer les prix sur certains biens, tout en prélevant les impôts et en accordant certaines subventions.
Le fait plus important encore est que les bureaucraties n’ont jamais caché qu’elles interviendraient pour empêcher les entreprises de faire faillite. De la sorte, alors qu’elles bénéficieraient à la fois d’un accès aux nouveaux marchés pour le crédit et d’une plus grande liberté pour agir dans leurs propres intérêts, les entreprises dans le système bureaucratique ne souffraient d’aucune des contraintes de la concurrence capitaliste entre entreprises. Par conséquent, en règle générale, les réformes permirent à chaque entreprise à la fois d’accumuler – beaucoup plus vite qu’auparavant – des ressources en travail et en matières premières, des ressources financières et, simultanément, d’investir à des niveaux plus élevés que par le passé. Il n’est donc pas surprenant que les anciennes formes de crise firent leur réapparition, mais de manière encore plus accentuée. L’apparition simultanée d’énormes surabondances et d’immenses pénuries menaçait de paralyser l’économie
Pour aggraver la situation, les autorités ont associé leur « tournant interne vers le marché » à de fortes augmentations d’échanges commerciaux et de prêts en provenance de l’Ouest. Or, puisque ces réformes ne permirent pas d’améliorer l’efficacité de ces économies, elles n’ont pas pu accroître suffisamment leurs exportations pour pouvoir être en mesure de payer les importations en hausse, sans parler de couvrir les charges d’intérêt sur leurs prêts. Le poids de la dette contractée pendant les réformes pèse toujours fortement sur les perspectives de croissance en Pologne et en Hongrie, que le système social de ces pays soit consolidé ou non.
Processus révolutionnaire en Europe de l’Est
À la fin des années 1980, les économies de Pologne et de Hongrie traversèrent une crise sans précédent. Au moment du grand soulèvement de la classe ouvrière mené par Solidarność en 1980 et 1981, les difficultés économiques de l’économie polonaise avaient atteint un paroxysme. Ces difficultés furent largement accentuées par l’incapacité du nouveau gouvernement à briser la résistance acharnée de la classe ouvrière, malgré la défaite de Solidarność lors du coup d’État de décembre 1981.
Au cours de la décennie, il semble que certains éléments importants des cercles dirigeants en Pologne et en Hongrie prirent une décision capitale, jusqu’alors sans précédent : abandonnant tout espoir que les économies bureaucratiques puissent être réformées, ils décidèrent de tenter une réelle transition vers la propriété privée capitaliste. Leur objectif était une révolution vers le capitalisme par le haut, qu’ils pourraient contrôler et dont ils pourraient bénéficier. Cependant, au moins en Pologne, la bureaucratie ne pouvait pas mener une révolution purement par le haut, dans la mesure où la classe ouvrière avait toujours le pouvoir de bloquer toute transformation profonde, dans la mesure où les anciens dirigeants bureaucratiques du vieux cadre politique dictatorial étaient toujours au pouvoir. Pour sortir de cette impasse, le parti communiste de Pologne prit la décision historique et inattendue de renoncer à son monopole sur le gouvernement. En formant une coalition gouvernementale avec Solidarność après des élections semi-libres en 1989, il développa un programme dont l’objectif était d’établir immédiatement la propriété capitaliste – des perspectives qui étaient partagées par des fractions significatives à la fois de la direction du parti communiste et de la vielle direction de Solidarność.
La conséquence ironique du triomphe de Solidarność sur la bureaucratie, rendu possible par la volonté inébranlable de la classe ouvrière polonaise, fut alors une nouvelle ère de transition vers le capitalisme. En l’espace de quelques mois, la question, d’importance historique à l’échelle mondiale, de la fin de la domination communiste et de la restauration du capitalisme dans le bloc de l’Est avait été posée pour la première fois, soudainement et sans ambigüité. Cependant, ce fut l’approbation par Mikhaïl Gorbatchev de ces développements – et en particulier son refus d’intervenir militairement – qui en fin de compte ouvrit la voie aux révoltes titanesques en Europe de l’Est.
En espérant profiter des changements en Europe de l’Est pour affaiblir l’opposition conservatrice à son programme de réformes, Mikhaïl Gorbatchev a de toute évidence mal évalué la force du bouleversement qu’il déclenchait. En autorisant les citoyens polonais à défier l’hégémonie de la bureaucratie d’État, il précipitait des événements de la même nature ailleurs en Europe de l’Est, dans les États baltes, et en fait même en URSS.
Ce bouleversement s’est accéléré tout au long de l’année 1989. Après les Polonais, les Hongrois se sont rapidement disposés à organiser leurs propres élections. Mais le moment décisif fut peut-être la décision par le gouvernement hongrois, en ouvrant sa frontière avec l’Autriche, d’accepter que des citoyens est-allemands quittent l’Europe de l’Est. Si Gorbatchev ne l’avait pas explicitement approuvée, cette étape n’aurait pas pu avoir lieu.
Une fois que les Est-Allemands avaient pu accéder indirectement à l’Ouest, comment aurait-il été possible de les empêcher de s’y rendre directement ? Rapidement, des centaines de milliers d’Est-Allemands démolirent à la fois le mur de Berlin et leur propre bureaucratie. À l’origine les bureaucrates de la vieille Allemagne de l’Est (RDA) étaient clairement résolus à la répression. Or, à l’occasion d’un des tournants les plus spectaculaires de tout le processus révolutionnaire, alors que les forces internes de la RDA étaient sur le point de disperser les masses de Leipzig, Gorbatchev et les militaires d’Allemagne de l’Est indiquèrent clairement qu’ils ne reviendraient pas à l’ancien régime. En l’espace de quelques semaines, la domination du vieux PC sur la RDA s’était effondrée.
Un processus similaire eut lieu en Tchécoslovaquie, avec à la fois une grève générale de la classe ouvrière qui fit exploser le régime, et une déclaration du gouvernement Gorbatchev présentant comme une erreur l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 dans le cadre du pacte de Varsovie. Rapidement, le poète Vaclav Havel se trouva à la tête du gouvernement et Dubcek, héros de 1969 et martyr de l’invasion soviétique en 1968, fut réhabilité. Ce n’est qu’en Roumanie que le processus révolutionnaire, une fois déclenché, s’est étendu avec grande difficulté.
L’aspect le plus frappant des révolutions en Europe de l’Est est peut-être la facilité avec laquelle elles ont renversé l’ancien régime, une fois son principal soutien éliminé. Il est à présent évident que les bureaucraties ne se sont jamais profondément enracinées dans leurs sociétés, et que c’est presque uniquement par la force qu’elles se sont maintenues au pouvoir, notamment par des interventions armées périodiques de l’URSS. Une fois ce soutien externe éliminé, les régimes s’effondrèrent. Ainsi, à part en Roumanie, les révolutionnaires d’Europe de l’Est parvinrent à la victoire avec une vitesse époustouflante, sans précédent. La résistance de plus en plus intense, intransigeante et violente de l’ancienne couche dominante – un trait commun à presque toutes les grandes révolutions – n’eut absolument pas lieu. C’est le signe non seulement de la très faible légitimité politique de l’ancienne couche dominante mais aussi de sa profonde démoralisation.
Ce qui est extraordinaire est que de larges fractions des bureaucraties dominantes, en particulier en Hongrie et en Pologne mais peut-être aussi en URSS et ailleurs, avaient non seulement perdu confiance en leur système, mais avaient réellement décidé de tenter de rétablir le capitalisme. Cela est presque sans précédent : les révolutions d’en haut sont assez rares ; il est encore plus inhabituel que les dominants abandonnent leur domination avec des perspectives (relativement) incertaines quant à la future organisation.
Compte tenu du désarroi des anciennes élites dominantes, il ne fut pas nécessaire pour les masses d’Europe de l’Est de se mobiliser autant qu’elles le firent historiquement lors de grandes révolutions. Nous n’avons pas encore été témoins du processus révolutionnaire classique par lequel la radicalisation s’intensifie en réponse à la résistance à chaque étape du conflit – et au cours duquel les forces politiquement plus modérées et socialement plus privilégiées disparaissent successivement à chaque étape.
Des forces politiquement modérées et relativement privilégiées sont parvenues sans difficulté à conserver la direction des mouvements de masse tout au long de la première phase destructrice et anti-bureaucratique de la révolution. Il est par conséquent presque certain qu’elles parviennent à laisser leur empreinte sur la première étape constructive, en introduisant au moins le cadre formel, socio-juridique de l’établissement d’un système capitaliste de propriété privée. Leur objectif est un nouvel ordre dans lequel leur contribution sera plus correctement reconnue ; elles constituent les principaux partisans du marché capitaliste. Libérées de la soumission à l’ordre ancien et autorisées à vendre leur capital humain au plus offrant, elles espèrent récolter les fruits dont elles pensent avoir été injustement privées par l’ancienne bureaucratie. Elles se bercent de l’espoir que l’établissement de la propriété capitaliste inondera l’Europe de l’Est de capital occidental.
Restauration capitaliste ou sous-développement
Même si le nouvel équilibre du pouvoir à l’Est favorise à présent cette couche émergente d’intelligentsia professionnelle et technique, les conditions sont loin d’être réunies pour établir des économies capitalistes à mêmes de développer les forces productives et d’élever les niveaux de vie dans ces pays, au-delà de l’Allemagne et si possible de la Tchécoslovaquie. Les conditions sont encore moins favorables au développement combiné du capitalisme, de la démocratie et de la liberté dans cette région. L’introduction du capitalisme implique le démantèlement de la majeure partie de l’industrie existante, qui ne saurait faire face à la concurrence de marché à armes égales. Il devrait en résulter un chômage de masse, et un effondrement de la production qui rendra impossible le financement du filet de sécurité sociale. La mise en place d’entreprises capables d’affronter la concurrence se fera sans aucun doute au prix d’une main d’oeuvre très bon marché et donc d’une réduction significative des salaires.
Il est improbable que les classes ouvrières d’Europe de l’Est acceptent passivement les sacrifices considérables de ce qui sera sans doute une très longue « période d’ajustement ». Il est tout aussi improbable que les nouvelles cliques dirigeantes hésitent à adopter toutes les formes politiques requises pour imposer la « nécessaire » austérité. Walesa en parle déjà en Pologne. Il existe par conséquent des raisons de penser qu’à long terme, émergeront de nouvelles luttes massives de la classe ouvrière ; elles sont une condition nécessaire pour reconstruire une gauche et pour régénérer les idées du socialisme, à la fois dans cette région et à l’échelle mondiale.
À moins de révoltes massives de la classe ouvrière, les rapports capitalistes de propriété pourraient être entièrement rétablis au cours des prochaines années dans une grande partie de l’Europe de l’Est. Cela ne signifie pas que le processus sera facile. Après tout, même avec la meilleure volonté du monde, Margaret Thatcher a pu privatiser environ 10 à 15 % de l’économie britannique durant les années où elle fut au pouvoir ; l’objectif des Est-Européens est de l’ordre de 75 %.
De plus, les problèmes auxquels est confrontée l’Europe de l’Est sont, de toute évidence, bien plus importants, précisément parce qu’il n’existe pas encore de classe capitaliste ni de marché du capital pour mettre en œuvre le processus. Les unités devront être bradées ou cédées, mais à qui et à quel prix ? Comment connaître la valeur d’entreprises lorsqu’il n’existe aucun marché ? Quoi qu’il en soit, qui seront les capitalistes ? Les membres de l’ancienne classe bureaucratique n’étaient pas des entrepreneurs, si bien qu’ils n’étaient pas vraiment préparés à prendre en main un développement dynamique des forces productives. Même les dirigeants des anciennes usines – habituées à fonctionner dans un système articulé autour de la politique plutôt que de la concurrence – sont mal préparés à assumer certains rôles comme la prise de risque, l’avance de capital, l’innovation technique. Des ventes importantes au capital étranger seront politiquement dangereuses pour tout gouvernement, qu’il les désire ou non. Mais si les entreprises sont simplement remises aux anciens dirigeants ou même aux travailleurs qui les dirigent aujourd’hui (hautement improbable), comment les autres citoyens, qui ne sont pas dirigeants ni travailleurs dans une entreprise donnée, doivent-ils être compensés ?
La privatisation s’accompagnera alors de conflits. Aussi, à moins que la classe ouvrière réintègre de force le devant de la scène, ces conflits auront lieu entre une multitude d’intérêts particuliers luttant pour une part du gâteau. Néanmoins, pour le moment – pas forcément pour longtemps – il semble qu’un large consensus se dégage à travers la société, y compris dans la classe ouvrière, pour briser l’ancien système et passer au marché.
C’est en Allemagne de l’Est que la privatisation sera la moins difficile, dans la mesure où le capital ouest-allemand prendra le contrôle d’unités potentiellement concurrentielles, alors que les autres – la grande majorité – sont condamnées à une mort rapide et douloureuse. La Yougoslavie est allée loin en ce sens, en suivant sa propre voie. La Pologne et la Hongrie sont également bien engagées. Toutes ces nations ont introduit les modifications structurelles suivantes, ou sont en train de le faire : rendre leurs monnaies convertibles, libéraliser les échanges avec l’Ouest, établir un marché pour le capital, lever le contrôle sur les prix et faire en sorte qu’ils soient déterminés par le marché, éliminer les subventions gouvernementales aux entreprises inefficaces et – la principale difficulté – privatiser les moyens de production détenus par l’État.
La Tchécoslovaquie n’est pas encore allée très loin dans cette voie mais en principe le gouvernement s’est résolu à rétablir le capitalisme. Nous constaterons que l’URSS en particulier représente une situation très différente.
Néanmoins, s’il est une chose de transformer un système bureaucratique de rapports sociaux en un système capitaliste de rapports sociaux, il en est une autre de rendre le fonctionnement du capitalisme réellement efficace. À l’exception de l’Allemagne de l’Est – qui a été absorbée par l’économie ouest-allemande – et peut-être de la Tchécoslovaquie – dont l’histoire économique est plus proche de l’Europe de l’Ouest que de l’Europe de l’Est –, une dislocation massive n’est pas à même de produire la précieuse croissance économique, sans parler de l’amélioration des niveaux de vie.
Le développement économique est-européen sera entravé par une productivité extrêmement faible. Même le pays le productif d’Europe de l’Est – l’Allemagne de l’Est – enregistre un niveau de productivité inférieur de plus de la moitié à ceux des pays de l’Ouest avancé ; celui des pays est-européens les moins productifs – Pologne, Hongrie et URSS – atteint rarement plus d’un tiers du niveau occidental.
C’est dans les industries les plus modernes que la situation est la pire. Par exemple, au printemps dernier, le groupe électronique le plus important d’Allemagne de l’Est – Robotron – présentait un nouvel ordinateur personnel AT à la foire de Leipzig, au prix de 37 000 marks est-allemands. Un ordinateur similaire à l’Ouest ne coûte que 2 000 marks ouest-allemands. C’est en raison de disparités comme celles-ci – et de ce qu’elles impliquent – que les niveaux de vie des pays d’Europe de l’Est, même pour ses régions les plus prospères, représentent au mieux la moitié de ceux de l’Ouest avancé. Pour le reste de la région ce rapport atteint un tiers voire moins.
La résolution de ce problème de productivité pose un dilemme à l’Europe de l’Est. Alors qu’il lui est nécessaire de profiter de la division mondiale du travail pour acquérir les équipements et les techniques occidentales lui permettant d’augmenter sa production par facteur de production, la faible productivité de la région rend difficile l’exportation, ce qui en retour pénalise l’importation. En monnaie forte, la totalité des exportations combinées de la région, qui comprend 136 millions de personnes (sans compter l’URSS), correspondaient à un tiers de celles de Hong-Kong, à 4/5 de celles de la Corée et à l’équivalent de celles de Taïwan.
Le caractère massif des dettes en Europe de l’Est – qui explique la réticence de l’Ouest à prêter aux États est-européens le capital dont ils ont besoin pour les importations occidentales – aggrave encore le problème. La dette extérieure de la Pologne s’élève actuellement à 40 milliards de dollars, celle de la Hongrie à environ 20 milliards, celle de la Yougoslavie est de l’ordre de 17 milliards.
Une immense proportion des gains de ces pays à l’exportation est absorbée par les paiements de la dette, de telle sorte qu’il reste bien peu de capital pour importer des équipements. Par exemple, la dette polonaise équivaut à 470 % de ses exportations annuelles. Ces nations auront bien du mal à convaincre les banques occidentales de leur fournir des avances supplémentaires, en particulier à lumière de l’expérience récente de non-paiement en Amérique latine.
Qu’en est-il de l’investissement direct à l’étranger ? Nous revenons ici au dilemme fondamental : cette région est dépourvue d’avantage comparatif à un tel point qu’on peut se demander comment, en investissant ici, on peut espérer vendre sur le marché mondial.
Pour un producteur occidental résolu à exporter sur le marché mondial, les immobilisations corporelles sont globalement de très faible valeur. Les transports sont sous-développés et la communication est très arriérée. L’infrastructure dans son ensemble est en mauvais état. La force de travail semble qualifiée mais c’est largement illusoire ; elle a été formée pour travailler sur des immobilisations corporelles obsolètes depuis plusieurs décennies, si bien que les qualifications qu’elle possède sont aussi largement obsolètes. Une reconversion massive sera nécessaire.
Dans ce contexte, les perspectives est-européennes d’un développement impulsé par le marché laissent sceptique. Il est vrai que la soumission de toutes les unités d’une économie nationale à la concurrence – c’est ce qui se passe aujourd’hui en Pologne et se passera bientôt en Hongrie – précipitera une certaine effervescence favorable à une allocation plus efficace. Les entreprises ne parvenant pas à fournir les biens demandés sur le marché feront faillite ou seront forcées à se réorienter ; ainsi la discipline de marché tendra quelque peu à limiter les vieilles tendances lourdes à l’alternance entre périodes de surabondance et périodes de pénurie. Cependant la question centrale – celle qui déterminera l’investissement – se posera toujours. Une production profitable pour l’exportation n’est pas à l’ordre du jour.
Par conséquent les partisans les plus lucides et les plus intransigeants du libre marché misent tout sur une réduction drastique des coûts du travail en Europe de l’Est. Telle est la signification réelle de la dérégulation, de la privatisation et de la marchandisation. Sur le conseil de Jeffrey Sachs, un économiste d’Harvard déjà bien connu en Amérique latine pour avoir supervisé l’effondrement du niveau de vie déjà faible des Boliviens, le gouvernement polonais a adopté du jour au lendemain un plan de transition vers le capitalisme. Ce plan implique la fin des subventions à l’industrie d’État et la disparition du filet de sécurité, ce qui a provoqué une hausse considérable du chômage et, par conséquent, une diminution intentionnelle des salaires de 20 %.
Il est pourtant difficile d’imaginer comment ce programme néoclassique brutal peut créer autre chose qu’une dépression. Certes la dépression devrait contribuer à la réduction de l’inflation et à la chute des salaires. Herbert Hoover a démontré que les dépressions peuvent effectivement réaliser ces objectifs, mais pourquoi la dépression devrait-elle conduire au développement ?
Il semble que, dans leur engagement dogmatique en faveur des mécanismes d’« ajustement automatique » du marché, les partisans du libre marché négligent deux choses.
- Baisse de la demande/intensification de la concurrence. Le revers d’une diminution radicale de l’emploi et des niveaux de vie est l’effondrement de la demande. Comment des proto-capitalistes peuvent-ils être incités à investir lorsque le marché local s’effondre ? Pire encore, l’adoption du libre-échange par la Pologne inondera le marché de biens importés. La raison pour laquelle des producteurs occidentaux, et non pas des marchands de produits importés, devraient penser que l’intensification de la concurrence dans un marché en contraction est attractive pour les fonds d’investissement reste un mystère.
- L’avantage comparatif ne résulte pas de facteurs bon marché. Il doit être construit. Même si la Pologne et les autres pays d’Europe de l’Est qui envisagent à présent des programmes de « stabilisation » du type de ceux du Fonds monétaire international parviennent réellement à réduire les salaires – avec un grand si –, la faiblesse des salaires n’est pas en soi porteur de développement.
Il est vrai que dans chaque cas de développement réussi dans le Tiers-monde, les salaires étaient faibles. Mais si tout ce que nécessitait le développement était le travail bon marché et l’absence de l’intervention de l’État, le Tiers-monde serait aujourd’hui plein d’utopies capitalistes avancées et non de cauchemars économiques capitalistes. Très peu de pays du Tiers-monde sont parvenus à prendre la voie capitaliste vers le développement, et la plupart de ceux qui ont réussi l’ont fait en utilisant des méthodes opposées à celles du FMI.
Reste que le développement de la Corée et de Taïwan a été organisé grâce à une coordination économique et politique très importante, tout autant que grâce à la concurrence. L’État a encouragé de gigantesques conglomérats, qui contrôlaient une large gamme de capacités industrielles, ce qui a impliqué la fusion de la finance et de la production. L’État est d’abord intervenu directement pour protéger ces industries de la concurrence internationale et pour leur verser des subventions. De plus, il réprimait et contrôlait la classe ouvrière dans ces usines, sur le marché du travail et eu égard à son rôle dans le gouvernement.
Par conséquent, les populations de l’Europe de l’Est reconstruite, excitées par la révolution et généralement hostiles à l’étatisme, sont des candidats à l’exploitation capitaliste moins attirants qu’on ne pourrait l’imaginer. L’anti-étatisme des nouveaux régimes tendra à les empêcher de créer l’ensemble complexe d’institutions, portées par le gouvernement, qui sont aujourd’hui nécessaires au développement. Aussi, au moins au début, il leur manquera les appareils autoritaires répressifs qui ont été nécessaires pour assurer stabilité et profits dans la plus grande partie du monde développé.
Par conséquent, le scénario le plus probable est que l’Europe de l’Est connaisse un destin proche de celui que le capitalisme inflige à une grande partie du Tiers-monde, et non pas qu’elle bénéficie des conditions capitalistes de dizaines de millions de citoyens de Scandinavie et d’Europe du nord.
Les perspectives politiques de la région peuvent ainsi être établies assez clairement. Ses nouveaux groupes dominants n’ont pas vraiment d’autre choix que d’imposer une violente austérité comme unique voie possible vers un développement pourtant incertain. Tout dépendra de l’équilibre émergent des forces de classe, et plus particulièrement de la combativité de la classe ouvrière.
Dans la mesure où des solutions collectives organisées sur une base de classe ne parviennent pas à émerger, il ne serait pas surprenant d’observer une évolution vers d’autres solutions, reposant sur des fondements très différents – « liens primordiaux » de nationalité, d’ethnicité et de religion, qui seraient moins dirigés contre des opposants de classe nationaux trop puissants que contre des « ennemis extérieurs » comme les Juifs. C’est sur ce terrain que prospèrent des politiques autoritaires, comme l’a très bien démontré Lech Walesa en particulier.
La question fondamentale est donc : qu’en est-il de la classe ouvrière ? Les travailleurs polonais ont déjà déclenché une série de grèves de plus en plus importantes contre le programme d’austérité du gouvernement, qui a sabré les salaires de 20 à 25 % et a engendré un taux de chômage de 52 %.
Jusqu’à présent la grève la plus significative a été celle des chemins de fer, qui en mai dernier a menacé de paralyser le pays. Depuis, ont eu lieu d’importantes protestations d’agriculteurs, des grèves de mineurs et, plus récemment, une grève des travailleurs du transport public de Varsovie. Toutefois le problème auquel sont déjà largement – si ce n’est encore que de manière implicite – confrontés ces travailleurs exige la formulation d’une alternative crédible au capitalisme.
Ils savent bien que le « socialisme » a été entièrement discrédité. Alors qu’il est arrivé qu’une fraction significative de ce qui est devenu la direction de Solidarność se présente comme des socialistes démocrates révolutionnaires, cette perspective a depuis longtemps été abandonnée en faveur d’un engagement pour la social-démocratie sur le mode scandinave. Alors que cette direction se console avec cet objectif ridiculement utopique, elle est occupée à superviser un programme de « stabilisation » du type de ceux proposés par Milton Friedman, qui rappelle plus le Chili de Pinochet que la Suède de Palme.
Il est possible que très rapidement les travailleurs soient de nouveau confrontés à la perspective de choisir entre la réinvention de l’idéal socialiste qui, à toutes fins pratiques, a été anéanti dans cette région, et, alternativement, la confrontation au type de régime politico-économique que les travailleurs du Tiers-monde ont longtemps dû supporter.
La trajectoire spécifique de l’URSS
Il est ironique de constater que le processus révolutionnaire en Europe de l’Est est aujourd’hui en passe de déterminer le cours des événements en URSS même. Gorbatchev a permis l’auto-détermination des nations et la fin de la règle bureaucratique du parti unique en Europe de l’Est. Faut-il s’étonner que l’apparition de telles revendications en URSS mette très largement en cause la pérennité du régime de Gorbatchev ?
Rétrospectivement, il est clair que la mise en œuvre par Gorbatchev d’un processus radical de réforme en URSS fut très « tardive ». La crise intérieure – identifiée comme « stagnation » par les réformateurs – s’était développée au moins aussi tôt en URSS qu’en Europe de l’Est et elle était devenue au moins aussi aigüe.
L’élite d’URSS a cependant pris au moins une décennie de plus que ses homologues est-européens à engager un processus de réforme radicale. Cela reflète des différences implicites majeures en termes de structure sociale et d’évolution historique entre la société soviétique et les sociétés du reste du bloc de l’Est – des différences qui continuent à jouer un rôle aujourd’hui.
De toute évidence, la bureaucratie soviétique – qui est le produit de la révolution et de la contre-révolution intérieures, et pas d’une intervention extérieure par le haut – est bien plus solidement enracinée que ses homologues est-européens. De manière moins évidente, mais peut-être tout aussi significative, la classe ouvrière d’URSS, qui est dépourvue de l’histoire militante qui a fait suite à la Deuxième guerre mondiale, y compris des luttes révolutionnaires qui ont caractérisé ses homologues est-européens, n’a pas non plus connu, pour cette raison, leur histoire de défaites ni, dans le cas décisif de la Pologne, de démoralisation.
C’est la résistance combinée, souvent secrète, de fractions de la bureaucratie et de la classe ouvrière – deux forces qui, malgré leur antagonisme mutuel, partagent une même opposition au capitalisme – qui a dans une large mesure constitué un obstacle insurmontable à la reconquête de Gorbatchev par le haut.
Le programme de Gorbatchev – que l’on peut résumer par les concepts maintenant bien connus de glasnost et de perestroïka – visait à créer une alliance avec l’élite technique et culturelle ainsi qu’avec des fractions qualifiées de la classe ouvrière. Il espérait obtenir le soutien de ces couches pour la perestroïka – une réforme économique impliquant la décentralisation et la marchandisation de l’économie – en leur offrant la glasnost – une plus grande liberté culturelle et politique et une participation au gouvernement potentiellement plus importante.
Cependant, alors que la glasnost a été en partie mise en œuvre, la perestroïka a totalement calé. En outre, compte tenu de l’échec de la perestroïka, les processus de réforme politique déclenchés par la glasnost ont rapidement affaibli le pouvoir de Gorbatchev. Aujourd’hui le résultat est une plus grande paralysie économique et une désintégration politique, une impasse trans-sociétale et l’accélération d’une crise des plus graves.
Réforme politique
Alors que la glasnost a transformé l’environnement politique en URSS en accordant à Gorbatchev et à ses partisans à la fois un certain soutien à court terme et un espace de respiration, elle a également créé les conditions pour qu’un certain nombre de défis majeurs soient posés à l’autorité de Gorbatchev.
Aujourd’hui en URSS, on peut discuter de presque tout. On peut organiser des manifestations de masse. La reconnaissance officielle du droit d’élire des candidats et de constituer des partis autonomes n’a pas encore apporté la démocratie, mais elle a certainement légitimé la lutte pour la démocratisation de la société.
Il n’en reste pas moins que le parti parvient toujours à contrôler les institutions politiques nationales. Les ressources économiques pour l’organisation politique sont toujours distribuées de manière extrêmement inégale. L’accès à la presse est toujours réservé au gouvernement et à l’opposition loyale. La police secrète est toujours présente. Pourtant le nouveau climat a permis un changement considérable, peut-être au détriment de Gorbatchev en définitive.
Surtout, les nationalités opprimées se sont servies de la reconnaissance implicite de l’autodétermination en Europe de l’Est pour déclencher des luttes pour l’indépendance dans les républiques autonomes les unes après les autres. Ces exigences croissantes d’indépendance posent une menace immédiate à l’intégrité de l’URSS.
La glasnost a également ouvert la voie à l’accès au pouvoir par les élections, dans des grandes villes comme Leningrad, de forces très favorables au marché qui affirment leur indépendance à l’égard du Parti communiste et leur désir de rompre avec l’URSS. En quelque sorte ces forces soutiennent les mesures de Gorbatchev en faveur du marché et du capitalisme, mais il est possible que leur effet plus immédiat soit d’affaiblir encore son contrôle politique, déjà miné par la désintégration du Parti communiste.
L’objectif de Gorbatchev a été de s’emparer totalement du parti, de le réformer et de l’utiliser comme un instrument de sa politique. Cependant, l’utilisation de la glasnost pour assurer son contrôle sur le parti est contradictoire avec l’essence même de ce parti, la rendant ainsi inefficace pour assurer les objectifs de Gorbatchev.
Le parti était l’instrument qu’utilisait la bureaucratie pour s’organiser afin de dominer la société ; il ne pouvait servir cet objectif que tant que les fractions politiques internes à la bureaucratie souhaitaient régler leurs disputes dans les limites du parti.
Or, la glasnost de Gorbatchev détruit partiellement le parti en tant qu’instrument efficace de la domination bureaucratique, le déstabilisant ainsi comme source de son pouvoir et de son autorité. C’est en s’appuyant sur des pressions massives venues de l’extérieur du parti, dans la société en général, que Gorbatchev réussit à écarter une bonne partie de la « vieille garde », dans la mesure où les bureaucrates opposés à la réforme conservent des positions de pouvoir dans le parti. Ce qui reste du parti ne peut plus servir de représentant de la bureaucratie contre la société, sans parler de la coordination de la bureaucratie dans son ensemble ou de la résistance aux tendances centrifuges de plus en plus intenses auxquelles il est confronté.
Alors que Gorbatchev s’affaire à détruire la fonction du parti comme organisateur de l’ensemble de la bureaucratie – en tant que médiateur de ses fractions et de ses intérêts face à la société – il se place de plus en plus dans l’obligation d’organiser son propre parti contre de nombreux autres. La scission d’Eltsine fut la première – et assez spectaculaire – expression de cette situation émergente.
Gorbatchev sera rapidement confronté à l’organisation politique de forces bien plus nombreuses que celles qui pour s’exprimer devaient auparavant passer par le parti et son dirigeant. Il ne s’agit pas que des vieux conservateurs du parti qui ne veulent pas risquer une transition vers le capitalisme. Elles incluront également une organisation potentiellement subversive comme le populiste et antisémite Pamyat, qui maintenant est déjà un parti de masse significatif en URSS. Jusqu’alors les forces représentées dans Pamyat étaient contraintes, comme la majorité, de faire des tractations au sein du parti. Mais la glasnost a fait en sorte que lorsque le programme de réformes économiques – tout comme l’ensemble de l’économie – fera faillite, la scène politique sera prête pour faciliter un immense bouleversement.
Réforme économique
En ce qui concerne l’économie, Gorbatchev a eu deux options majeures : soit décentralisation progressive et marchandisation, avec le capitalisme pour conséquence possible, soit, à l’inverse, transition immédiate au capitalisme, comme la tentative polonaise. Chacune de ces options pose des problèmes quasiment insurmontables, le premier étant d’abord économique, le second étant fondamentalement politique.
Depuis 1987-1988, Gorbatchev a mis en œuvre une politique de réforme assez peu innovante, accordant plus d’autonomie aux entreprises individuelles dans leurs décisions d’investissement. Or, cette politique – comme les politiques similaires qui ont été tentées en Hongrie, en Pologne et, de la façon la plus extrême, en Chine – souffre de la même contradiction centrale que ces premiers efforts.
L’assouplissement par la bureaucratie du contrôle réduit les capacités – déjà limitées – de l’économie à coordonner les activités de ses multiples entreprises et à assurer l’égalité entre offre et demande. En outre, l’introduction du marché – là où, comme dans le présent cas soviétique, les entreprises ne sont pas libres de vivre et de mourir par le marché, en s’appropriant leur profit et/ou en faisant faillite – ne parvient pas à créer des incitations pour améliorer ou pour développer une méthode adéquate d’harmonisation de l’offre et de la demande.
Avec une marchandisation et une décentralisation uniquement partielles, comme en Europe de l’Est, la réforme finit par transformer la stagnation en crise. C’est ce qui se passe aujourd’hui en URSS à un rythme accéléré.
L’alternative à ces réformes progressives est une transition au capitalisme en une seule fois. Si elle est mise en œuvre avec « succès », l’URSS rencontrera des problèmes de développement similaires à ceux auxquels la Pologne est à présent confrontée. Toutefois l’opposition politique à une telle évolution est bien plus forte en URSS qu’en Pologne.
Elle est en partie le fait de bureaucrates bien établis qui, en cas de transition vers la production capitaliste, verraient leurs positions compromises et leurs avenirs très incertains. Mais elle vient, de manière bien plus décisive, des travailleurs qui, à tout le moins, s’opposent aux baisses de salaires, à la détérioration de la sécurité sociale et à la hausse du chômage que provoquera le marché.
La crise actuelle
Maintenant, les conseillers de Gorbatchev qualifient la situation actuelle de « catastrophique ». Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. La réforme économique progressive a déjà échoué, le gouvernement n’a pas le pouvoir d’imposer une transition rapide au capitalisme, et les diverses forces d’opposition menacent de renverser le gouvernement. Gorbatchev et ses partisans semblent croire qu’ils n’ont qu’une issue – se procurer une aide occidentale massive afin de museler la classe ouvrière jusqu’à ce que le mouvement vers l’établissement complet du capitalisme soit en bonne voie.
Or, compte tenu de la condition financière des pouvoirs occidentaux – en particulier des États-Unis – et des demandes de fonds déjà massives de la part des pays d’Europe de l’Est telles que l’Allemagne de l’Est – qui a déjà fait appel aux ressources d’Allemagne de l’Ouest – c’est une option au mieux limitée. Il est prévu, par exemple, que l’Allemagne de l’Ouest propose environ 50 milliards pour le développement de l’Allemagne de l’Est. L’URSS est environ vingt fois plus importante que l’Allemagne de l’Est, et son économie n’est pas aussi développée, si bien que la somme requise pourrait approcher mille milliards de dollars.
Alors qu’il serait absurde de prévoir avec certitude les prochains événements, on peut envisager trois scénarios probables. L’un mène à la désintégration sous l’impact de révoltes nationales et d’une résistance de droite, antisémite, autoritaire-populiste. Le deuxième mène à une répression par les autorités, peut-être financée par l’armée et le KGB. La dernière alternative – qui n’est pour le moment qu’une faible lumière à l’horizon – implique la résistance de la classe ouvrière et la révolution socialiste.
Traduit de l’anglais par Fabien Tarrit. Originellement paru dans Against the Current Mars/avril 1991.