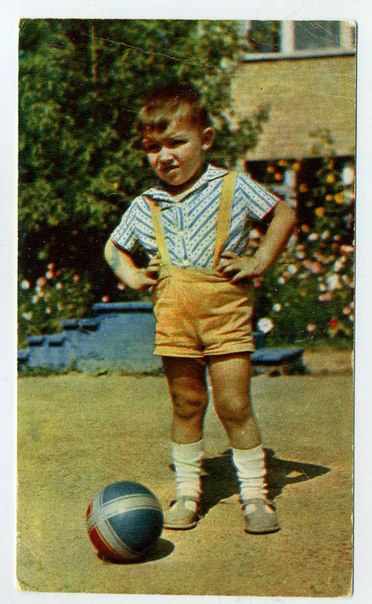Contribution à la théorie du marché mondial
Si le marxisme connaît actuellement un renouvellement considérable à travers la géographie, et a gagné en audience à travers les travaux de David Harvey, Isaak Dachkowski est un précurseur majeur de ce mouvement. Le texte suivant a en effet paru en français en 1929 dans La Revue marxiste. Il expose de façon extrêmement précoce les intuitions fondamentales du marxisme géographique : le rôle de la forme marchandise dans la production d’un espace lisse et homogène, mais aussi dans la différenciation des territoires, la division internationale du travail, et la prolétarisation brutale des sociétés non occidentales au contact du capitalisme. Malgré ses accents vieillis, par sa lecture créative de Marx et Engels, ce texte dégage une fraîcheur insoupçonnée et une ressource pour penser la nouvelle phase de mondialisation capitaliste.