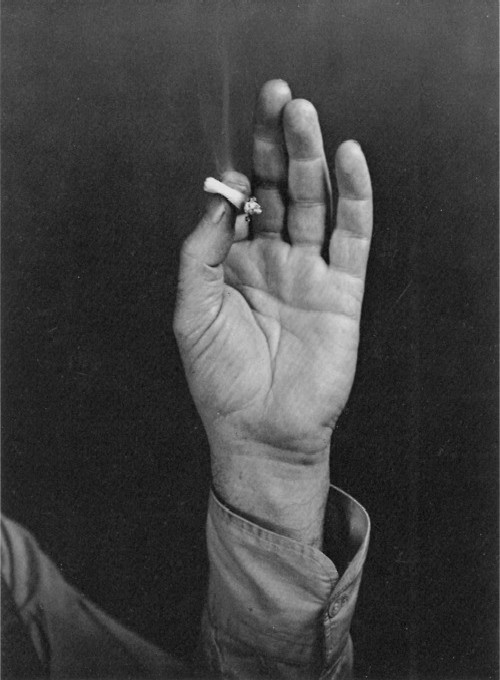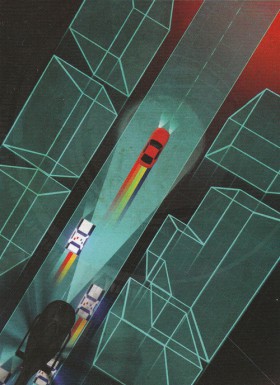L’hégémonie de la race : de Gramsci à Lacan. Entretien avec Richard Seymour
Même dans ses interprétations les plus sophistiquées, le marxisme a une fâcheuse tendance à lire le racisme de façon instrumentale. Telle idéologie est adoptée par une série d’acteurs parce qu’elle est conforme à certains intérêts, parce qu’elle consolide une forme ou une autre d’hégémonie, parce qu’elle entretient des privilèges blancs. Pour le journaliste et chercheur indépendant Richard Seymour, ces explications sont insuffisantes. Issu d’un parcours militant au sein de la gauche révolutionnaire, Seymour montre dans cet entretien combien il est fâcheux pour les marxistes de rationaliser à outrance les comportements parfois les plus irrationnels, tels que les lynchages, les formes de violence de masse racistes. Pour faire face à ce défi théorique, il convoque Poulantzas, Stuart Hall et même Lacan. Au-delà de ces préoccupations, Seymour nous propose ici une véritable leçon de rectification, d’autocritique, pour être à la hauteur de la contre-révolution préventive des classes dominantes.