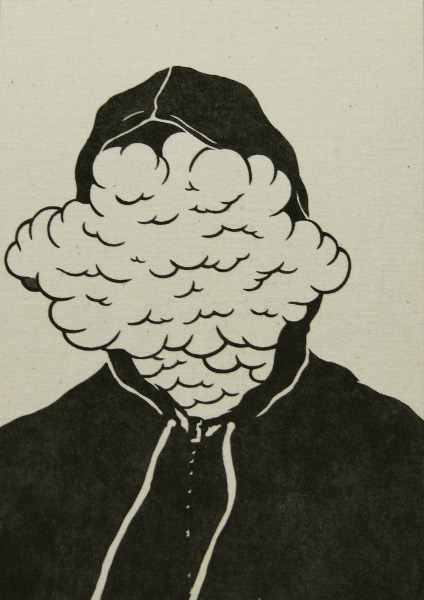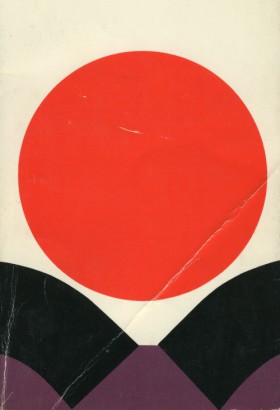De l’aliénation ou les vicissitudes de la jouissance
La catégorie d’aliénation est souvent tenue pour allant de soi chez Marx. Pourtant, comme le montre Nicole-Édith Thévenin dans ce texte, même le jeune Marx propose un concept d’aliénation largement ambivalent. Dans la continuité d’Althusser, Thévenin propose une relecture critique du concept, qui divise sa portée entre une acception dominante, perméable au réformisme, et une conception révolutionnaire. S’appuyant sur Lacan et la critique marxiste du droit, elle montre que l’aliénation n’appelle pas, pour les sujets, à une reconquête des produits de leur travail, mais à briser les rapports marchands et juridiques qui les chevillent à la jouissance capitaliste.