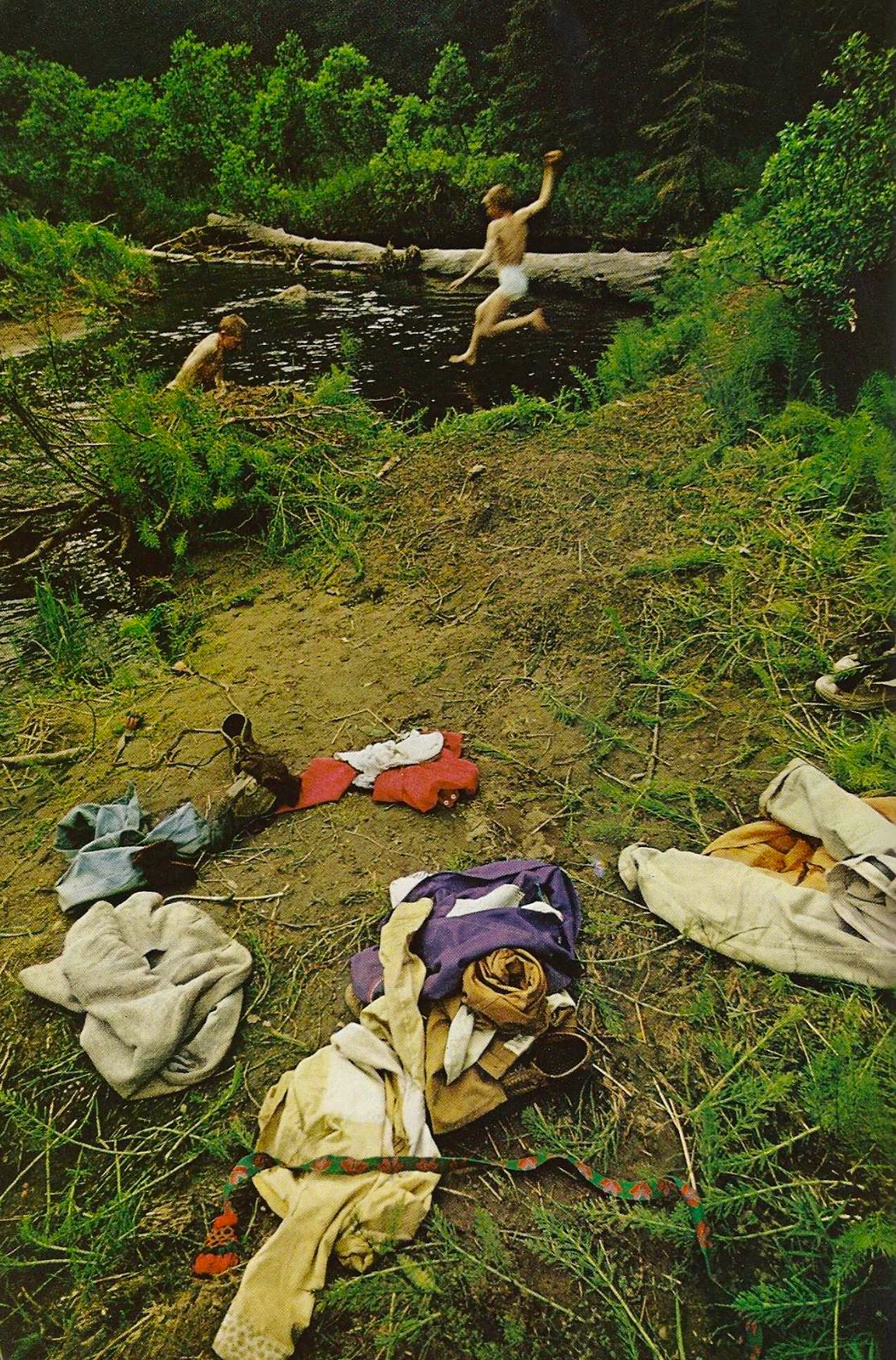Capital fossile : vers une autre histoire du changement climatique
Que peut dire le marxisme du réchauffement climatique ? Alors que se succèdent les conférences internationales sur le climat dans une plus ou moins grande indifférence et que le réchauffement climatique figure rarement dans l’agenda du mouvement ouvrier, l’apport théorique d’Andreas Malm est décisif. Ce dernier propose en effet une théorie du capital fossile, introduisant le facteur fossile dans l’équation de la production de plus-value, en prenant l’exemple contemporain de la Chine. Ce faisant, il opère trois déplacements majeurs. Il montre que c’est bien le capitalisme, et non pas l’humanité, qui est à l’origine du réchauffement climatique, contre le récit de l’anthropocène. Il défait l’argument qui consiste à blâmer l’appétit des pays émergents, pour au contraire replacer l’augmentation massive d’émissions au sein de ces pays, et plus particulièrement de la Chine, dans un contexte général, celui de la mondialisation. Enfin, il propose de faire droit à la composition fossile du capital, permettant ainsi non seulement de mieux comprendre les raisons du réchauffement climatique mais également de proposer des hypothèses stratégiques majeures pour le mouvement ouvrier, face au péril qui monte.
Andreas Malm montre également combien l’indifférence au réchauffement climatique doit mener à repenser la catégorie d’idéologie, à l’aide de Gramsci et d’Althusser.