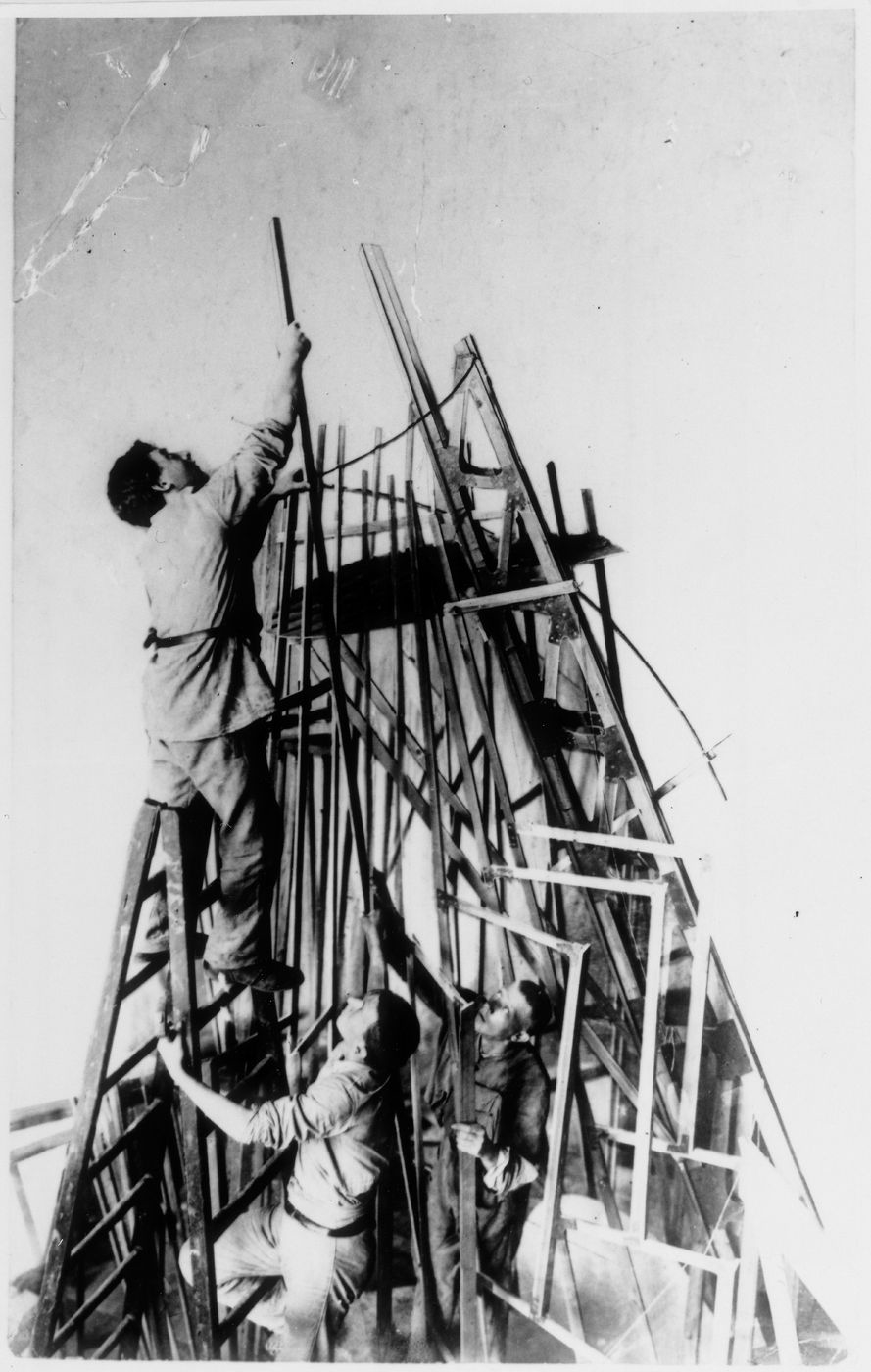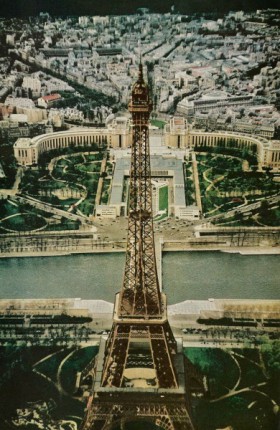Arvatov, l’art pour transformer la vie quotidienne. Entretien avec John Roberts et Alexei Penzin
Si le succès de l’avant garde soviétique est notable dans la tradition culturelle occidentale, il faut compter un grand nombre de figures oubliées des courants constructivistes ou productivistes. Arvatov et son livre Art et production en est un exemple patent. Dans cet entretien avec Sophie Coudray, Alexei Penzin et John Roberts montrent la valeur et la place décisive d’Arvatov dans l’élaboration du projet productiviste en Russie soviétique : l’ambition d’une transformation totale de la vie quotidienne. Largement inspiré du proletkult, Arvatov considérait la séparation de l’art avec la pratique sociale comme une aliénation du capitalisme. Lui et ses camarades cherchaient à expérimenter des formes esthétiques dans les usines, non sans difficultés, à se tourner vers le design, ou encore des missions plus éducatives. Penzin et Roberts dessinent un tableau renversant des contributions soviétiques les plus méconnues, et font valoir à de nouveaux frais l’actualité de 1917, y compris pour le monde de l’art.