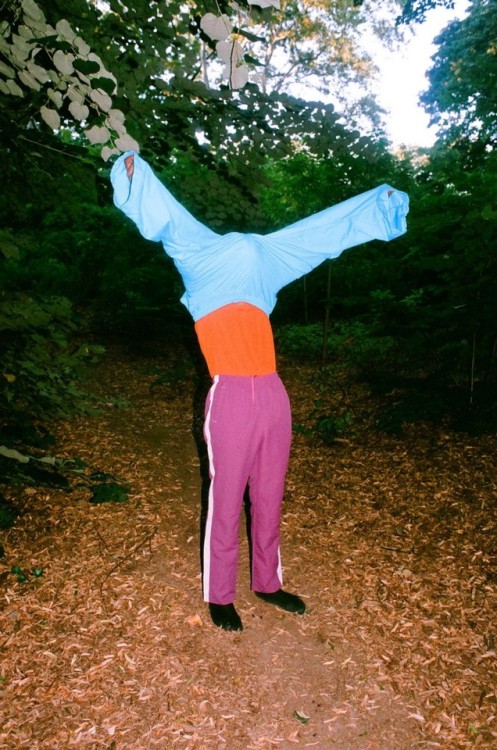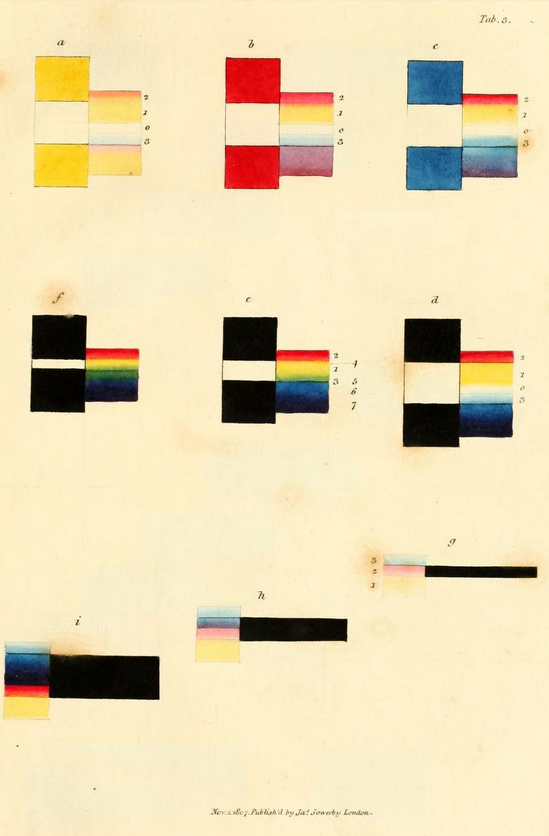Marx et l’Amérique latine
Les bévues d’un auteur en disent parfois plus long que ses vues explicites. On sait ainsi que traitement réservé par Marx à l’Amérique latine fut pour le moins partiel. Le continent sud-américain n’apparaît dans ses textes que comme une frontière du monde européen et son incompréhension des mouvements populaires qui s’y déroulèrent au XIXe siècle n’a d’égal que le mépris que lui inspire la figure de Simón Bolívar. Faut-il alors interpréter ces bévues comme le signe d’une incapacité du matérialisme historique a traiter des sociétés extra-européennes, voire comme la preuve irréfutable de l’eurocentrisme marxien ? Pour José Aricó, ces interprétations courantes passent à côté de l’essentiel : le primat de la politique sur la théorie. C’est en effet la volonté de tracer une ligne de démarcation entre les mouvements qui favorisent, et ceux qui freinent l’émancipation, qui s’exprime jusque dans les préjugés dont Marx fait preuve à l’égard de l’Amérique latine. Prendre l’histoire à rebrousse poil, identifier les tendances qui peuvent en rompre la continuité et l’ouvrir sur l’avenir: voilà la seule méthode dont peut se prévaloir une politique matérialiste.