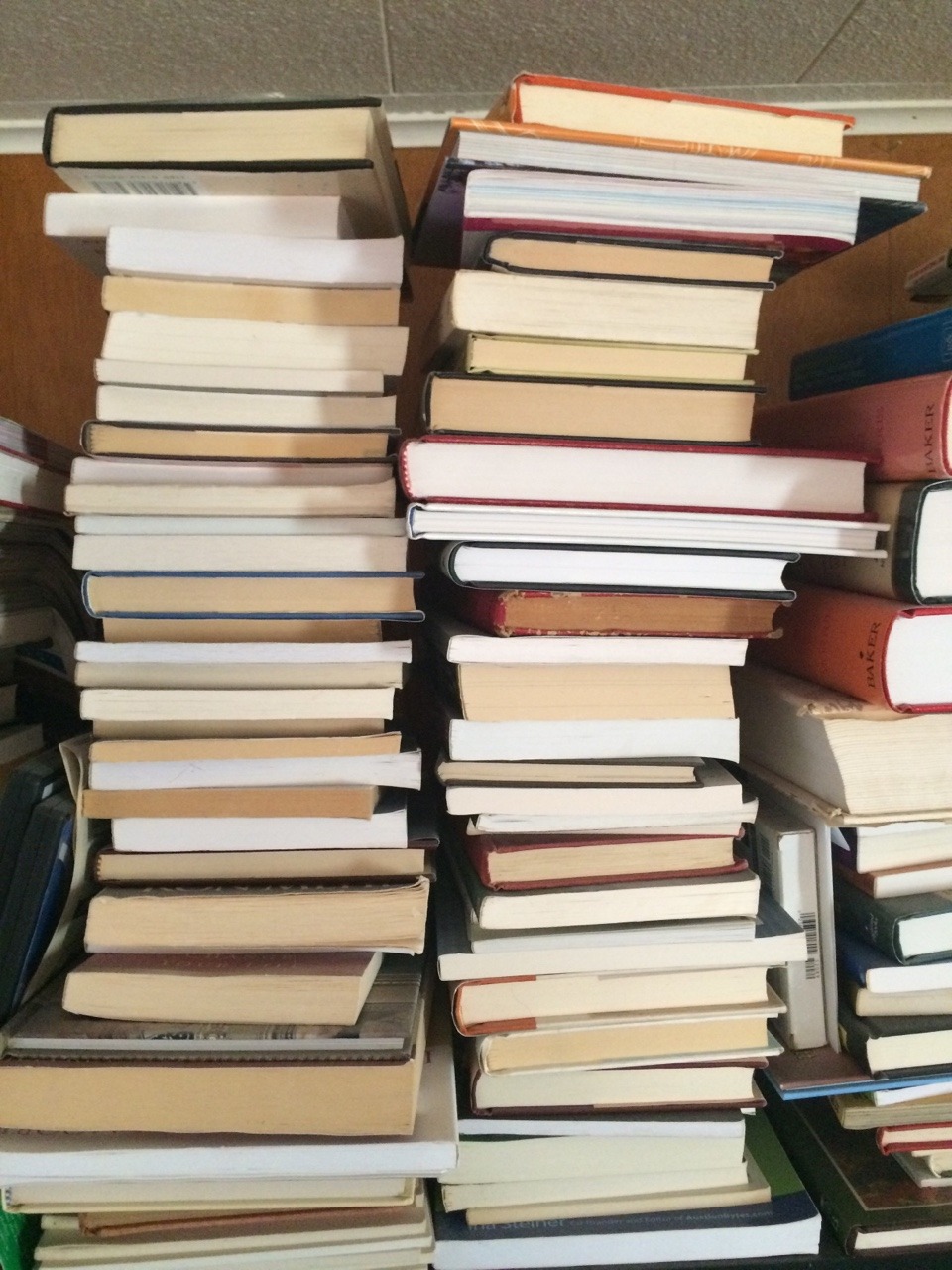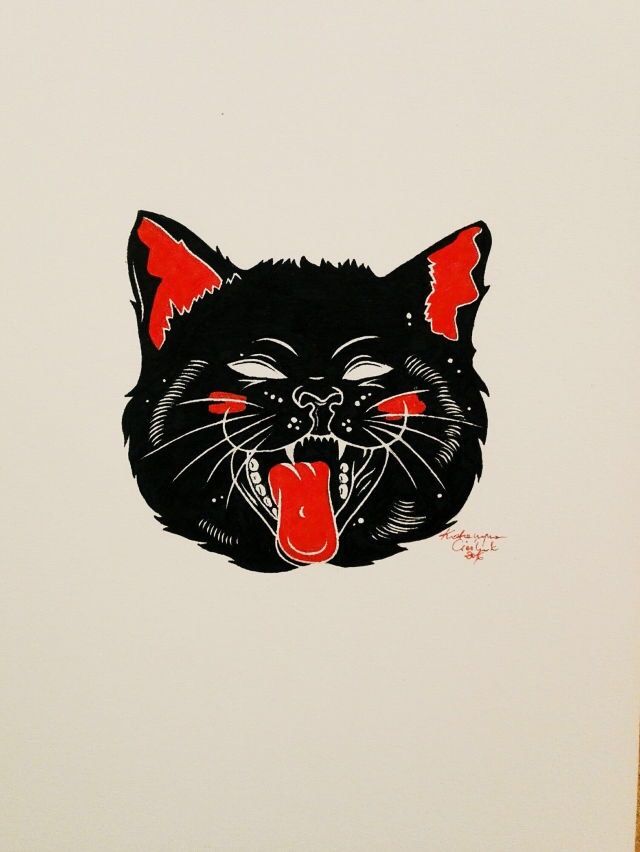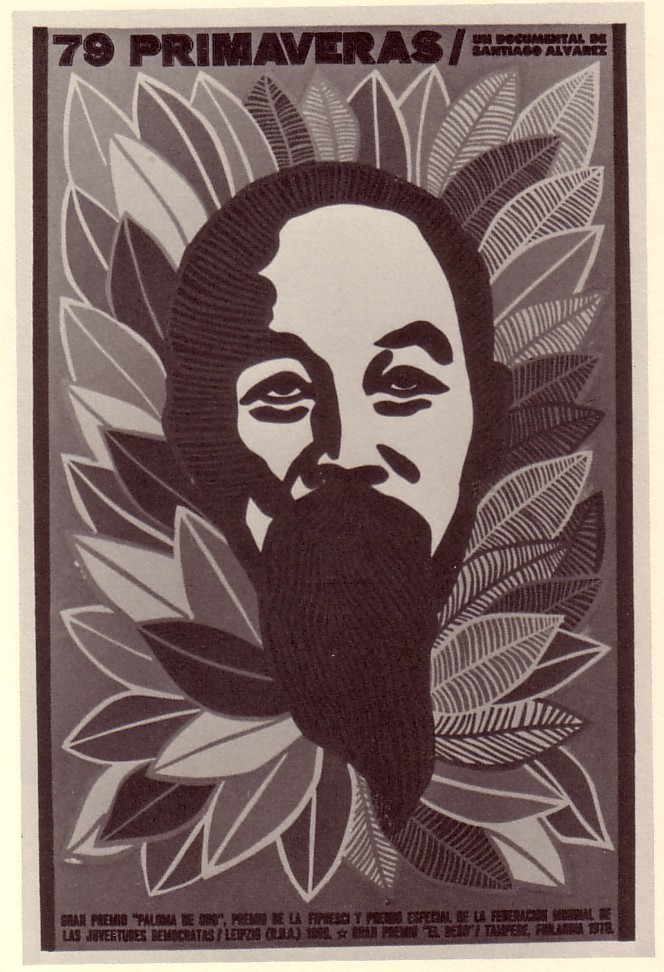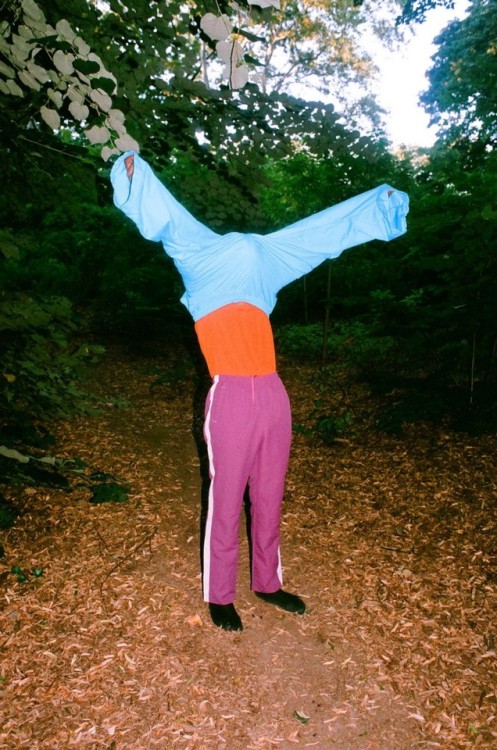[Guide de lecture] Critique littéraire marxiste
Il est notoire qu’au cours de sa longue histoire, le marxisme a produit des théories de la littérature et des critiques littéraires majeures. Dans ce guide de lecture, Daniel Hartley propose une introduction générale à ces approches, en soulignant en particulier l’importance de l’étude de la littérature mondiale. Si les études littéraires sont aussi chères aux marxistes, c’est parce que la littérature médiatise des formes de sensibilité et de subjectivité historiques, qu’elles sont une méditation sur les traces du passé au sein même du présent, et qu’elles anticipent sur des affects ou des exigences futures. Au-delà de sa capacité à refléter la réalité, la littérature est dès lors un puissant réservoir de rêves, d’aspirations ou de fantasmes inaccomplis, un sédiment de l’affrontement des classes, une cristallisation du développement inégal et de la conflictualité du genre, de la race et de l’éthnicité.