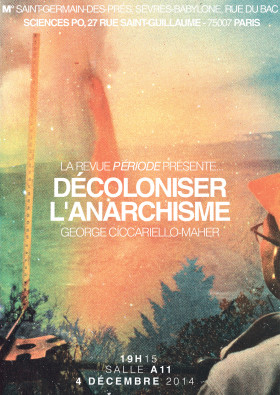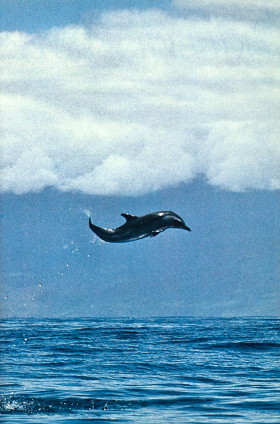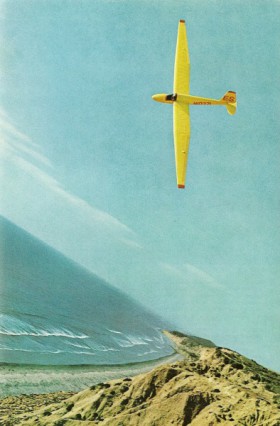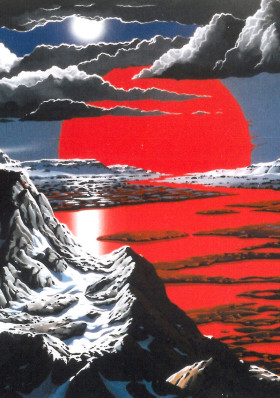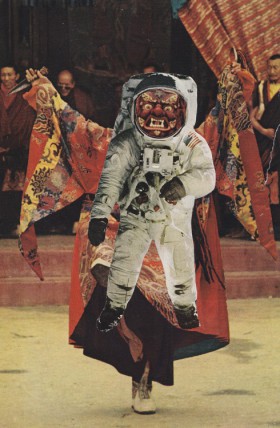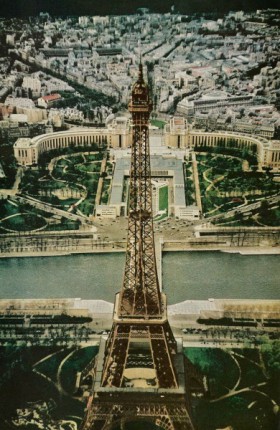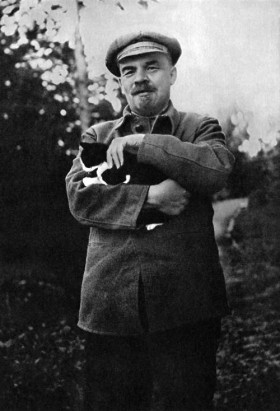[Audio] Rencontre-débat : « Décoloniser l’anarchisme » avec George Ciccariello-Maher
Il faut repenser l’anarchisme à partir du contexte non européen. C’est la conséquence que tire George Ciccariello-Maher de la cécité des mouvements libertaires occidentaux à l’égard des forces anti-étatiques en Amérique latine. Plutôt qu’un schéma doctrinal issu d’une tradition délimitée, il faut chercher l’anarchisme dans les pratiques d’insoumission et d’autodéfense populaires. C’était l’objet d’une conférence organisée par Période le 4 décembre dernier, ici disponible en téléchargement et en streaming.