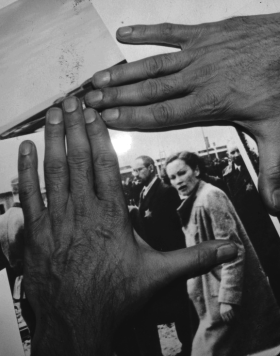[Guide de lecture] Marxisme et cinéma
Le cinéma a été un lieu d’investissement constant pour les marxistes, depuis sa naissance au début du XXe siècle. Le cinéma a ceci de singulier qu’il est un véritable système de production, à ses origines extrêmement coûteux ; il a revêtu très rapidement le statut d’industrie artistique et culturelle. Tout au long de son histoire, les marxistes ont considéré le cinéma comme un puissant véhicule idéologique, structurellement marqué par la classe dominante du fait de ses conditions de production. En même temps, depuis l’émergence du cinéma soviétique, le cinéma a aussi été un terrain d’expérimentation théorique et esthétique pour penser une autre manière de fabriquer et de faire parler les images. Dans ce guide de lecture monumental, Daniel Fairfax propose à la fois de recenser 9 périodes de pensée marxiste sur le cinéma, mais aussi de donner à voir, pour chacun de ces moments, une série de films qui en sont représentatifs. Par là, Fairfax rend palpable le rapport constant entre théoriques et pratiques marxistes du cinéma.