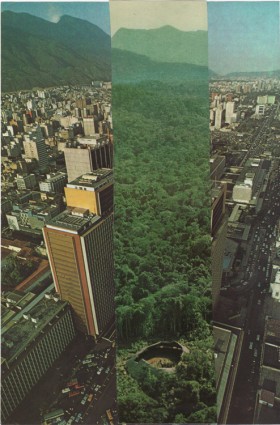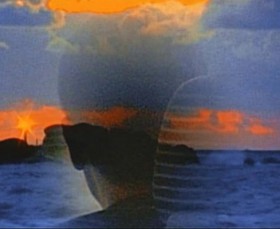Au-delà du capitalisme cognitif : subsomption, imprinting et exploitation de la subjectivité
Face à la multiplication des emplois précaires, il est devenu presque banal de diagnostiquer la crise de l’institution salariale et des formes de revendications qui y sont attachées. De même, on a souvent souligné le fait que l’accumulation capitaliste dépendait dorénavant de la mobilisation des capacités à réfléchir, à imaginer et à communiquer qui font le cœur même de la subjectivité. Pourtant, ces deux caractéristiques du capitalisme contemporain sont rarement étudiées dans leur interdépendance. Pour pallier à cette insuffisance, expliquent ici Federico Chicchi, Emanuele Leonardi et Stefano Lucarelli dans un dialogue serré avec le post-opéraïsme, il faut poser à nouveaux frais la question centrale de l’exploitation. S’appuyant à la fois sur l’analyse marxienne de la subsomption du travail au capital et sur l’analyse deleuzo-guattarienne de l’axiomatique capitaliste, ils proposent de nommer « imprinting » la nouvelle logique d’exploitation des subjectivités. Il s’agit par là de comprendre la multiplicité des formes sous lesquelles nos vies peuvent être soumises à la valorisation du travail mort, de manière à « retourner le couteau de la lutte des classes dans la plaie de la réalité capitaliste. »