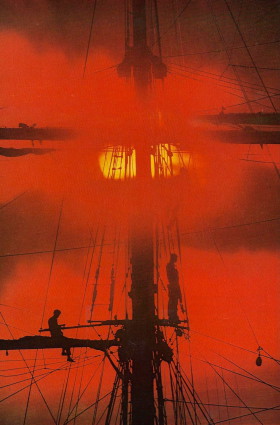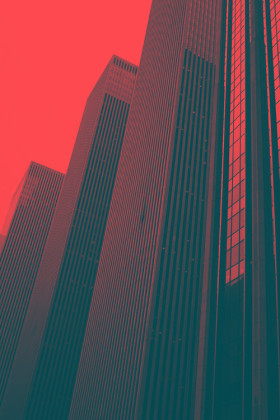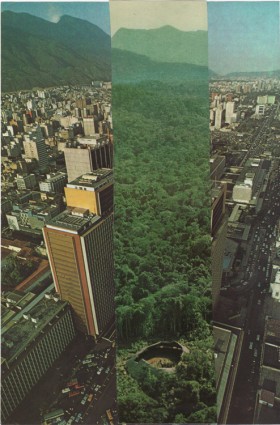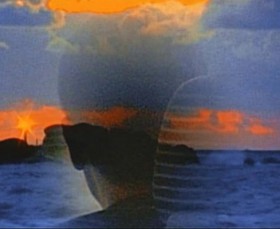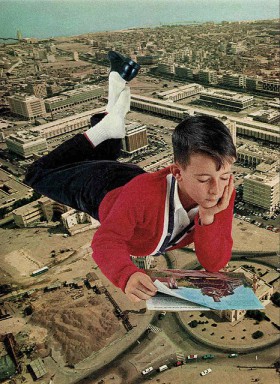Classes et confessionnalisme au Liban
Les luttes confessionnelles constituent l’un des axes centraux de la vie politique au Liban. Comment rendre compte de cette forme d’antagonisme en termes marxistes ? Fawwaz Traboulsi propose ici une reconstruction théorique qui fait un sort aux conception économicistes – pour lesquelles les confessions appartiendraient à une dimension purement idéologique (de l’ordre de la superstructure) tandis que les classes existeraient par elles mêmes. Pour Traboulsi, à l’inverse, le défi posé par les confessions, leurs luttes, est précisément de comprendre en quoi ces conflits sont constitutifs de la formation des classes sociales au Liban.