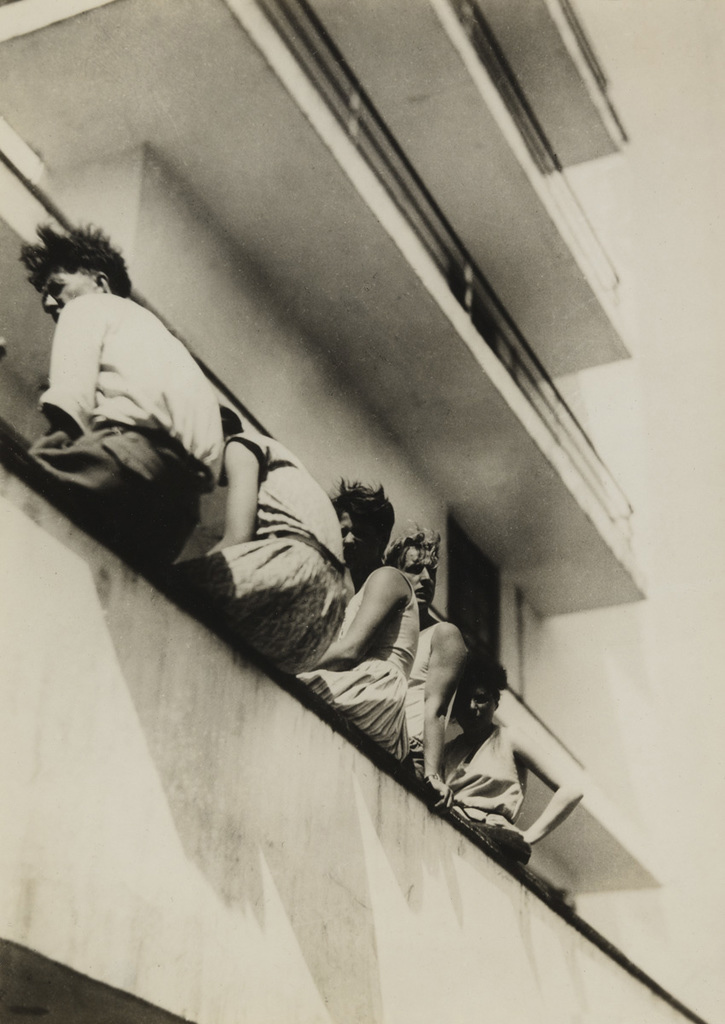Lignes de fuite, minorités et machines de guerre : repenser la politique deleuzienne
Une certaine lecture marxiste de Deleuze a vite catalogué son apport : ou bien comme une pensée apolitique, intéressée par l’art et la création, ou bien associée à la cohorte des philosophies postmodernes. Selon cette dernière lecture, Deleuze n’aurait rien à voir avec le marxisme, délaissant la question de classe au profit des minorités, rejetant la dialectique au profit de l’affirmation, ou encore préférant parler des devenirs-révolutionnaires plutôt que des lendemains de l’insurrection victorieuse. Panagiotis Sotiris, théoricien-militant combinant Althusser et Gramsci, propose ici de lire Deleuze comme une source d’inspiration profonde pour la lutte politique. Le spinozisme singulier de Deleuze, sa pensée de l’immanence, comme son élaboration schizo-analytique aux côtés de Félix Guattari, donnent à penser la politique comme expérimentation, comme production d’espaces-temps émancipateurs et résistance à des sociétés de contrôle dont l’emprise tisse notre présent.