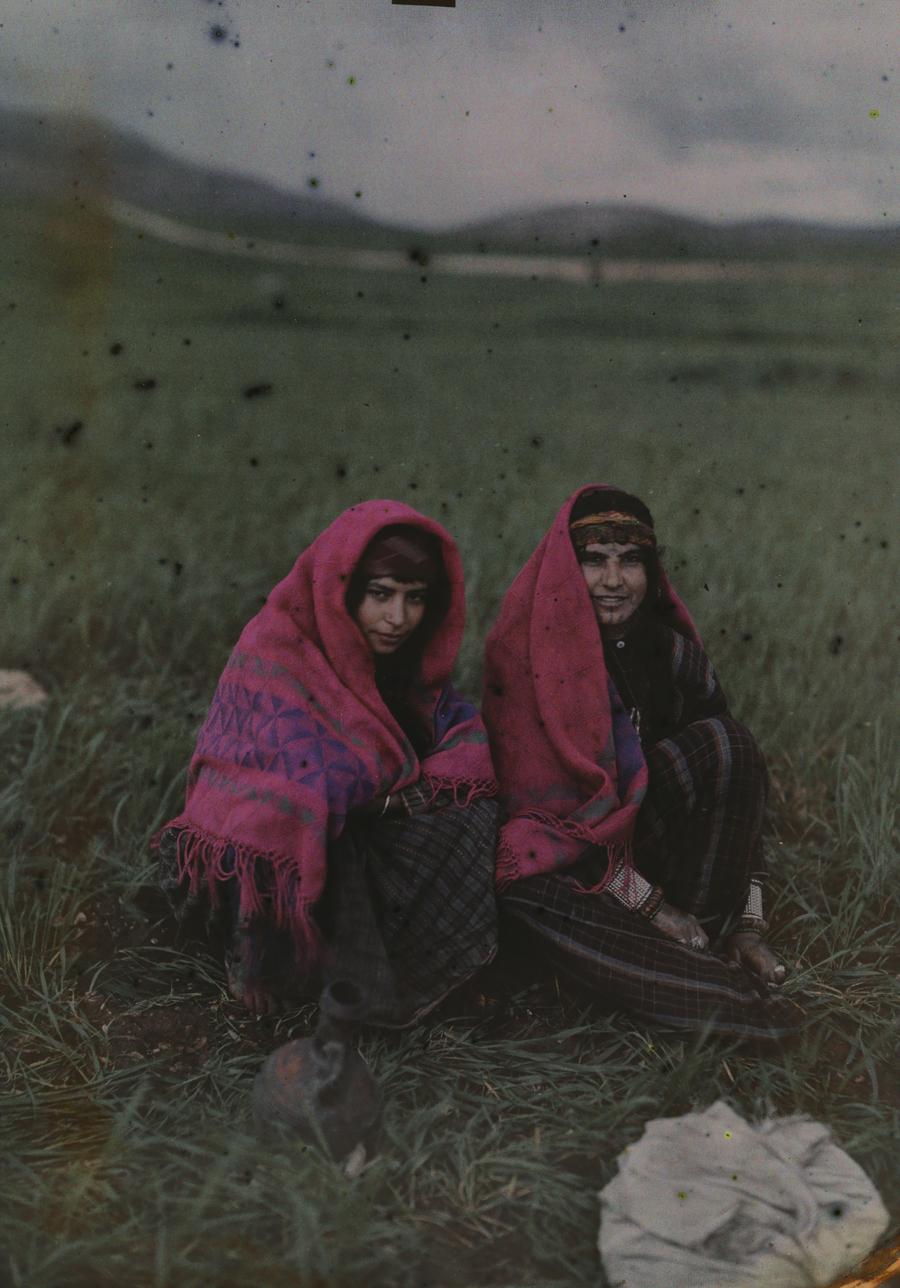De l’antifascisme au socialisme : stratégie révolutionnaire dans la guerre civile libanaise
En 1986, au cœur du tumulte de la guerre civile, Mahdi Amil, intellectuel communiste libanais, fait paraître l’État confessionnel à Beyrouth. Le texte qui suit, conclusion de l’édition arabe de l’ouvrage, constitue une intervention dans cette conjoncture. Les forces progressistes libanaises, représentées par une alliance de nationalistes, de Palestiniens et de communistes, ont traversé une séquence révolutionnaire (1975-1976) puis une série de défaites, combattues par la Syrie, l’État d’Israël et les forces réactionnaires phalangistes. Amil tente ici d’hégémoniser les forces antifascistes, en donnant à la lutte contre les phalangistes un contenu précis : la lutte contre le régime confessionnel, comme libération démocratique-nationale, point de départ d’une transformation socialiste du Liban. Assassiné l’année suivante par des milices chiites, Amil livre ici un testament politique gramscien, saisissant avec acuité les liens entre crise de l’État et confessionnalisme.