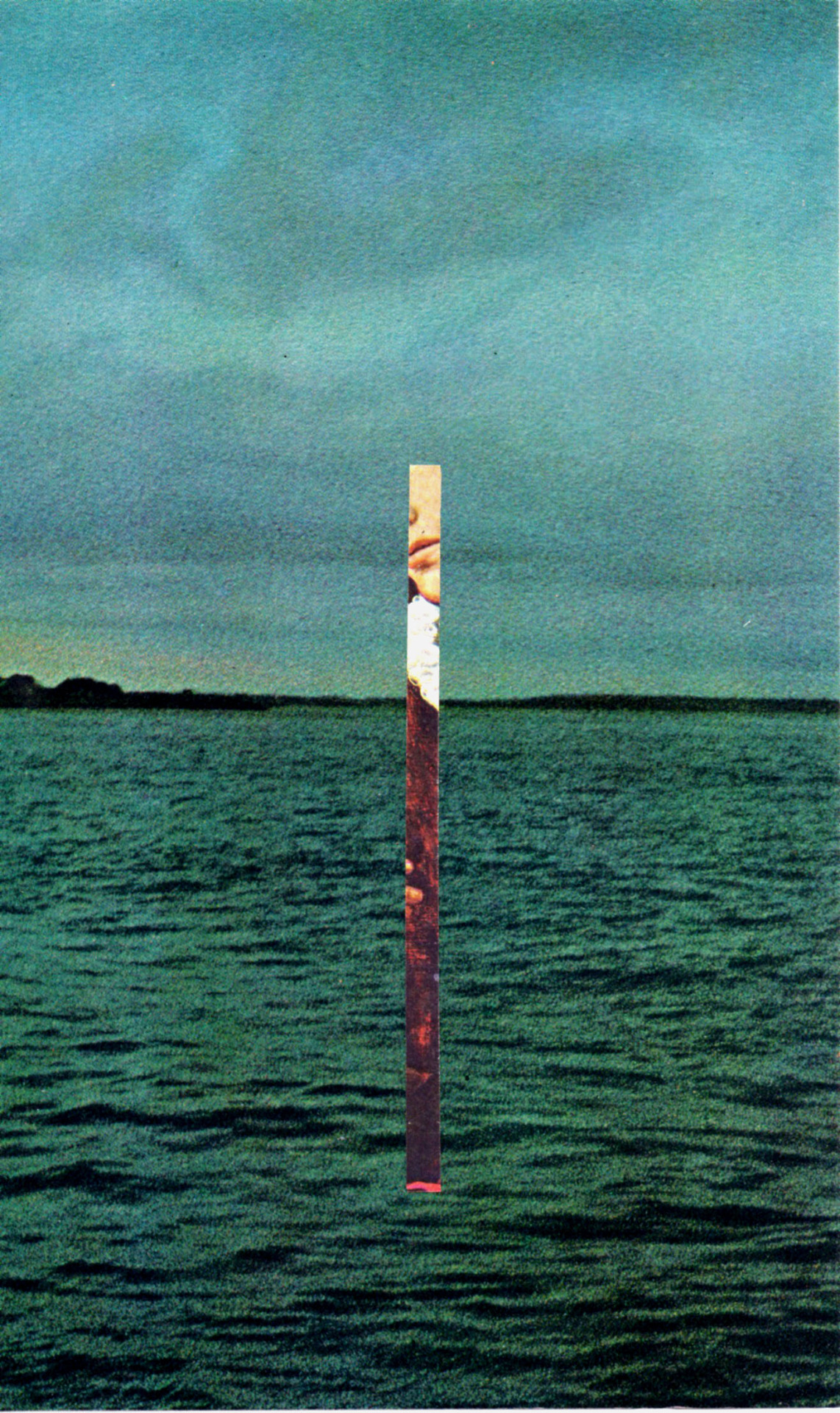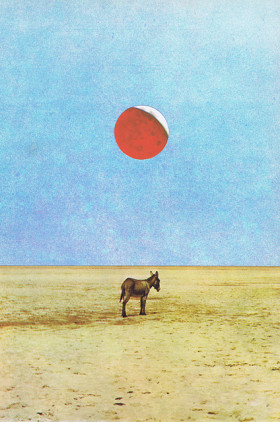La religion de l’ère moderne
Une approche marxiste du phénomène religieux implique un bilan critique du sécularisme libéral. Contre les prétentions de ce dernier, il s’agit d’abord d’envisager le moment théocratique de la religion comme une incapacité de la politique à s’autonomiser. Dans ce texte, Bolivar Echeverria constate que la religion du monde moderne (le fétichisme marchand), bien que sécularisée, reproduit des aspects notables de la religiosité archaïque : elle consacre une impuissance collective, elle empêche la prise en charge commune des affaires publiques. À l’inverse, l’auteur montre en quoi certaines formes de religiosité encouragent l’autonomie politique, citant le jésuitisme catholique et sa tentative de produire une modernité alternative. « Il est indispensable, malgré l’impasse dans laquelle nous a conduit la modernité capitaliste, de revenir au projet profond de la modernité – une modernité qui permet l’abondance et l’émancipation –, et de s’aventurer dans la construction d’une modernité alternative. »