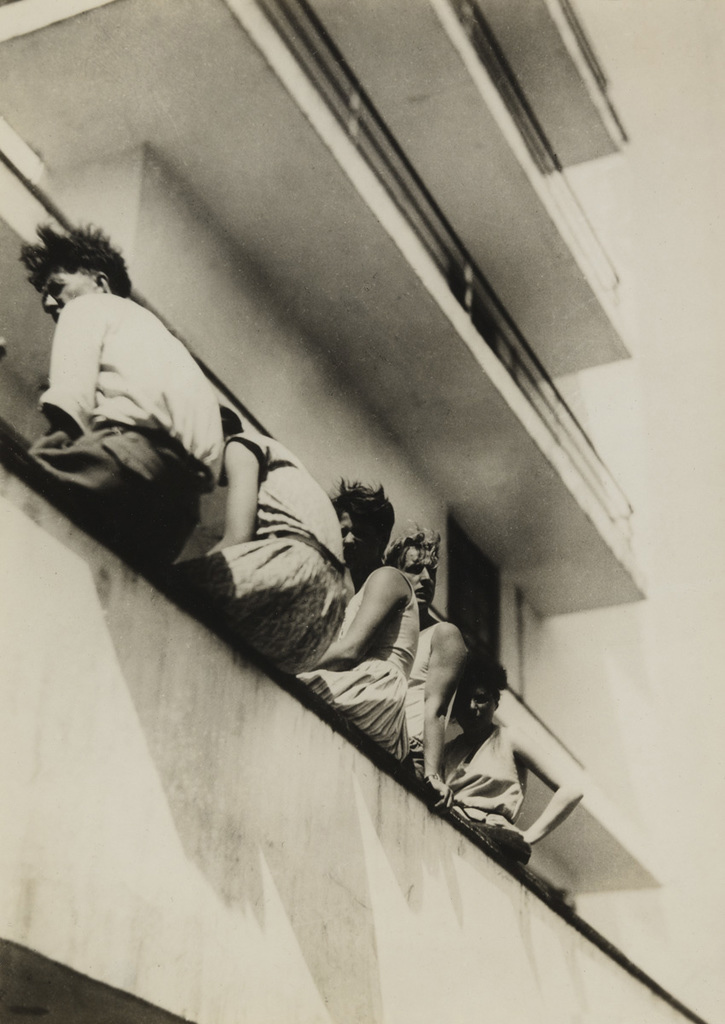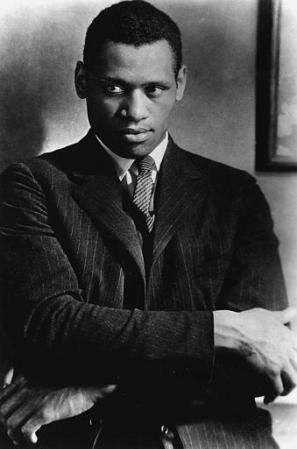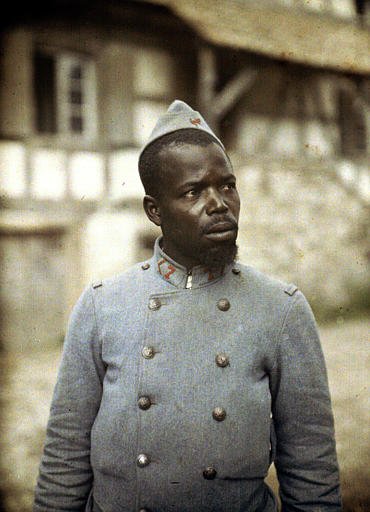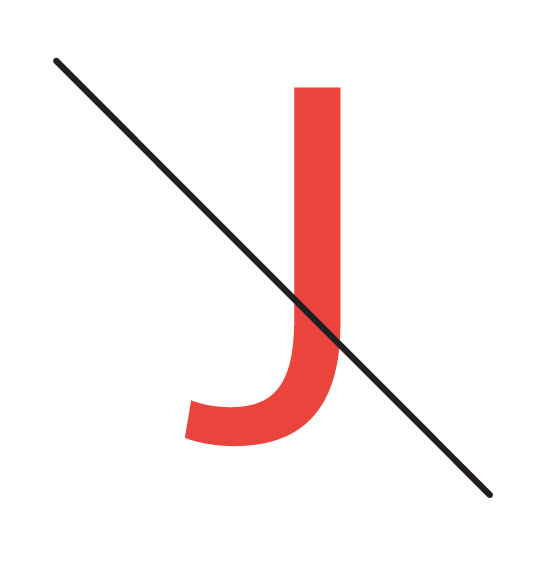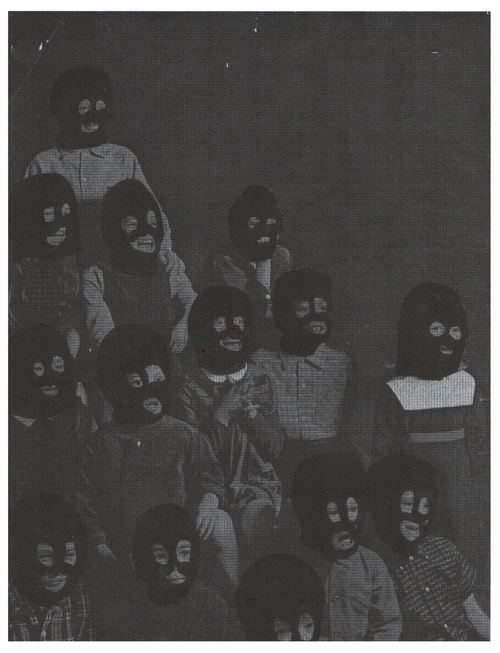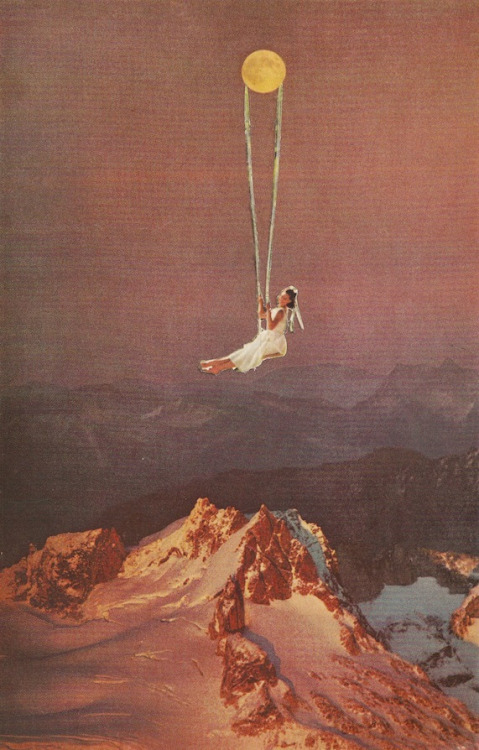Qu’est-ce qu’une langue mineure ?
Le conflit entre une langue hégémonique et des langues subalternes est un moment à part entière de la lutte des classes. En prenant appui sur l’essai de Deleuze et Guattari Pour une littérature mineure, Jean-Jacques Lecercle s’attache à en faire la démonstration. Il propose dès lors une théorie des langues en lutte au sein d’une même « formation linguistique ». Cette perspective autorise un regard renouvelé sur l’impérialisme linguistique de l’anglais devenu langue globale et sur les résistances opposées de l’intérieur même de cette langue. Elle révèle que l’assujettissement à une langue produit des variantes, des dialectes, des syncrétismes, qui en contestent l’hégémonie. Pour Lecercle, la littérature est donc un lieu de production de langues mineures : en cela, elle met en œuvre la lutte des classes au sein du langage.