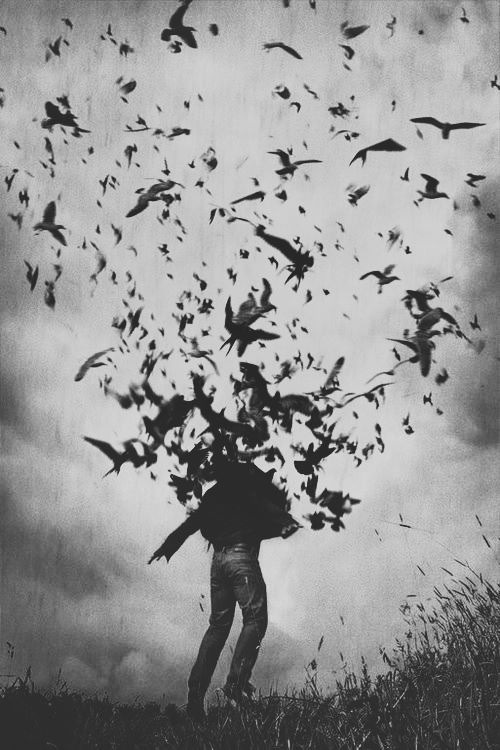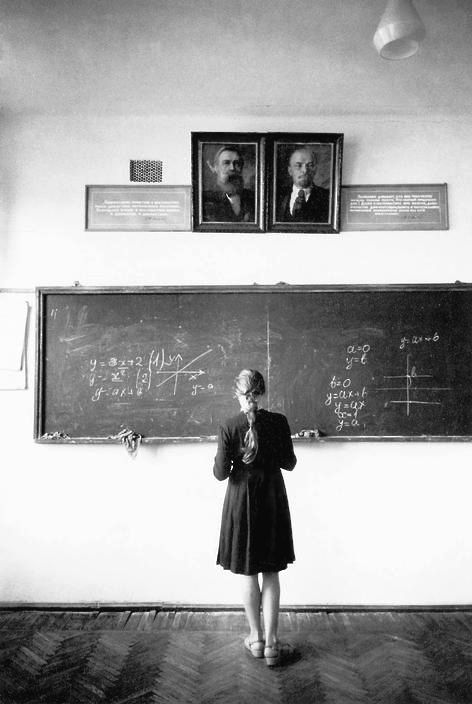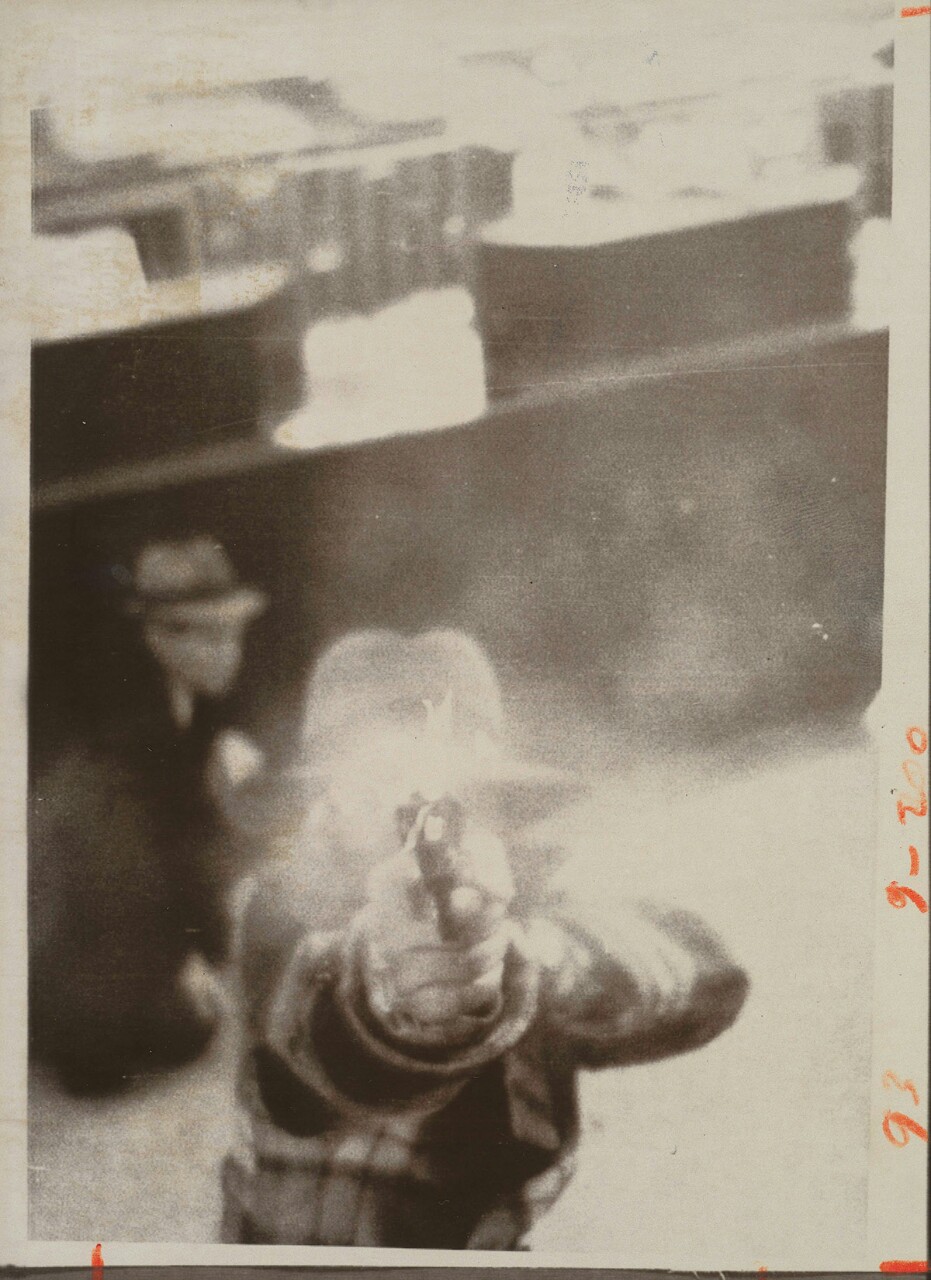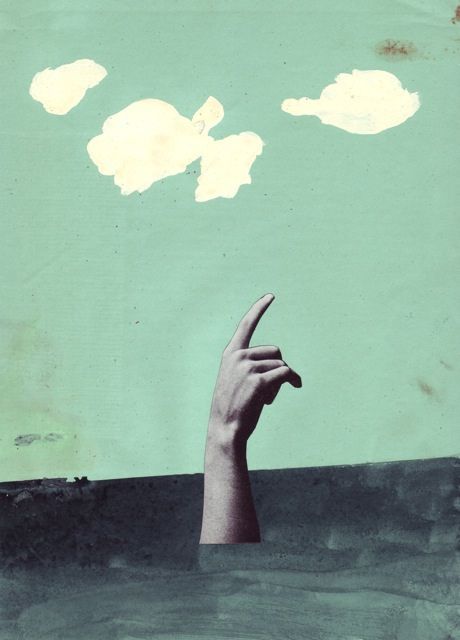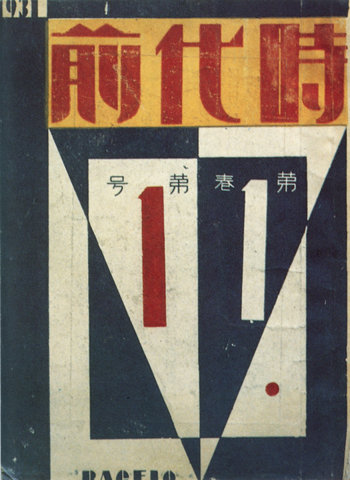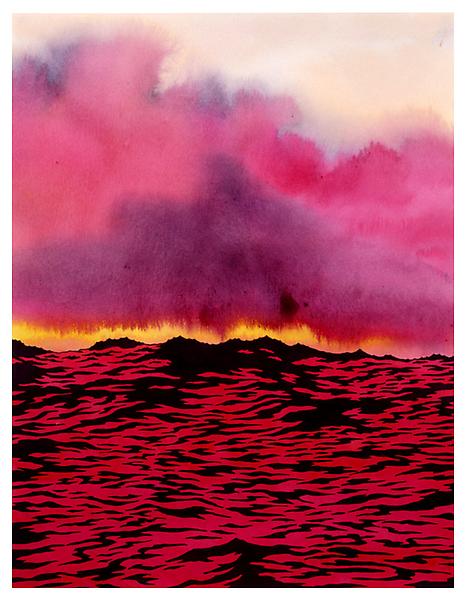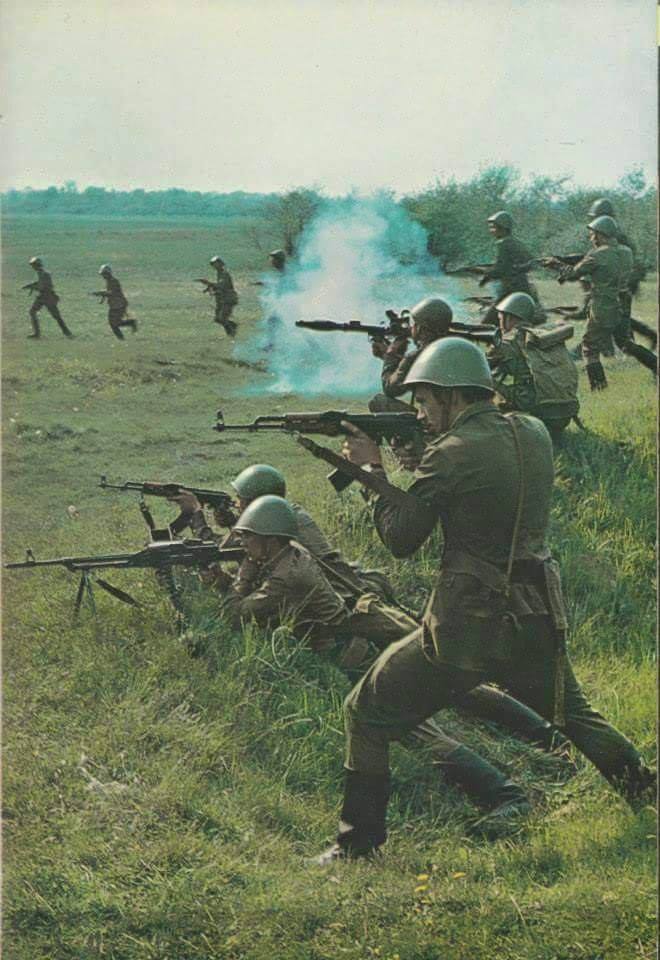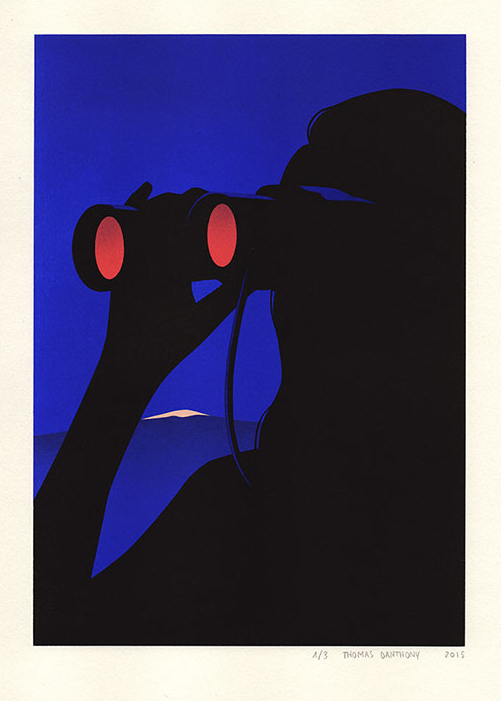De Spinoza à Gramsci : entretien avec André Tosel
Des auteurs de la tradition marxiste, Gramsci est sans doute le plus mobilisé sans intelligence de ses concepts : réduite à un pensée de « l’hégémonie culturelle », la critique tranchante du communiste sarde est généralement évincée. André Tosel, grand lecteur de Gramsci, a toujours cherché à souligner combien la « philosophie de la praxis » et les Cahiers de prison portent une refondation philosophique et politique du communisme. Dans cet entretien avec Gianfranco Rebucini, Tosel revient sur sa trajectoire intellectuelle, qui l’a mené à interroger le texte gramscien au prisme des impasses du communisme historique. De sa foi catholique au spinozisme, de la rencontre avec Althusser jusqu’au dépassement gramscien de l’althussérisme, Tosel raconte son passionnant cheminement du Dieu caché de l’espérance jusqu’à l’immanence radicale de l’histoire. Cette lecture de la politique comme nouvelle intellectualité des subalternes est à retrouver dans son Étudier Gramsci, Paris, Kimé, 2016.