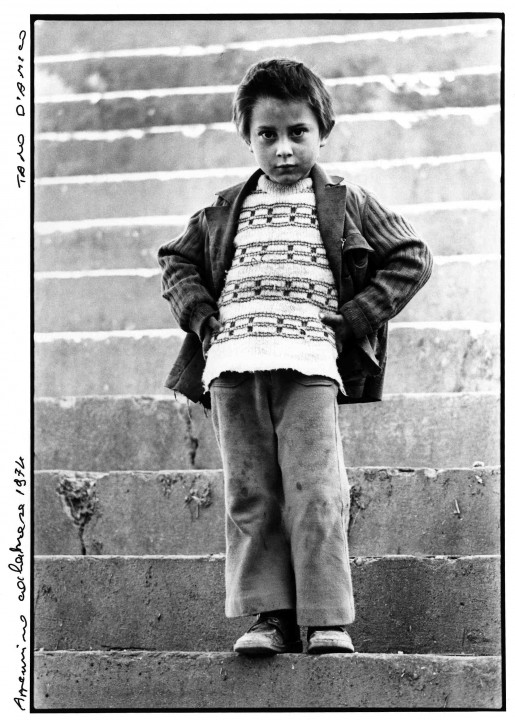L’opéraïsme politique italien des années 1960 s’est caractérisé, entre autres choses, par une redécouverte de Marx, contre le marxisme. Peux-tu expliquer en quel sens ?
L’opéraïsme a accompli un retour machiavélien aux principes : un retour à Marx, tout d’abord, contre le marxisme, c’est-à-dire contre le déterminisme, l’historicisme et l’objectivisme de cette tradition. L’opéraïsme n’est pas une hérésie à l’intérieur de la famille marxiste ; il est une rupture avec cette famille. Et justement les opéraïstes se définissaient comme marxiens et pas marxistes, un peu de la même manière que Marx, qui vers la fin de sa vie paraît-il avait déclaré : « je ne suis pas marxiste ». Il est clair, pourtant, qu’un tel retour aux principes n’ambitionnait pas de construire une nouvelle orthodoxie basée sur la lecture correcte du prophète, comme l’ont par contre fait les autres hérésies (par exemple celles trotskiste ou bordiguiste, « anoblies » par leur anti-stalinisme, qui toutefois et paradoxalement finissaient souvent par attaquer Staline en tant que déviationniste par rapport à la ligne du développement historique linéaire que l’on supposait avoir été tracée une fois pour toutes par Marx). La relecture opéraïste de Marx était donc non seulement critique vis-à-vis du marxisme, mais aussi – dans une certaine mesure – critique par rapport aux limites et aux impasses de Marx ; elle tendait à faire exploser ses ambivalences, à le tirer par les cheveux, à découvrir dans sa pensée une poudrière pour attaquer la société-usine du capitalisme avancé.
À la différence des autres ouvriérismes précédents (comme le conseillisme) ou contemporains (comme ceux de matrice chrétienne ou populiste), l’opéraïsme politique italien n’aimait pas les ouvriers et les prolétaires : il pariait sur la possibilité que là gisait une force qui pouvait se mobiliser contre elle-même, non pas pour étendre mais pour éteindre sa propre condition. Il s’est donc agi d’un ouvriérisme contre le travail, pour le refus d’une nature subjective imposée par le rapport capitaliste. Il s’est agi d’un ouvriérisme fondé sur la partialité irréductible du point de vue, d’une dynamique autonome à construire. Attention : non pas celle des exploités, mais celle qui lutte contre l’exploitation. Non pas qui vit de son propre travail, mais qui lutte contre le travail pour vivre de manière libre. Non pas les pauvres et les damnés de la terre, mais la classe ouvrière qui se bat pour sa propre abolition (et que la classe ouvrière soit une question de force d’avant-garde et pas de mains calleuses et de cols bleu sales de gras, devons-nous encore perdre du temps à le préciser ?).
En rupture avec l’universalisme, avec le marxisme et, en partie, avec Marx-même, les opéraïstes ont situé au centre la question de la subjectivité, ou mieux – pour le dire avec Alquati – de la contre-subjectivité. Cela n’a rien à voir avec l’usage devenu courant du terme subjectivité : dernièrement (l’époque du « post ») il y a eu une déclinaison très faible, liée surtout au foucaldisme et au post-structuralisme, de ce concept (dont Foucault et les post-structuralistes ne sont qu’en partie responsables). La « découverte » de la subjectivité a été bénéfique : elle permettait de mettre de côté la question de la classe, de ressaisir la partie collective du sujet au sens recompositionniste. Cela n’a pas coïncidé pourtant avec la découverte de la centralité de l’individu, c’est-à-dire la reddition par rapport à l’ordre du discours libéral, paléo- ou néo-, peu importe. La subjectivité dont nous parlons n’est même pas référable à la conscience, du moins à ce que cela a signifié dans la tradition marxiste, c’est-à-dire l’élément de médiation idéaliste du progrès historique. La subjectivité dont on parle, au centre de la définition de la composition de classe (sur laquelle on va revenir), est quelque chose de radicalement différent. La subjectivité n’est pas bonne en soi : elle est un champ de bataille. La production de subjectivité dans le capitalisme est intrinsèque au rapport social de production et d’exploitation ; elle est l’enjeu d’un processus antagoniste et de formation, c’est-à-dire de conflit, violence, reproduction, consensus, transformation. Quand aujourd’hui, dans un contexte de rapports de forces favorables au capital, l’on parle de « subjectivité prolétarienne » (ou précaire, ou du travail vivant, ou ce que vous préférez pour indiquer les figures de notre partie potentielle), l’on parle d’une subjectivité forgée tout d’abord par la domination capitaliste. Dire contre-subjectivité signifie donc parler d’une subjectivité non seulement contre le capital, mais aussi contre le capital que nous portons en nous. Eh oui, parce que dans la mesure où nous détestons les patrons, nous devons arriver à nous détester nous-mêmes, à détester le cancer qui chaque jour nous ronge et nous met au service de ce qui nous exploite.
À la lumière de cette irréductible partialité du point de vue il est alors possible de comprendre le renversement opéraïste : d’abord la classe, et après le capital. Ce n’est donc pas le capital le sujet de l’Histoire, qui fait et défait, qui détermine le développement et les conditions de son propre dépassement. Au centre il y a la lutte de classe, dans sa force de refus, dans son autonomie.
À cet égard, Mario Tronti a sans doute joué un rôle de premier plan…
Avec Tronti la classe cesse d’être un simple concept sociologique ou descriptif, pour devenir un concept entièrement politique. La classe n’existe pas en nature, ou mieux elle existe dans la nature du capital comme taxonomie des segments sociaux disposés à l’intérieur du marché du travail. On peut avoir des prolétaires sans prolétariat, des ouvriers sans classe ouvrière. La classe n’est donc pas une question de stratification, mais d’antagonisme. C’est toujours à la lutte de produire la classe en tant que macro-partie collective. Classe signifie antagonisme de classe. Avec Tronti justement : il n’y a pas de classe sans lutte de classe.
Dans ce cas aussi Marx doit être utilisé et tiré par les cheveux. On doit utiliser le Marx des ouvrages historiques, celui qui nous montre que les prolétaires sont devenus classe sur les barricades de 1848. Mais aussi celui (ambivalent) du Capital. Celui qui dans le premier livre nous montre comment ce sont les luttes qui ont déterminé la réduction de la journée de travail et pas la législation bourgeoise ou quelque capitaliste éclairé (il est intéressant de remarquer comment, au sujet de la même époque, dans des cours tenus à Montréal entre 1966 et 1967 et maintenant réunis dans You Don’t Play With Revolution, C.L.R. James arrive à des conclusions identiques). Si, en effet, les patrons pouvaient nous faire travailler toute la journée, sans résistances ni conflits, ils le feraient. Il s’agit d’une leçon qui doit être rappelée à ceux qui aujourd’hui pleurent sur le travail gratuit, invoquent la redistribution des richesses ou pensent que le revenu de citoyenneté est une question de rationalité productive : seule la lutte peut contraindre les patrons à payer cher, le salaire étant un butin de guerre entre deux parties adverses. Si l’une des deux ne se bat pas, l’autre ne fera pas de prisonniers – n’en déplaise à la gauche.
Il y a aussi un usage du Marx du troisième tome, qui comme l’on sait s’interrompt avec le chapitre inachevé sur les classes. Ironiquement dans Ouvriers et capital Tronti constate que « de Renner à Dahrendorf, de temps à autre, chacun s’amuse à compléter ce qui est resté incomplet : il en résulte une diffamation de Marx qui irait bien avec un tout petit peu de persévérance jusqu’à la violence physique ». Eh oui, dans le chapitre cinquante, « L’apparence de la concurrence », Marx écrit : le prix du travail n’est pas réglé par la concurrence, mais c’est le prix du travail qui règle la concurrence. Les opéraïstes diront : ce sont aux luttes de déterminer le développement, d’abord il y a la classe et après le capital. Interpréter le capital à partir de lui-même est une projection idéologique. Quand aujourd’hui l’on dit « ce sont les marchés qui le veulent », on est à l’intérieur d’une telle projection. Dans le chapitre inachevé avec lequel se termine le troisième tome du Capital Marx note très peu de choses, mais décidément importantes. Il nous dit que ce ne sont pas les revenus qui construisent une classe, ni simplement la collocation à l’intérieur des rapports de production, même si évidemment ces facteurs déterminent la base matérielle sur laquelle la question de la classe se fonde. Ce qui constitue la classe c’est justement la lutte qui rompt l’abstraite unité démocratique du peuple : quand « le peuple indivisible » se scinde en des « champs ennemis », quand – écrit Tronti – « la classe ouvrière exprime son refus politique de se faire peuple », eh bien à ce moment « la voie la plus directe de la révolution socialiste ne se ferme pas, elle s’ouvre ». L’un se casse en deux, l’irrecomposabilité pour le capital devient possibilité de recomposition pour la classe. La classe disparaît comme agrégation simplement sociale et devient sujet antagoniste irréductible à l’unité de l’intérêt général, c’est-à-dire l’intérêt du capital. C’est cette assomption de la partialité ouvrière qui contraint les capitalistes à s’agréger politiquement, à dépasser leurs propres contradictions, à se découvrir comme puissance sociale, en utilisant collectivement la force de leur propre ennemi, pour se développer et faire des bonds en avant. Ici s’évanouissent les illusions d’une évolution pacifiée, pour les réformistes de l’une ou de l’autre partie. Ici tombe le masque de la démocratie et se dévoile le visage des rapports de force entre deux puissances en conflit : non plus travail et capital, mais travailleurs et capitalistes, classe contre classe, force contre force.
Voilà donc que l’opéraïsme est une pensée du conflit, de la recherche antagoniste des contradictions centrales, de la contraposition, de l’ami-ennemi comme forme de l’agir politique et militant. Dans son dernier ouvrage, Dello spirito libero, Tronti a écrit : « L’amitié politique est ce qu’ont en commun, ce qui réunit [accomuna], ceux qui sont contre. C’est l’action d’être contre qui consacre les grandes amitiés ». C’est tout d’abord le contre qui nous réunit, qui rend possible le pour. L’opéraïsme est une pensée du refus et du négatif comme fondements du communisme. Le bien est ce qui creuse les contradictions de l’ennemi, le mal est ce qui les résout. Pourtant, la contradiction n’est pas résolvable à l’intérieur de la composition organique du capital, c’est-à-dire dans le rapport entre capital variable et capital constant, mais elle doit exploser dans l’affrontement entre composition organique du capital et composition de classe, c’est-à-dire le rapport entre articulation de la force de travail et production de subjectivité. La lecture opéraiste de Marx part d’ici, pour aller dans une direction étrangère et opposée au marxisme.
Tu as fait allusion à la composition de classe. Est-ce que tu peux clarifier de quelle manière l’opéraïsme a travaillé politiquement avec la composition de classe du capitalisme italien de l’époque à travers la pratique de l’enquête militante ?
Dernièrement l’on a beaucoup parlé d’enquête et de co-recherche, même beaucoup trop peut-être, au sens qu’il serait mieux d’en parler moins et d’en faire plus, d’enquêtes militantes. Pour répondre plus dans les détails à ta question et éviter de répéter des choses déjà dites, je renvoie à une intervention faite en occasion de la présentation de la traduction française de La Horde d’or organisée en juin 2017 par le groupe de camarades qui a fait cet extraordinaire travail, et qui a été publiée sur le nouveau site Plateforme d’Enquêtes Militantes. Le titre de l’intervention, « La co-recherche comme style de militance », résume bien je dirais l’essence de ce dont on est en train de parler. Souvent parmi les camarades il y a une idée de l’enquête comme spécialité, ou comme rhétorique, ou comme confirmation des choses que nous faisons (puisque nous sommes précaires, si nous faisons une auto-enquête sur notre point de vue, qui est le point de vue du précariat ?). Rien de plus inutile. La co-recherche est un processus politique autonome de production à la fois de contre-connaissance, contre-subjectivité et contre-organisation, dans lequel le contre-usage des outils capitalistes (comme les compétences spécifiques) signifie leur transformation. C’est un style général de militance parce que le militant est toujours à la recherche de quelque chose qu’il ne comprend pas, d’une possible force pour faire sauter les contradictions, de ce qui existe mais qu’il n’arrive pas à voir. Le militant est toujours inquiet, ou il n’est pas un militant.
Dans les années 1950 et au début des années 1960, quand Alquati et d’autres camarades commencent les parcours de co-recherche, les usines et les ouvriers ont été politiquement abandonnés. Dans une sorte de francfortisme inconscient, le Parti communiste retenait la classe ouvrière comme irréversiblement intégrée à la machine capitaliste. Il se formait ainsi un cercle vicieux : le PCI – qui avait choisi de poursuivre les couches moyennes et la voie italienne au socialisme (une voie sans lutte de classe révolutionnaire) – demandait aux militants d’usine ce qu’il se passait là-bas, et ces derniers répondaient que parmi les ouvriers effectivement il n’y avait pas de possibilité de lutte de classe révolutionnaire. La ligne du sommet se voyait ainsi confirmée et confortée. Les ouvriers immigrés du Sud de l’Italie, enrégimentés à la chaîne de montage, ceux qui peu après seront devenus les ouvriers-masse, étaient représentés par les militants du PCI et du syndicat comme des opportunistes, des passifs, des aliénés. Les militants opéraïstes, en discutant avec les jeunes « nouvelles forces », creusent les ambivalences, voire les véritables ambiguïtés, de ces comportements. Ils comprirent que, oui, cela était vrai, les futurs ouvriers-masse très souvent votaient pour les syndicats jaunes, parce qu’ils ne se sentaient représentés par personne ; ils ne participaient pas aux grèves, parce qu’ils les envisageaient comme inutiles, et même la passivité était une forme de lutte potentiellement plus efficace ; et très vite l’étrangeté au travail devint refus et insubordination. L’ouvrier-masse, en plus, normalement des jeunes méridionaux immigrés dans les métropoles industrielles du Nord, ne correspondait pas à l’image de la victime avec les valises en carton, transmise par la littérature et le cinéma de la gauche, pleine de larmes et compassion ; il était au contraire une force en puissance, porteur de nouveaux comportements et cultures du conflit étrangères à la tradition du mouvement ouvrier désormais co-gestionnaire des processus d’exploitation à l’usine. Ça suffit avec les larmes, ça suffit avec le désir de victimes, ça suffit avec la culture de gauche : le militant révolutionnaire recherche la force, non pas la faiblesse. Voilà pourquoi nous pouvons dire que l’opéraïsme est une expérience communiste en rupture avec le parti communiste et étrangère à la culture de gauche. Cette recherche de la force, toutefois, ne se base jamais sur l’idéologie ou la satisfaction de sa propre identité, mais est toujours enracinée dans la composition de classe, et dans un pari politique à l’intérieur d’une composition de classe historiquement déterminée. Et ici s’ouvre une question décisive, parce que ce concept est central dans la méthode opéraïste.
Affronter la composition de classe implique de se poser le problème subjectif de la recomposition politique. Comment doit-on entendre la question de la recomposition ? Elle a plus à voir avec la synthèse ou avec la rupture ?
Pour continuer le discours, nous pourrions dire qu’il n’y a pas de lutte de classe sans recomposition de classe. Avant, toutefois, il faut bien comprendre le concept de composition de classe, et son rapport entre composition technique et composition politique, c’est-à-dire l’articulation capitaliste de la force de travail dans son rapport avec les machines et la formation de classe comme sujet indépendant. La composition technique et la composition politique ne nous restituent pas des photographies d’éléments statiques, c’est-à-dire de la force de travail totalement subordonnée au capital d’une part, et une classe totalement autonome d’autre part : il s’agit de deux processus traversés par le conflit, l’affrontement, la possibilité de la rupture et le renversement, parce que tous les deux sont à l’intérieur du rapport social du capital en tant que rapport antagoniste. Entre ces deux rapports il n’y a pas de dialectique conciliatoire, comme il n’y a pas de synthèse et de spécularité. Le sujet central ou le plus avancé pour l’accumulation capitaliste n’est pas nécessairement le sujet central ou le plus avancé pour les luttes, comme on le pensait dans la tradition socialo-communiste, et comme l’on a souvent implicitement pensé dans les élaborations « postfordistes ». Il ne s’agit donc pas de la re-proposition du rapport marxiste entre classe en soi et classe pour soi, médiatisé par une conscience idéaliste de classe tout simplement à dévoiler. Comme nous l’avons déjà vu, en fait, la subjectivité – base et enjeu de la composition de classe – n’est pas la conscience : elle ne doit pas être dévoilée, mais produite. C’est le capital qui la produit ; ce sont les luttes qui peuvent la produire.
La composition politique implique toujours un double processus : la recomposition pour ses propres fins autonomes, et la décomposition aux fins de l’ennemi. Recomposition ne signifie pas une juxtaposition d’éléments tels qu’ils sont, mais leur transformation en un processus de rupture avec le cadre existant et de construction d’un nouveau cadre. Il ne s’agit pas donc de réunifier une unité supposée originaire et fragmentée par l’action du capitalisme, c’est-à-dire de retourner à ce qu’il y avait avant : la recomposition de classe est la création d’un sujet nouveau et autonome. C’est l’action de la classe contre son propre ennemi qui est aussi l’action de la classe contre elle-même, pour détruire le rapport capitaliste qui s’incarne dans le prolétariat. Nous pourrions dire que la recomposition est le retour à l’autonomie qui n’est pas là. Le retour donc à des éléments qui, en rompant avec le cadre donné, se composent de manière radicalement différente, en créant un nouveau cadre de rapports sociaux. Et en se recomposant dans la rupture, ces éléments se subvertissent eux-mêmes, changent de fond en comble, se renversent par rapport à leur fonction originaire.
Le capital aussi se décompose et recompose continuellement, c’est-à-dire qu’il détruit et qu’il transforme : il appelle cela innovation. Aux mouvements révolutionnaires des années 1960 et 1970, le capital a répondu en premier lieu non pas avec la répression, mais avec l’innovation. L’innovation est une contre-révolution, en vue de renforcer le commandement et l’accumulation du capital. Ce changement porte avec lui le signe partiel de son antagoniste, dépourvu toutefois de la possibilité de rupture, subsumé et plié vers des fins systémiques. Par exemple, à la lutte contre le travail salarié et à la flexibilité autonome ouvrière et prolétaire, le capital a répondu avec la précarisation. À partir des années 1980 et 1990, en plein développement néolibéral, ont émergé deux positions. D’un côté, on a ceux qui ont oubliés le signe antagoniste, et ont fini par revendiquer le retour à ce que les ouvriers et les prolétaires avaient refusé et combattu, c’est-à-dire les chaînes du travail à temps indéterminé ; de l’autre, on a ceux qu’ils ont pris l’innovation pour la révolution, en peignant avec fantaisie une coopération sociale désormais pleinement libre et autonome, et un capital comme pure carapace parasitaire. Les uns comme les autres ne voient pas la continuité et la possibilité de l’antagonisme, et assument donc une séparation désormais advenue entre les deux classes-parties : pour les uns cela signifie l’impossibilité de la libération, pour les autres la libération déjà accomplie. Les deux positions sont idéologiques ; les deux sont impuissantes ; les deux indiquent le refoulement du problème de la rupture révolutionnaire. Les deux ne voient pas la question centrale de la composition de classe comme processus traversé continuellement par le conflit.
Nous pourrions alors dire ainsi, avec une formulation : le contraire d’innovation n’est pas conservation, mais révolution. Si aux termes d’innovation et conservation nous substituons les termes de gauche et droite le résultat ne change pas, il s’agit de synonymes : le contraire de droite n’est pas gauche, mais révolution. Pour cette raison, nous ne pouvons pas nous définir de gauche : non pas parce que la gauche est devenue ce qu’elle est, mais parce qu’elle l’a toujours été. La gauche est ab origine issue des lumières, elle est progressiste et innovationniste. C’est la pensée de la victime et de la défaite, de la confiance en l’Histoire et de l’hostilité vis-à-vis de qui lutte contre son propre temps, de la compatibilité avec la puissance du capital et de l’excommunication paranoïaque de la puissance antagoniste – voilà pourquoi dès que les comportements prolétaires montrent leur tête, se déclenche la diétrologie et l’accusation d’être des provocateurs. La gauche peint des natures mortes au bord du lac ; nous – qui voulons nous organiser dans les tourbillons, même dans la saleté dangereuse et ambiguë du réel – nous devons prendre nos distances non pas vis-à-vis de telle ou de telle gauche, mais de la gauche tout court.
À cet égard, Romano Alquati – figure décisive de l’opéraïsme, mais peu valorisée en Italie et presque inconnue à l’étranger – parlait de « spontanéité organisée » et d’« organisation invisible ». Qu’est-ce qu’il entendait par là ?
Cette approche de la composition de classe et de la recomposition nous la devons tout d’abord à Alquati. Si nous voulons le dire avec une formulation frappante, il n’y a pas d’opéraïsme sans Alquati, même si Alquati ne peut pas être exclusivement réduit à l’expérience opéraïste. Très souvent il a été perçu comme l’« inventeur de la co-recherche », affirmation à laquelle il répliquait en disant que les militants ont toujours fait de la co-recherche et que lui, tout bonnement, en tant que militant, faisait de la co-recherche ; c’est un peu comme dire – il nous avertissait – que, si pour traverser un chemin plein de cailloux je dois mettre des bottes, alors cela signifie que j’ai inventé les bottes. Il y avait bien évidemment une exagération paradoxale dans tout cela, parce que la co-recherche telle que nous la connaissons, que nous en parlons et que nous essayons de la réinventer aujourd’hui a été tout d’abord fondée à travers la contribution d’Alquati et des réalités collectives construites par lui afin de la pratiquer. Toutefois, il est vrai que le définir tout simplement comme l’inventeur de la co-recherche a fini par limiter son parcours aux années 1960, aux – quoique décisifs – écrits sur la Fiat et l’Olivetti. Alquati est par contre beaucoup plus que cela. Ses parcours de recherche à l’intérieur et contre l’« université des couches moyennes » des années 1970 sont encore fondamentaux de nos jours, car il a su anticiper l’émergence de l’ouvrier social et du prolétariat intellectuel. Entre les années 1980 et 1990 il élabore ensuite un modèle général (le modellone) de fonctionnement du capitalisme, voué au macro-objectif révolutionnaire de la rupture et de la sortie de la civilisation capitaliste. Dans cette phase Alquati produit des anticipations extraordinaires concernant des thématiques, des nœuds et des questions (de l’hyper-industrialisation à la centralité de la reproduction) qui aujourd’hui se montrent absolument incontournables.
La définition de « spontanéité organisée » émerge des processus de co-recherche issus de la chair vivante des luttes ouvrières des années 1960. Dans la tradition du mouvement ouvrier il y a une division entre le culte de la spontanéité et le fétiche de l’organisation, ou une dialectique des stades de développement : avant il y a la spontanéité, ensuite l’organisation. Alquati casse définitivement cette dialectique et propose cet apparent oxymore : à la Fiat il n’y a pas une organisation extérieure qui produit le conflit, mais ce n’est pas la simple spontanéité qui le pousse en avant. Il s’est créée une sorte d’« organisation invisible » à travers laquelle les ouvriers communiquent, préparent les luttes, dictent leurs rythmes, bloquent les usines, etc. C’est une telle organisation invisible qui se pose comme avant-garde des processus de recomposition, alors que les militants de parti suivent en hésitant, désorientés et faisant souvent fonction de bouchon. La forme de lutte « sauvage » [gatto selvaggio], qui se nourrit justement de l’organisation invisible, est imprévisible, donc pas contrôlable par une médiation réformiste. Elle se met en acte à travers une rotation incessante des tactiques, des méthodes, des temps et des lieux, et elle « ne revendique rien ». Il s’agit du niveau les plus avancé de la « non-collaboration » ouvrière, même si elle n’est certes pas la seule forme de lutte, en s’alternant avec la grève de masse ou le conflit dans les rues. Le problème est comment combiner et relancer ces pratiques, en les renforçant réciproquement. À cet égard, Alquati écrit : « la tâche d’une organisation politique n’est pas de planifier de manière prédéterminée la grève sauvage, car elle courrait justement le risque de la rendre absorbable par le patron, en l’amadouant : elle doit plutôt contribuer à l’intensifier, alors que l’“organisation invisible” ouvrière suffit à l’organiser et à l’étendre. C’est à partir d’elle que la grève “sauvage” devient un état de fait permanent. »
En allant au-delà de la spécificité de ces luttes, la question de la spontanéité organisée nous permet de situer ce rapport dans les bons termes politiques, en distinguant résolument la spontanéité du spontanéisme, qui en constitue l’idéologie, comme il faut bien distinguer l’organisation de la simple gestion. Les termes du rapport ne doivent donc jamais être séparés ou contraposés : il faut alimenter l’organisation avec de la spontanéité et conduire l’organisation au sein de la spontanéité. Nous pouvons dire que l’autonomie est l’organisation qui réfléchit sur sa propre spontanéité et la spontanéité qui réfléchit sur sa propre organisation. Et nous pouvons dire que le parti (de manière radicalement différente de l’usage et de l’idée courants) est le sujet qui recompose continuellement le rapport entre spontanéité et organisation, entre négation et macro-finalités.
Passons à un autre sujet, en partie lié à celui-ci. Toi aussi, dans tes écrits, tu fais souvent référence à la « méthode de la tendance » : en quoi consiste-t-elle précisément ?
Il s’agit d’un aspect central et, plus que d’autres, porteur de beaucoup d’équivoques. Selon certaines figures issues de l’opéraïsme, la tendance a été interprétée en termes toujours plus mécanicistes, comme si la ligne du développement capitaliste nous consignait immédiatement les sujets de la transformation sociale. De cette manière, la composition politique est devenue le fruit de la composition technique, et non plus sa rupture. Ce mécanisme a assumé le nom d’ontologie, en réalisant un renversement tout simplement intellectuel du processus. C’est-à-dire : les sujets produits par le développement capitaliste sont retenus ontologiquement comme des sujets révolutionnaires. Pour boucler la boucle, on a donc refoulé le nœud de la composition de classe, des rapports de force, des processus de lutte à travers lesquels la subjectivité forme sa propre autonomie, en rompant avec le processus de subjectivation capitaliste.
Au contraire, du point de vue révolutionnaire la tendance ne signifie pas objectivité et linéarité du parcours historique, et elle n’a rien à voir avec la prévision du futur. Le pronostic sur les pluies, il convient de le laisser aux météorologues ; en tant que militants nous devons nous engager à créer des tempêtes. Et naturellement, tendance ne signifie pas irréversibilité des processus, c’est-à-dire le dogme à la base de la religion innovationniste et accélérationniste : au contraire, puisqu’ils sont fondés et forgés par des rapports de force, les processus peuvent être continuellement interrompus, déviés, renversés. Tendance signifie donc la capacité à saisir la possibilité d’un développement de contraposition et de diversité radicale dans la composition des éléments du présent. La tendance est comme la prophétie : elle signifie voir et affirmer de manière différente ce qui existe déjà virtuellement dans le présent.
En gros, tendance signifie anticipation : c’est la capacité à saisir le terrain de possibilité antagoniste à l’intérieur des ambivalences et des ambiguïtés de la composition, de la subjectivité et des comportements existants. Tendance signifie pari politique. Le pari n’est pas un lancement des dés, et il n’est même pas une prévision scientifique. C’est le choix d’un parcours, l’identification d’une ligne de tendance qui n’est pas, mais qui pourrait bien être. C’est un pari matérialiste, c’est-à-dire à l’intérieur et contre le champ de forces existant. Sans un pari politique il n’y a en effet pas de politique au sens révolutionnaire, mais simplement de l’administration de l’existant, c’est-à-dire technique de la politique institutionnelle.
Vers la moitié des années 1970, en parlant du problème de la formation et de l’université, Alquati écrivait que la co-recherche sert à avoir un rôle qui ne soit pas de simple « queue » du mouvement : « la recherche est vouée à prévoir, à anticiper, non pas à rationaliser idéologiquement ce qu’il s’est déjà passé au fur et à mesure qu’il se passe spontanément quand le mouvement de masse justement se “met en branle”. Le problème est général : il nous faut de la stratégie qui sert à diriger et de la direction politique qui arrive à anticiper selon une stratégie. Arriver après ne sert à rien ». Le militant doit assumer le risque. L’important est de le mettre en action à l’intérieur et contre la matérialité de l’existant, et non pas – comme trop souvent cela est arrivé avec le soi-disant « post-opéraïsme » – à l’intérieur de la fantaisie individuelle et contre les possibilités collectives.
Poursuivons dans cette direction : aux deux noms les plus connus à niveau international – Mario Tronti et Toni Negri – on peut reconduire deux variantes de l’opéraïsme auxquelles tu as fait référence, une « katechontique » et une « accélérationniste ». À travers des figures comme Romano Alquati ou Sergio Bologna, toutefois, il est possible d’identifier un troisième paradigme théorique et politique à l’intérieur de l’opéraïsme, que nous pourrions définir « compositionniste ». Pourquoi peut-il être important d’approfondir ce projet de recherche ?
C’est à travers ce paradigme (dit compositionniste juste pour que l’on se comprenne, si vous préférez vous pouvez utiliser un autre terme, ce qui compte c’est la substance) que l’opéraïsme a pu rompre avec le système partiellement fermé de la logique marxienne, qui risque de rester piégé dans l’explication de comment la cage d’acier se produit et se reproduit, en introduisant l’élément décisif de la subjectivité. Celle-ci ne se forme pas de manière déterministe par la collocation matérielle, ni en faisant abstraction de cette collocation : comme nous l’avons déjà vu, la subjectivité est liée à la lutte, c’est-à-dire à la puissance formatrice du capital et à la possibilité de comportements et de forces qui se forment contre le capital. Regarder vers la composition de classe, co-rechercher et agir à l’intérieur d’elle pour la plier vers une direction antagoniste, signifie centrer continuellement l’initiative politique sur le rapport entre processus et sujet. Pour le dire de manière simple : dans un processus avec des rapports de force favorables au capital, le sujet qui se forme est tout d’abord forgé par ce déséquilibre ; dans un processus avec des rapports de force différents, il se forme un autre sujet. Dire que le sujet est forgé par le capital, comme dans cette phase, ne signifie pas qu’il n’y a pas de possibilités de conflit ou d’autonomie. Au contraire. Alquati parlait d’un « résiduel irrésolu » et irrésolvable par le capital, ce qu’il appelait « capacité active humaine », dont le capital s’alimente sans cesse pour faire fonctionner son système. Nous pourrions même dire qu’il y a une potentielle asymétrie structurelle entre les deux classes : alors que le capital a besoin du prolétariat, le prolétariat n’a pas besoin du capital, et à la fin il n’a pas besoin de lui-même comme produit de ce rapport social. Voilà la contradiction irrésoluble pour le capital, la source dont dérive la possibilité permanente de l’antagonisme, qui assume chaque fois des formes et des expressions différentes, ou dans certaines phases n’assume pas des formes et des expressions explicites.
L’antagonisme ne peut pas être attendu de manière messianique, ni imaginé à partir de ce que nous aimons – avec le résultat que quand les prolétaires se comportent comme nous le voudrions, nous pratiquons des fuites en avant individuelles ou intellectuelles. Les militants doivent creuser dans les ambivalences et dans les ambiguïtés, dans la « saleté » des comportements réels : non pas pour les exalter de manière populiste, mais pour chercher en eux une politicité au niveau de leurs formes et de leurs expressions intrinsèques, quand on est en présence d’une virtualité pas encore transformée en acte collectif. Par exemple, avant de devenir une forme explicite et collective de contraposition et de négation, le refus du travail s’incarne dans des comportements de soustraction fragmentés au niveau singulier. De la politique intrinsèque à la politique explicite il n’y a pas un passage nécessaire de stades de développement. Il y a par contre la construction d’un parcours organisationnel, un parcours de co-recherche, à savoir la force d’un pari militant. Nous pourrions dire que la recherche de la politicité intrinsèque est la recherche de l’espace entre la potentialité abstraite de l’antagonisme et sa forme d’expression ouverte ; c’est l’espace dans lequel les comportements peuvent prendre des directions différentes, voire opposées ; c’est l’espace dans lequel le processus peut concrètement être dévié, plié, interrompu, renversé. C’est, donc, l’espace propre à l’intervention militante.
Le problème, alors, est que le paradigme « accélérationniste » comme celui « katékontique » finissent par assumer la temporalité du développement capitaliste et font dériver de celle-ci la composition de classe et ses possibilités révolutionnaires. Pour le premier paradigme, il faut simplement accélérer le développement de la composition technique pour la transformer en composition politique ; pour le deuxième, il faut retenir les forces de la veille composition politique pour combattre la composition technique. Tous les deux risquent de considérer le développement à un niveau d’abstraction qui perd contact avec le rayon moyen, c’est-à-dire avec le niveau sur lequel s’offrent les possibilités concrètes de la rupture et du renversement. La méthode de la tendance qui nous intéresse par contre, n’a pas affaire à l’identification d’un développement « objectif », mais au fait de poser le problème de l’interruption et de la déviation, c’est-à-dire de l’accumulation de force pour construire des processus de recomposition. Une telle force s’accumule aussi bien dans l’accélération que dans la rétention, selon les phases et les luttes qui déterminent de la résistance ou des poussées en avant. Parce que le point de vue à partir duquel évaluer accélération et rétention est celui de la composition de classe, de son autonomie potentielle et de ses possibilités de transformation révolutionnaire.
Dans le cas de l’accélérationnisme de Negri, au contraire, la tendance devient téléologie, alors que le processus d’organisation, de conflit et de rupture intérieur au rapport entre composition technique, composition politique et recomposition cède la place à une idée d’immédiatisme du renversement. Negri finit par ne plus voir le processus et par identifier immédiatement le sujet comme ontologiquement libre et autonome. Il ne se rend pas compte que ce sujet n’est pas du tout libre et autonome, mais profondément marqué par la subjectivation capitaliste. Seulement en saisissant l’ambivalence et en la pliant en un sens antagoniste un tel sujet peut arriver à s’opposer à soi-même ; seulement à travers le processus de lutte le sujet conquiert la liberté et l’autonomie. Il y a en ceci un vice intellectuel, propre à qui ne mesure plus ses propres catégories sur la base de la militance dedans et contre la réalité, mais mesure la réalité sur la base de ses propres catégories. À l’autonomie du politique, suit ici l’autonomie de la philosophie politique. Et c’est, peut-être, tristement paradoxal qu’un parmi ceux qui ont parlé d’hégémonie de l’« intellect général », termine son parcours dans la solitude de l’intellect individuel.
Très souvent l’opéraïsme a été accusé de dévéloppementisme…
Une telle accusation est partiellement justifiée, surtout en ce qui concerne l’évolution de celui pour qui la tendance devient téléologie. Je crois toutefois qu’est au moins autant problématique, voire plus problématique, la rhétorique contre le développement qui a pris de l’espace dernièrement, parce qu’elle assume très souvent des traits moralistes et au bout du compte de classe, dans ce cas de l’autre classe. C’est plutôt facile de se dire pour la décroissance en sirotant du cognac depuis son bureau à la Sorbonne… S’il est vrai que toutes les positions contre le développement ne se réfèrent pas à la décroissance, c’est quand même certain que même les meilleures et les plus intéressantes pour les luttes risquent d’être la simple image inversée de leur propre objet polémique. En effet, le développementisme aussi bien que l’anti-développementisme ne saisissent pas la cible et finissent par être idéologiques : le premier imagine les sujets révolutionnaires dans tout ce qui est produit par le développement du capital ; le deuxième les imagine dans tout ce qui précède ou est retenu de façon illusoire en « dehors » d’un tel développement. Une option est tellement « dedans » qu’elle oublie d’être aussi « contre », et elle est ainsi réabsorbée par un réformisme impossible ; l’autre invoque une attaque à l’extérieur de la forteresse, en se confinant dans un spontanéisme irréaliste. Le matérialisme dépourvu de volonté révolutionnaire débouche ainsi sur le déterminisme ; la volonté révolutionnaire dépourvue de matérialisme débouche sur l’idéalisme. Qu’on veuille ou non, nous sommes de toute façon intérieurs au développement et à ses contradictions chaotiques, nous ne pouvons donc avoir qu’un regard conflictuel ambivalent : nous devons comprendre combien de contre-subjectivités et combien de possibilités antagonistes se créent et se détruisent dans le développement, et combien s’en créent et s’en détruisent dans la résistance ou dans les élans qui poussent les processus en avant. Contre-usage des processus signifie non seulement utiliser les moyens produits par le développement pour une autre finalité, mais en faisant cela les plier, les transformer, en créer d’autres. Puisqu’alors être dedans n’est pas une question de désirs individuels ou d’expériences existentielles, mais de la dure matérialité du rapport social qu’on combat, la question est : comment être contre.
En gros, la dialectique entre développementisme et anti-développementisme, accélération et décroissance, modernité et anti-modernité, est entièrement intérieure au point de vue du capital. Le capital se compose d’accélération et de rétention, il détruit la composition de son antagoniste et il en recompose les fragments produits selon ses propres exigences de développement. Le problème, alors, pour le militant est d’organiser le développement du point de vue de notre macro-partie, réelle ou potentielle, pour retenir les éléments qui empêchent l’accélération destructrice de l’innovation capitaliste, c’est-à-dire notre appauvrissement, et pour accélérer les éléments qui produisent des ruptures dans la contrepartie, c’est-à-dire l’enrichissement et l’autonomie de la subjectivité de notre partie.
Pour comprendre ce que peut faire un militant nous pouvons nous référer – pardonnez la brutalité – à la métaphore du cancer. Dans notre corps il faut retenir la force du mal, qui développe le cancer ; dans le corps de notre ennemi il faut accélérer les métastases produites par la lutte de classe. Entre les deux mouvements il subsiste un rapport, qui n’est jamais symétrique, linéaire ou téléologique. Le conflit devrait donc fonctionner comme cancer vis-à-vis de la contrepartie et comme vaccin à notre égard, c’est-à-dire inoculation contrôlée de poison pour renforcer l’organisme. Mais très souvent il se passe le contraire : le conflit devient cancer pour nous, c’est-à-dire source de clivages souvent inutiles, et vaccin pour la contrepartie, donc innovation capitaliste.
Venons-en alors à la figure du militant, à laquelle tu as récemment consacré un essai. Qui est-il, le militant ? Quel est son rôle et son importance ?
De ce qu’on a dit jusqu’à maintenant il devrait déjà émerger des éléments de réponse, car la militance n’est pas un aspect spécifique : c’est notre point de vue, c’est notre forme de vie, ce que nous sommes, ce que nous disons, ce que nous pensons. Le militant est par définition celui ou celle qui met entièrement en jeu sa propre vie. Cette vérité assume des formes différentes en relation à la phase historique, à la composition de classe, aux processus organisationnels. Quand au tournant du millénaire on a commencé à l’appeler activiste, en suivant la mode dominante anglo-saxonne et états-unienne, il ne s’est pas agi d’une simple concession linguistique, mais d’un effondrement structurel. On a ainsi perdu son incommensurabilité par rapport à d’autres figures, comme celle du bénévole. Des figures de l’intérêt général, donc de la reproduction de l’existant. Le militant est au contraire un sujet clivant, il produit continuellement un « nous » et un « eux », il prend position et contraint à prendre position. Il sépare pour recomposer sa propre partie. Il est tout d’abord une figure de la négation, parce qu’il refuse l’existant et il se bat pour le détruire. À partir de la négation, il produit des macro-fins collectives et des nouvelles formes de vie.
Trop souvent, surtout dans des phases difficiles comme celle-ci, nous entendons des camarades se plaindre de l’absence de luttes ou se contenter de celles des autres. Dépression et euphorie miment celles des marchés financiers ; bulles et voyeurisme voyagent et disparaissent au rythme d’un tweet. Et toutefois, les phases historiques ne sont pas belles ou mauvaises : elles sont des moments à l’intérieur et contre lesquels se situer avec une projectualité. Elles ne doivent pas être jugées sur la base de nos désirs, mais combattues sur la base de nos tâches. Au risque autrement de sombrer dans la chronique cyclothymie des luttes et de leur absence, en alternant entre l’euphorie du supporter et la dépression du spectateur, entre un sens immotivé de défaite et des proclamations injustifiées de victoire. Libérons-nous de tout cela, si nous voulons être à la hauteur des défis de la phase. Ou mieux : nous devons comprendre que la phase la plus importante pour le militant révolutionnaire est justement celle dans laquelle il n’y a pas de luttes. Quand elles sont là, en fait, le militant arrive trop tard. Nous devons anticiper pour organiser et diriger, non pas observer pour raconter et décrire. Et nous devrions aussi ajouter que lorsque les luttes sont là, souvent les militants – au moins dans le contexte italien – ne savent pas les comprendre parce qu’elles échappent à leurs schémas, ou parce qu’ils font fonction de bouche-trou par rapport à leur développement. Alors, nous ne laissons pas déprimer par un panorama plat ou fasciner par les vagues de la mer en tempête, mais cherchons par contre à saisir les tourbillons invisibles qui s’agitent au-dessous du calme apparent de la rivière. C’est celle-ci la tâche de nos jours, notre que faire à construire.
Venons maintenant aux catégories forgées par le post-opéraïsme, qui comme tu l’as observé risquent souvent de conduire à une fausse immédiateté de la traduction de la composition technique dans la composition politique…
Nous devons nous débarrasser définitivement de l’idéologie du post, qui à partir des années 1980 et 1990 et pour trop longtemps nous a tenaillés dans l’étau d’un chantage : le choix entre dire que rien ne sera jamais plus comme auparavant, et dire que tout restera toujours comme jadis. Tous les deux se trompent. Pour reprendre encore les outils conceptuels du « modellone » d’Alquati, nous pouvons dire qu’à propos des niveaux supérieurs de la réalité (l’accumulation de domination et de capital) rien n’est changé ; sur les niveaux intermédiaires de réalité il y a eu des mutations significatives ; sur les niveaux inférieurs de réalité les choses changent rapidement. Pour saisir permanences et changements il faut de la recherche, comprendre où les choses varient et pourquoi, et quels espaces de possibilités antagonistes s’ouvrent. L’idéologie du post a en revanche prétendu nous raconter un nouveau monde, un monde toujours nouveau ; mais ce qui est raconté est le monde de la rhétorique de l’innovation, c’est-à-dire la véritable rhétorique du capitalisme contemporain. Une rhétorique qui organise une matérialité concrète, celle comme nous l’avons vu de la contre-révolution capitaliste.
En assumant l’idéologie du post, une partie de ceux qui ont revendiqué le legs opéraiste a imaginé la classe (terme qui pendant une certaine période a été abrogé par décret) comme objectivement relative aux transformations réelles ou supposées du capital. C’est-à-dire qu’a été refoulé le nœud de la composition de classe, du processus politique de contre-subjectivation et de sa transformation. A été refoulé le nœud de la rupture avec le capital intérieur à la composition de classe. Non plus la classe contre elle-même, mais une classe qui, comme par magie, est devenue autonome et qui doit simplement être reconnue dans son autonomie. Il n’y a plus besoin de rompre avec le capital, mais il suffit de pratiquer l’exode (paradoxalement, même des positions – très répandues en France – qui se sont fortement caractérisées par la critique et l’opposition à Negri, finissent de temps en temps par arriver à des positions similaires). Même si elles sont nées du refus du travail, certaines pointes du soi-disant « post-opéraïsme » ont paradoxalement fini par donner vie à une sorte de travaillisme immatériel et cognitif, là où elles ont perdu de vue la différence fondamentale entre les compétences capitalistes et les savoirs de notre partie, entre la valorisation et l’autovalorisation, entre la richesse de l’accumulation et celle des luttes. Le problème, justement, dérive de l’idée d’une coopération déjà libre et par rapport à laquelle le capital est un agent parasitaire, alors que le travail serait devenu commun – chose qui peut être vraie, si l’on ajoute que c’est le commun de l’exploitation et du travail abstrait commandé par le capital.
Quant à la définition même de « post-opéraïsme », elle a été forgée dans les universités anglo-saxonnes et américaines, comme une tentative de capturer la puissance de l’opéraïsme, de le dépolitiser et de l’abstraire du conflit et de la composition de classe. Pour le rendre, donc, bon pour l’académie et l’économie politique de la connaissance, c’est-à-dire pas bon pour les luttes. Ensuite il est devenu « Italian Theory », qui se distingue de l’« Italian Thought », et ensuite il y aura la « Critical Italian Theory » et puis le « Critical Italian Thought » et ainsi de suite vers le mauvais infini : une théorie détachée de la composition et de la lutte de classe, mais fermement accrochée à la valorisation et à la reproduction du capital – et des colloques et chaires universitaires.
Cet ensemble de théorisations et d’analyses qui a été saisi par la définition académique de « post-opéraïsme » s’est développé entre les années 1980 et 1990 dans la tentative de renverser les images annihilantes – et entre elles spéculaires – de la fin de l’histoire et de la pensée unique. La cible polémique était et reste correcte, le développement pratique ne l’est pas toujours. Certains efforts conceptuels étaient problématiques dès le début, pour les raisons auxquelles nous avons fait référence de manière schématique – et tout d’abord l’idée que la composition politique descende automatiquement de la composition technique. D’autres ont été extrêmement productifs et ils peuvent encore l’être, s’ils sont repensés à l’intérieur des mutations intervenues avec la crise et l’épuisement d’un modèle général. Dans ce cas, recommencer depuis le début ne signifie pas retourner en arrière. Le post-opéraïsme signifie, en d’autres termes, courir le risque d’ossifier les catégories, de les transfigurer en des dogmes, de transformer l’opéraïsme en ce qu’il n’a jamais été : une école et non un mouvement de pensée. Il signifie, en deuxième instance, donner de l’espace à des opérations agaçantes d’attaque dirigée vers tout un échafaudage théorique révolutionnaire. Il s’agit d’opérations certes négligeables, mais qui risquent de déplacer le débat sur la défense des concepts au lieu de réfléchir à leur utilité pour les luttes. Elles risquent donc de tout entraîner dans la marginalité politique. Dans un récent séminaire politique un camarade a justement observé qu’un gars ne se barre pas de la maison quand les parents le chassent, mais quand il n’en peut plus. Voilà, sans aucune peur nous disons qu’une certaine maison aujourd’hui est improductive pour nos tâches révolutionnaires et nous essayons de réaliser le mouvement originaire qui fut propre à l’opéraïsme par rapport à Marx : le retour machiavélien aux principes, c’est-à-dire à Marx, contre le marxisme. Or, la tâche est de retourner à l’opéraïsme, peut-être non pas contre mais certainement de manière critique par rapport à ce qui dans le « post-opéraïsme » ne marche plus, ou n’a jamais fonctionné. Si nous le faisons, nous serions dans la condition de ne pas jeter ce qui nous est utile, et de repenser à la racine tout le reste.
Par exemple capitalisme cognitif, vis-à-vis des processus de stratification et d’industrialisation du travail, est-ce une catégorie valable ?
Nous avons toujours préféré parler de cognitivisation du travail, d’un côté pour différencier ce phénomène de manière résolue de l’étrange catégorie de « travailleur immatériel », de l’autre pour insister sur les processus de réorganisation et de hiérarchisation globales des formes de la production et de l’exploitation dans une phase dans laquelle les savoirs deviennent toujours plus centraux dans l’accumulation du capital. Cela permet d’éviter tout d’abord de glisser dans l’identification entre travail cognitif et sujets définis en un sens sectoriel, c’est-à-dire l’opposition entre travailleurs manuels et travailleurs intellectuels. Mais cela évite aussi d’imaginer la pointe supposée la plus avancée de la composition technique (les knowledge worker) comme la pointe la plus avancée des luttes. Donc, toute idée d’une linéarité progressive doit être combattue : congitivisation du travail signifie aussi cognitivisation de l’exploitation et de la mesure, cognitivisation des hiérarchies, cognitivisation des tâches.
Comme tu l’as souligné, la crise économique globale a en plus accéléré les processus de stratification et de différentiation déjà en cours, en des formes contradictoires et avec des intensités diverses selon les secteurs et les zones du monde. En suivant la trace alquatienne, Salvatore Cominu parle à cet égard d’industrialisation du travail cognitif : compétences, fonctions et professionnalités retenues jusqu’ici inséparables de la personne qui en est le « vecteur » et de la coopération sociale dans laquelle elles se connectent, sont maintenant soumises à des processus de subsomption réelle – dans la production de biens et contenus, de services, dans les temps de la consommation, de la reproduction, etc. Il s’agit, à la fois, d’expropriation des savoirs et de renforcement de leur forme combinée, comme cela a toujours été le cas avec le système industriel : mais il s’agit d’un renforcement de l’accumulation du capital, qui de façon ambivalente élargit la coopération sociale et bouffe les capacités humaines, en les incorporant dans le marxien système automatique des machines. À l’intérieur de la cognitivisation du travail, l’homo faber est donc devenu sapiens et l’homo sapiens est devenu faber. Cognitivisation et banalisation procèdent, au moins partiellement, ensemble.
Sur ces bases, en développant les recherches sur l’université conduites par Alquati dans les années 1970, nous avons parlé de savoir vivant pour définir de manière historiquement déterminée la nouvelle qualité du travail vivant, c’est-à-dire son incorporation tendancielle du savoir social. Il ne s’agit pas, en effet, de mettre simplement en évidence le rôle central assumé par la connaissance et la science dans les formes de la production et de l’accumulation contemporaines, mais de se concentrer justement sur leur socialisation et leur incarnation dans le travail vivant. Cette socialisation, dans les années 1970, est advenue sous la poussée des luttes, du refus du travail, de la réappropriation et de l’autonomie ouvrières. C’est ça l’ouvrier-social : figure politique et non technique. Aujourd’hui, quarante ans plus tard, les rapports de force se sont renversés : la socialisation advient tout d’abord de manière contrainte, à partir des exigences du capital. Le savoir en effet n’est pas en soi bon ou neutre, comme pas mal de gôchistes [sinistri] le pensent : il est le fruit d’un rapport de production, donc d’un rapport de conflit et de force. De l’ouvrier-social à l’ouvrier-cognitif, le sujet s’incarne techniquement, il se désincarne politiquement. L’ouvrier-social est ainsi transmué en acteur de l’innovation et de la précarité : il a continué à être social, il a arrêté d’être ouvrier.
C’est d’ici que nous devons repartir, dans et contre le présent. Notre hypothèse, en forçant et en simplifiant à la fois, est qu’aujourd’hui dans la crise la recomposition entre couche moyenne déstructurée et prolétariat hiérarchisé par les processus de « cognitivisation » et de reproduction de la capacité active humaine pourrait être l’équivalent fonctionnel de l’alliance entre ouvriers et paysans dans la crise d’il y a un siècle. Nous disons « pourrait », car, bien évidemment, le fait qu’elle le soit ou pas dépend de nous, d’un nous potentiel, d’un nous non limitable à ce que nous sommes effectivement. Si nous n’avons pas cette capacité, de telles figures seront le combustible d’options réactionnaires, ou en tout cas elles se reproduiront en tant que fragments produits par le gouvernement de la crise. Aujourd’hui plus que jamais nous devons donc savoir nous mouvoir avec un point de vue unilatéral à l’intérieur de l’ambiguïté des processus, avec une extrême flexibilité tactique et une dure rigidité stratégique : mieux vaut la saleté du réel que la pureté de l’idéologie ; mieux vaut disputer les territoires sociaux à la droite matérialiste conflictuelle que catéchiser la veule gauche idéaliste ; mieux vaut donc les problèmes de la co-recherche militante que l’inutile sûreté des selfies ou des posts des activistes. Pour employer les mots du poète, là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve.
Justement à cet égard, une double question : le centenaire de la révolution d’Octobre a été célébré de diverses façons l’an dernier… Je te demanderais donc de quelle manière l’opéraïsme s’est approprié Lénine et de quelle manière réfléchir sur l’expérience léniniste peut encore être utile de nos jours ?
La réponse nécessiterait pas mal de temps et d’espace. Je renvoie pour cela à un pamphlet récemment publié par DeriveApprodi, Il treno contro la Storia. Considerazioni inattuali sui ’17 (Le train contre l’Histoire. Considérations inactuelles sur les 17) – histoire de couper court ici !
Un Winston Churchill désespéré observa : « ce fut avec un sentiment d’effroi que [les chefs militaires allemands] tournèrent contre la Russie la plus affreuse de toutes les armes. Ils firent transporter Lénine, de Suisse en Russie, comme un bacille de la peste, dans un wagon plombé ». Laissons de côté la version selon laquelle ce fut un calcul de l’Allemagne de consentir à ce que le dirigeant bolchévique ait pu rentrer à Petrograd. Concentrons-nous plutôt sur celui qui a fait sauter la banque, quelle qu’elle soit. Churchill involontairement nous fournit ainsi une extraordinaire définition de ce que c’est le militant révolutionnaire : « un bacille de la peste ». Et comment organiser le bacille de la peste est d’emblée le casse-tête de Lénine. Marx nous a consigné le mécanisme de fonctionnement de la machine capitaliste, le problème – qui reviendra avec l’opéraïsme, et que nous devons toujours avoir en tête dans la pratique militante – est de ne pas rester piégé dans un tel mécanisme, de casser toujours son cercle fermé. Où frapper, comment diffuser la peste, de quelle manière et à quels niveaux détruire l’ennemi ? Partir non pas des lois de mouvement du capital, mais des lois de mouvement de la classe ouvrière à l’intérieur et contre la société capitaliste : voilà à la fois la continuation et le renversement léninien de Marx.
Le Lénine transmis par le léninisme, historiciste et objectiviste, fidèle aux stades de développement, est un pur mensonge et il est complètement à oublier. Dans tout son parcours Lénine tente continuellement de forcer, d’interrompre et de renverser le développement du capital, c’est-à-dire d’imposer la volonté révolutionnaire dans et contre l’Histoire. Aux temps de la polémique contre les populistes russes, Lénine ne dit pas que le développement du capitalisme en Russie est une donnée de fait. La bataille conduite par les narodniki révolutionnaires a été perdue, mais la guerre est encore à mener. C’est à partir de cela qu’il faut rechercher des nouvelles formes d’expression de la subjectivité révolutionnaire, et construire des formes adaptées d’organisation. Voilà le pari de Lénine : le prolétariat industriel qui semblait un « petit coin » aux populistes de l’époque (des pâles copies qui ont trahi le legs du populisme révolutionnaire), est en tendance la première ligne, « l’avant-garde de toute la masse des travailleurs et des exploités ». Cette tendance est-elle destinée à se réaliser par les inéluctables lois du mouvement du capital ? Ne plaisantons pas. Seule la lutte décidera de son destin. Quant aux autres, qu’ils restent emprisonnés dans la gestion des fallacieuses certitudes du présent. Il faut choisir, il faut parier, il faut oser : « qui veut représenter n’importe quel phénomène vivant dans son développement doit inévitablement et nécessairement affronter le dilemme : soit devancer les temps, soit rester en arrière ». Il n’y a pas de voie moyenne, déclare-t-il. Et c’est ainsi qu’en 1905 et ensuite en février 1917 il existe une attitude consistant à imaginer que ces événements sont des révolutions bourgeoises et que les prolétaires doivent attendre leur tour, c’est-à-dire qu’ils doivent attendre que ce soit le développement historique et non pas la lutte qui mette dans leurs mains le socialisme et ensuite le communisme : pas du tout ! Il faut être à l’intérieur du mouvement révolutionnaire, en casser la linéarité, le diriger vers d’autres finalités. Il faut sauter les stades de développement, dresser la puissance du possible contre la misère de l’objectivité. C’est seulement ainsi qu’on peut faire la révolution contre Le Capital, en cassant le cercle vicieux de Marx.
Parce que les révolutionnaires – c’est le grand enseignement léninien – doivent toujours être préparés pour l’occasion, sans penser que celle-ci tombe du ciel et transcende la matérialité des dynamiques historiques, de la continuité organisationnelle et de la patiente construction de rapports de force. L’essentiel est de créer avec méthode les conditions de possibilité pour conquérir l’occasion, pour la saisir. Il s’agit alors de penser le rapport entre processus et événement, c’est-à-dire entre durée et saut, de manière complètement différente, en assumant que la simple continuité du processus sans la discontinuité de l’événement conduit à l’objectivisme, alors que la pure discontinuité de l’événement sans la continuité du processus conduit à l’idéalisme. Voilà comment le dirigeant bolchévique a mis la volonté héritée des populistes révolutionnaires sur les jambes du matérialisme historique, et a soutiré le matérialisme historique de Marx de la cage de l’objectivisme.
S’il faut oublier le Lénine des léninistes, il faut aussi oublier le Lénine des anti-léninistes, qui est au bout du compte le même. Parce que tous les deux réduisent le dirigeant bolchévique à ce qu’il n’a jamais été, c’est-à-dire un gris fonctionnaire de l’organisation. En oubliant que dans son organisation Lénine a presque toujours été en minorité, parce qu’au fond un révolutionnaire est toujours porteur d’une ligne de minorité, une minorité non minoritaire – c’est-à-dire idéologique et de témoignage d’une identité marginale -, une minorité avec une vocation hégémonique. Faut-il rêver ? demande méprisant le comité central du parti, et il répond : oui, il faut rêver, parce que quand il n’y a pas de contraste entre le rêve et la réalité, quand l’on agit de façon matérialiste et tenace pour réaliser son propre rêve, quand il y a contact entre le rêve et la vie, tout va pour le mieux. Des rêves de ce genre, conclut-il, il y en a malheureusement trop peu dans notre mouvement. Alors, hier comme aujourd’hui, il faut reconquérir la capacité de rêver et de donner forme organisée au rêve, voilà en premier lieu le Que faire ? de Lénine. N’en déplaise aux léninistes évolutionnistes et aux anti-léninistes désirants. C’est celui-ci le Lénine qui – en une sorte d’« alquattisme » ante-litteram – critique continuellement tant le culte de la spontanéité que le fétiche de l’organisation. La spontanéité n’est pas toujours bonne et elle n’est pas toujours mauvaise : il y a des moments dans lesquels elle est avancée et des moments dans lesquels elle est arriérée. Dans les phases de lutte ou insurrectionnelles, souvent c’est la spontanéité qui impose un terrain offensif, alors que l’organisation est arriérée et doit être pensée à cette hauteur, sur ce terrain. Dans d’autres phases la spontanéité recule ou est forgée par l’ordre du discours ennemi : l’organisation doit alors rouvrir le chemin au développement antagoniste.
C’est celui-ci, en gros, le Lénine qui, selon des formes différentes, émerge des meilleurs développements de l’opéraïsme (et les 33 leçons de Toni Negri sont très certainement un des ouvrages de référence). La limite est que cette tentative importante de porter Lénine au-delà de Lénine ne s’est pas conjuguée à un plan de réinvention organisationnelle adapté. L’on a ainsi souvent répété ce qui n’était pas répétable, c’est-à-dire les solutions spécifiques de Lénine. Et face à leur faillite inévitable les problèmes posés par Lénine ont toujours été refoulés dans le rapport changeant entre composition de classe et formes de l’organisation révolutionnaire.
Une dernière question : de quelle manière, alors, étudier aujourd’hui le passé pour modifier le présent, ou, encore, produire de la théorie afin d’organiser les luttes ?
Pour conclure, en poursuivant ce que j’étais en train de dire, je voudrais qu’une chose soit ultérieurement claire. Le passé ne nous enseigne jamais ce qu’il s’agit de faire au présent. Il nous consigne en revanche les erreurs à ne pas répéter, les limites à dépasser, les richesses à réinventer. Il nous consigne des questions, non pas des réponses. Et il nous consigne ce que nous devons venger. Mais le comment, cela fait partie de l’effort et des parcours propres à chaque génération militante. Ainsi, si nous voulons nous approprier un legs politique, nous ne devons pas le célébrer en le transformant en une vide identité testamentaire : nous devons l’enflammer, en le transformant en une arme contre le présent. Autrement cela ne sert à rien. L’opéraïsme, et Marx ou Lénine sont pour nous un style et une méthode politique partiaux ; ils ne sont pas ceux de la philologie académique, ou des catéchismes post-opéraïstes, marxistes et léninistes, que nous pouvons jeter à la mer sans verser une seule larme. En somme, le problème pour le militant est de s’approprier la tradition sans les cultes révérenciels et sans l’hypostasier : en repensant les richesses, en critiquant les limites, en dépassant ce qui n’est pas utilisable. C’est ainsi qu’a fait Lénine avec Marx (et aussi avec les populistes révolutionnaires) ; c’est ainsi qu’ont fait les opéraïstes avec Marx et Lénine ; et c’est ainsi que nous devons faire nous-mêmes avec eux. Même en nous appropriant ce qui est utile de la pensée des ennemis : pour le dire avec Tronti, en fait, mieux vaut un grand réactionnaire qu’un petit révolutionnaire.
Voilà alors pourquoi c’est un problème qu’au niveau international l’opéraïsme soit réduit au post-opéraïsme, et surtout au Negri d’Empire. Non pas pour une question de propriété intellectuelle ou de brand : la dispute autour de l’héritage notarial nous la laissons volontiers aux familiers des décédés, ce qui nous intéresse est l’utilisabilité politique. Et c’est justement cette réduction qui prive beaucoup de militants de la possibilité d’explorer l’Atlantide submergée de figures comme Alquati, d’utiliser donc des armes qui sont aujourd’hui plus indispensables que jamais.
En général, cette méthode révolutionnaire nous a enseigné que nous avons besoin d’étudier ce que nous voulons détruire : le capitalisme, et le capitalisme qui s’incarne en nous. Qui tombe amoureux de son propre objet d’analyse, pour pouvoir reproduire les rôles acquis dans cette société, abandonne la militance et passe au camp ennemi. Il ne vaut même pas la peine de crier à la trahison ; il s’agit tout simplement d’incapacité à rompre la séparation avec sa propre condition. Il a choisi le chemin individuel, et il mourra tout seul. Ce qui distingue le militant est la haine envers ce qu’il étudie. Le militant a besoin de haine pour produire du savoir. Beaucoup de haine, étudier à fond ce que l’on déteste le plus. La créativité militante est tout d’abord science de la destruction. Donc, la pratique politique est imprégnée de théorie, ou elle n’est pas. Il faut étudier pour agir, il faut agir pour étudier. Et il faut faire les deux en concomitance. Maintenant plus que jamais : voici notre tâche politique.
Et il nous faut de la formation à la méthode : c’est ici que la subjectivité se construit de manière dure et non éphémère, en conquérant un mode de penser et de raisonner non standardisé, capable donc de construire de façon autonome des réponses adaptées à des situations différentes, à même de modifier avec flexibilité les hypothèses et les comportements à partir de la rigidité des fins collectives. Méthode de raisonner commune, changement et mise en discussion des procédures spécifiques à travers lesquelles cette méthode s’exprime : voilà le problème de la formation autonome, qui ne peut pas être confiée uniquement aux individus singuliers, mais qui doit être organisée collectivement.
Formation pour quoi ? Pour reconquérir la capacité à parier. Oui, parier. Un pari matérialiste, un pari révolutionnaire. Parier sur la possibilité de transformer la crise capitaliste en crise révolutionnaire ; et même avant, de transformer la crise de la subjectivité en urgence d’un bond en avant. N’émulons pas ce qui a été, ce serait grotesque : étudions-le, pour le plier à nos fins. L’autonomie est en effet la disponibilité incessante à subvertir ce que l’on est pour détruire et renverser l’existant. Elle est la construction d’une perspective collective de puissance et de possibilité à partir de la libération et de la transformation radicales des éléments du présent. Voilà pourquoi l’autonomie vit dans la méthode révolutionnaire, et non pas sur les logos du merchandising antagoniste. Alors, oser parier, oser agir, oser faire la révolution. N’est-ce pas pour cela que nous vivons ?
Entretien réalisé par Davide Gallo Lassere