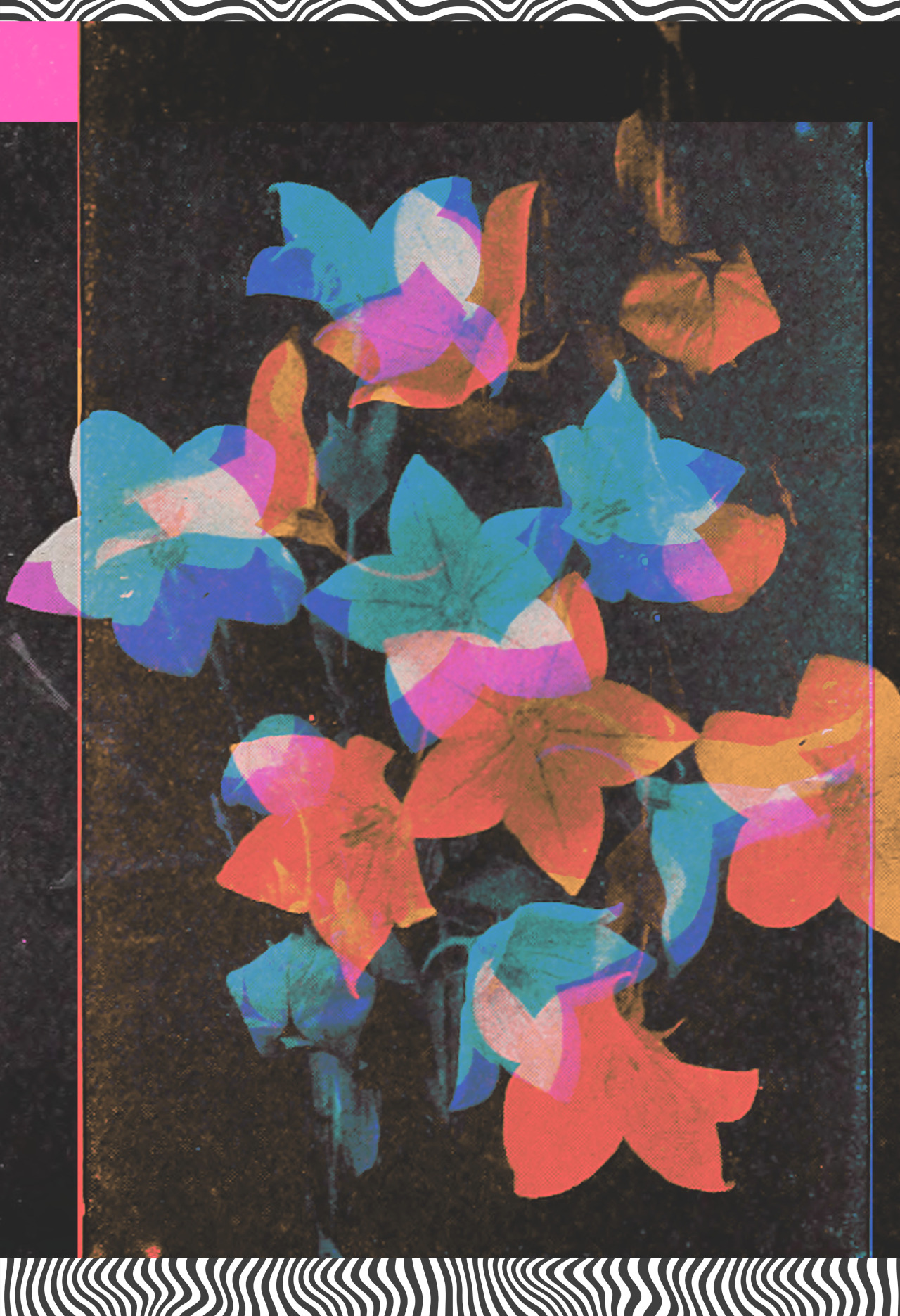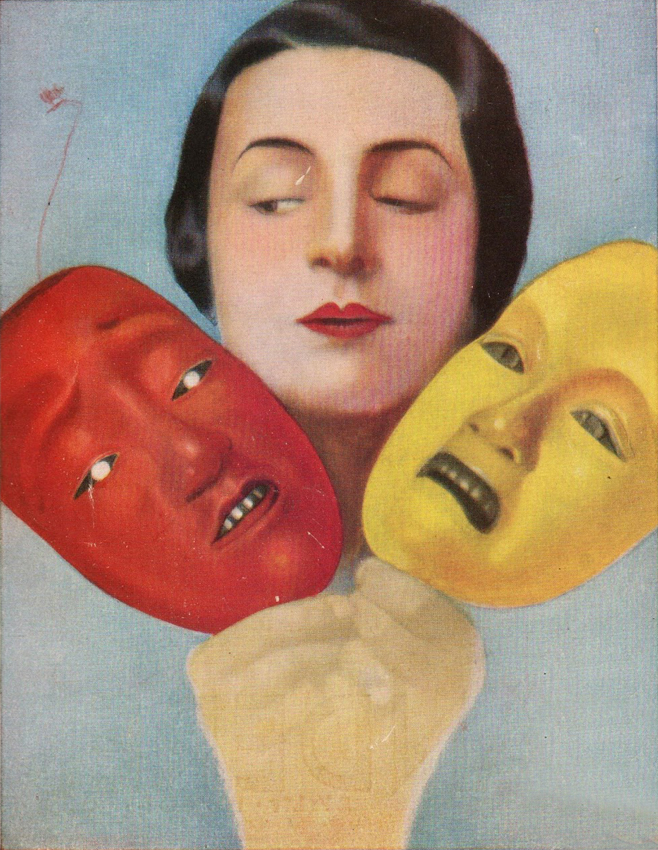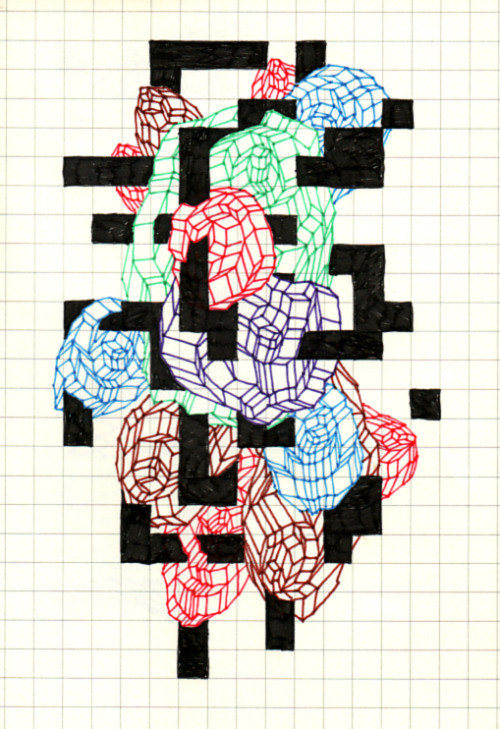Droit et colonialité : entretien avec Brenna Bhandar
Les théories critiques du droit manquent d’une perspective globale sur le capitalisme contemporain. Symétriquement les traditions marxistes ont rarement abordé le droit dans toute son épaisseur. C’est à ce point de croisement délicat que se situent les travaux de Brenna Bhandar (Université de Londres, SOAS), qui aborde dans cet entretien les rapports entre colonialisme et capitalisme, et le besoin d’interroger le droit pour saisir leur efficace sociale. Si les études post-coloniales et autochtones expriment aujourd’hui un souci récurent pour la matière juridique, elles sollicitent tout autant le renouvellement des approches marxistes du droit, afin de cerner les territoires du capitalisme contemporain où s’affrontent « colons » et « natifs » mais qui demeurent pourtant hors d’atteinte de la critique.