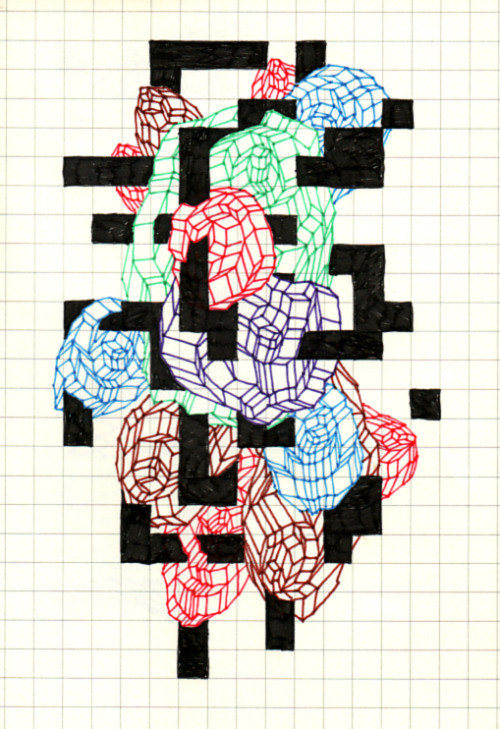Une longue révolution : entretien avec Raymond Williams
Dans ce long entretien accordé à la rédaction de la New Left Review, Raymond Williams revient sur ses contributions fondamentales au marxisme en général et à la théorie de la culture en particulier. Qu’il s’agisse de penser le rapport entre pratiques artistiques et pratiques économiques, de reconstruire la « structure de sentiment » d’une époque ou de conceptualiser la manière dont les structures sociales s’articulent en une totalité, l’œuvre de Williams ne constitue pas seulement une interprétation pénétrante du présent historique : elle est une ressource précieuse pour sa transformation.