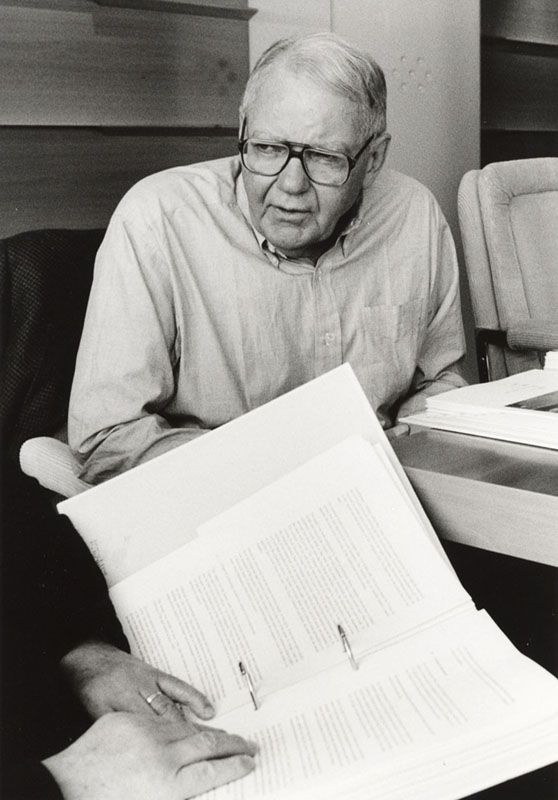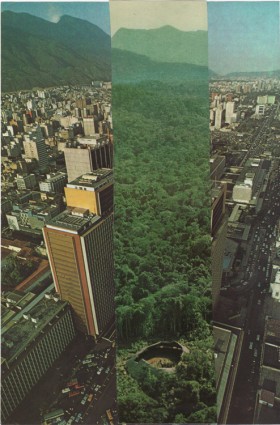Karl Marx, critique de la modernité bourgeoise
La critique du capitalisme se trouve régulièrement appauvrie, sous le poids du sociologisme, de l’économisme ou de tout académisme. Dans le droit fil du philosophe marxiste Bolívar Echeverría, l’économiste Andrés Barreda Marín propose un retour radical au moment critico-théorique de Marx, comme critique de la totalité des rapports sociaux. Contextualisant les apports marxiens, l’auteur les présente comme une méditation sur la défaite de l’expérience révolutionnaire, utopique, sur les errements de la critique romantique et sur les impasses du mouvement spéculatif hégélien. Il en sort un Marx qui n’est plus amputé de ses antécédents conspiratifs, blanquistes, ou poétiques mais qui émerge au contraire comme une autocritique révolutionnaire de la longue tradition en lutte contre la modernité bourgeoise.