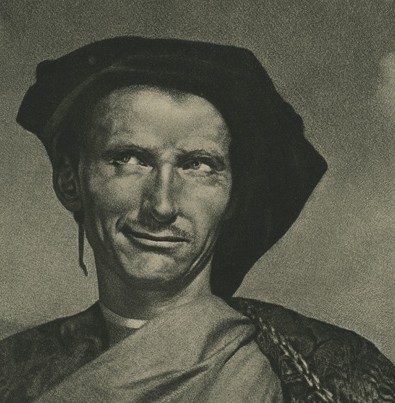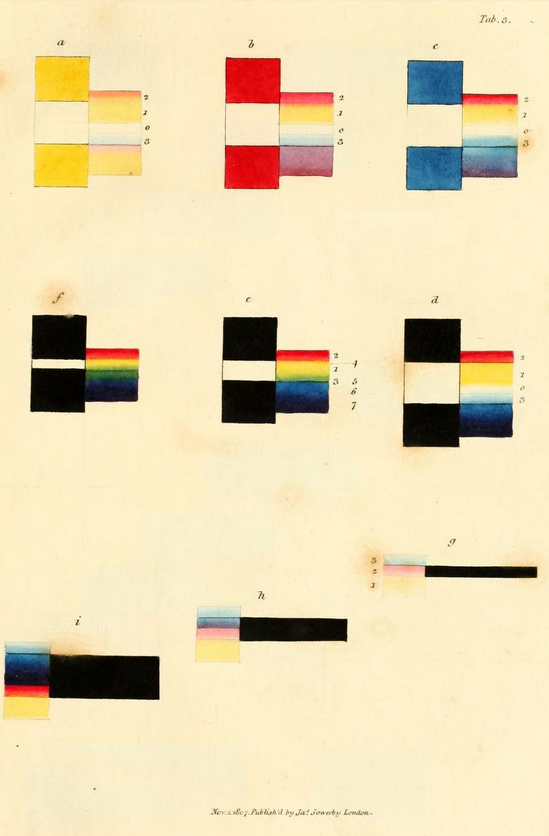Au-delà de « l’écosocialisme » : une théorie des crises dans l’écologie-monde capitaliste
Wall Street produit et organise la nature. Si la théorie sociale cherche aujourd’hui à s’amender en tenant compte des enjeux environnementaux, elle dépasse rarement le dualisme typiquement moderne de la Nature et de la Société. Dialoguant avec les théoriciens de l’écosocialisme d’une part et des penseurs critiques tels que Harvey et Arrighi d’autre part, Jason W. Moore formule ici l’hypothèse que le capitalisme n’est pas seulement une économie-monde mais également une écologie-monde.