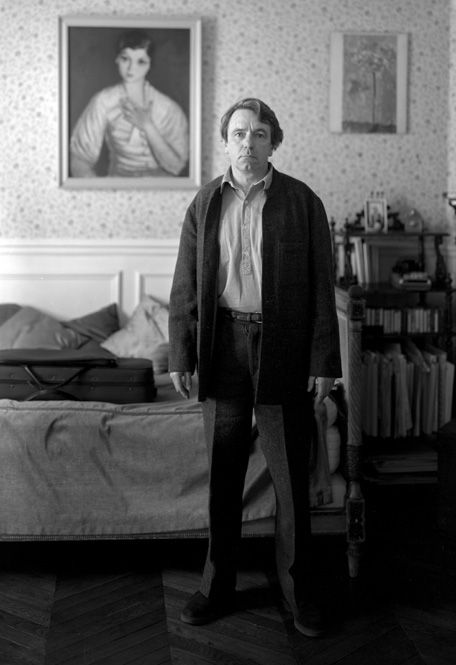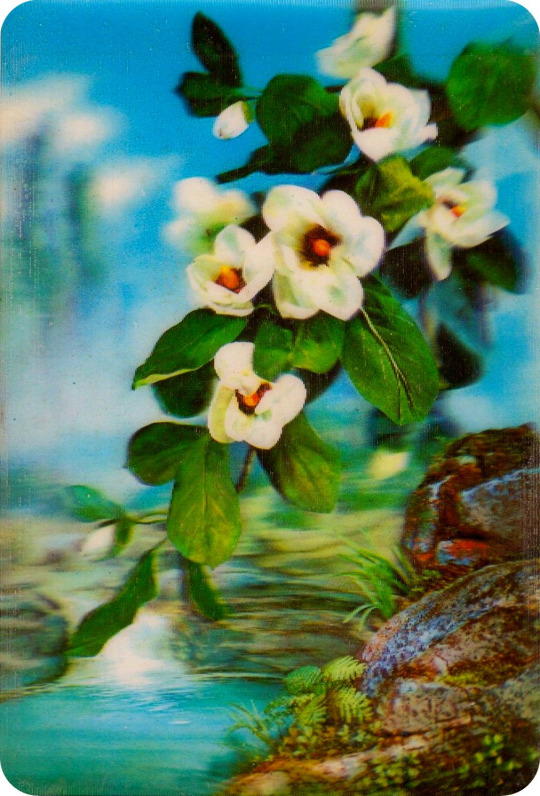Littérature, fiction, vérité : Morozov, Rancière, Foucault.
L’omniprésence du storytelling en politique est désormais un fait établi. La montée en puissance du thème du populisme de gauche en est un avatar au sein des forces liées au mouvement ouvrier. Pour Jean-Jacques Lecercle, cette évolution risque de subordonner la politique à la mythologie, c’est-à-dire à une fiction dogmatique. Pour déployer pleinement les ressorts du mythe, il propose l’analyse magistrale d’un fait divers devenu mythique en Union soviétique, l’histoire de Pavlik Morozov, enfant de koulak assassiné par son grand-père aux heures sombres de la collectivisation forcée. Démêlant toutes les versions du récit, Lecercle souligne notamment les limites du discours historien. Dans le sillage de Rancière et Foucault, il avance une thèse paradoxale : seule la littérature peut rendre justice à un personnage ordinaire, sans histoire, comme celui de Morozov. Seule la fiction littéraire peut reconstruire un récit « vrai » de l’existence individuelle d’un « infâme » en dehors du pathos tragique. Et « il n’y a au mythe qu’un seul antidote : non la science, non l’histoire, non la politique ou le droit, mais bien la littérature. »