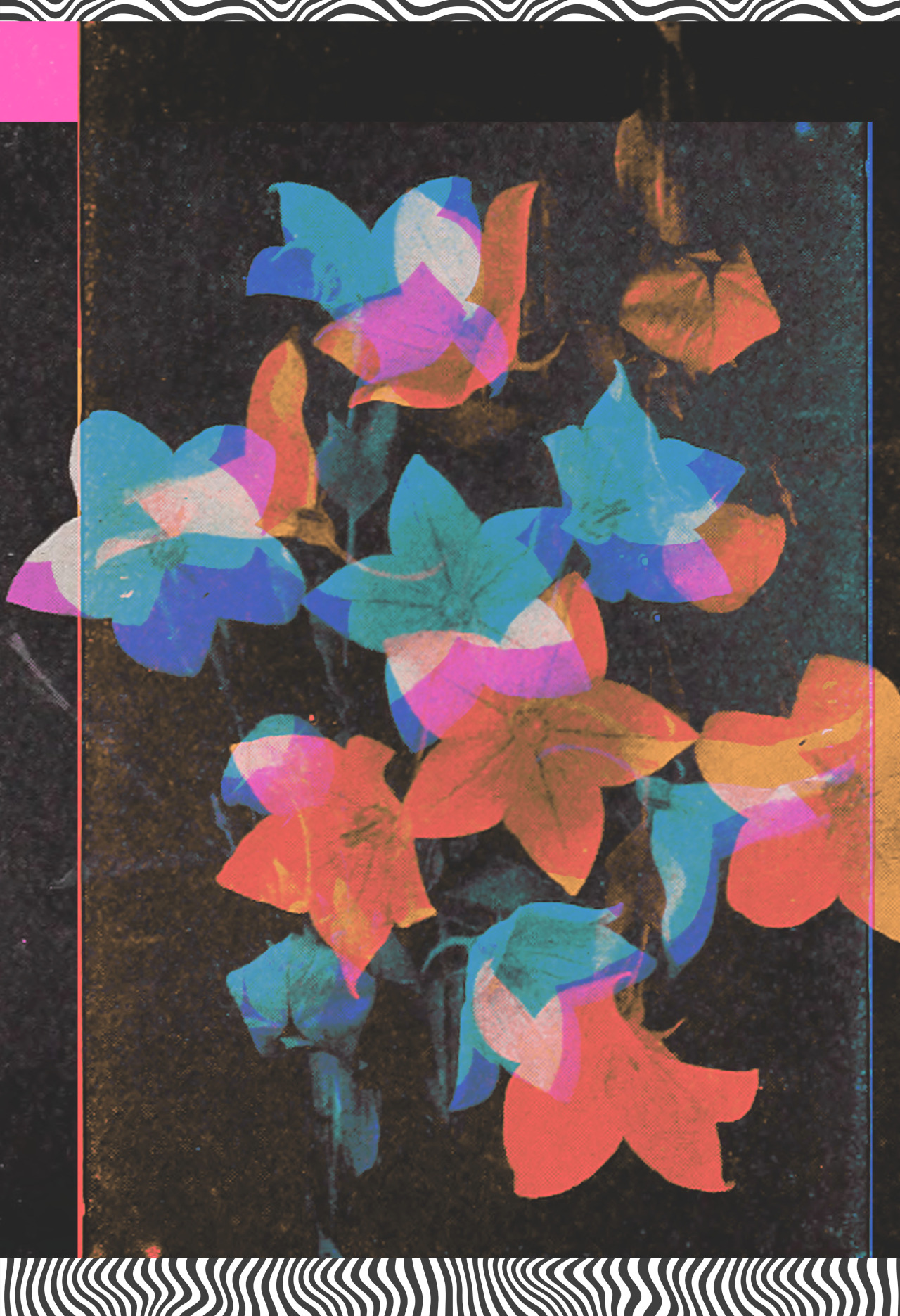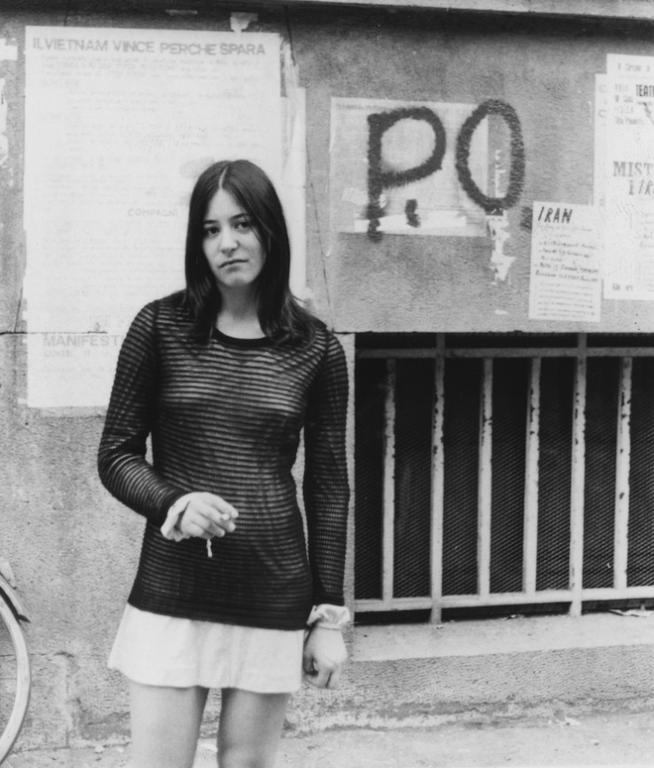Le concept de révolution chez Georges Labica
Quelle place accorder aujourd’hui au concept de « révolution » dans la théorie et la pratique marxistes ? À cette question, nous dit Stathis Kouvélakis, Georges Labica (1930-2009) n’aurait pas manqué de répondre : « la place centrale ». Pour ce fervent lecteur de Lénine et Robespierre, et acteur de la révolution anticoloniale algérienne, la révolution combine trois aspects (que ses contemporains, de Negri à Badiou, auront désarticulés) : elle est événement fondateur, produit d’une longue maturation politique-stratégique et création d’un pouvoir de type nouveau. Mais si la pensée de ce théoricien de la révolution comme invention permanente est intempestive, c’est d’abord parce qu’elle touche aux interdits qui pèsent de nos jours sur la gauche, toutes tendances confondues, en mettant en exergue la violence inhérente à toute irruption démocratique et en soulignant (depuis son ouvrage de 1965 sur Ibn Kaldoun) le rôle du politico-religieux dans la transformation de l’ordre existant.