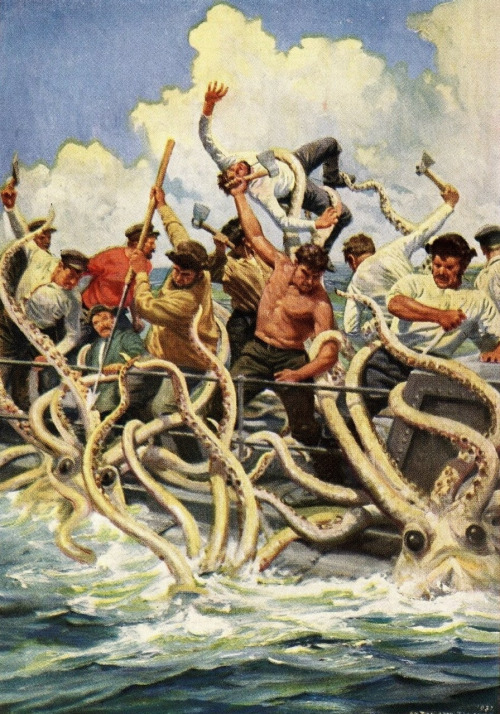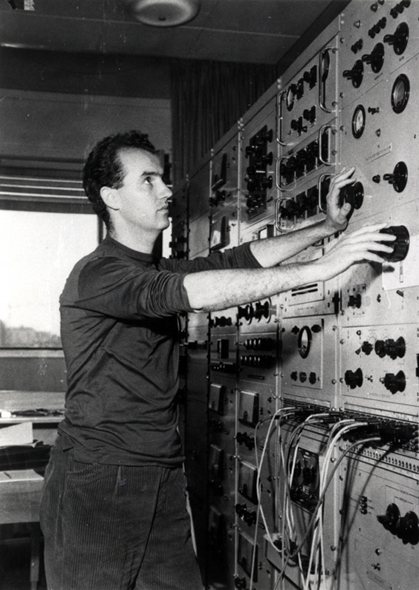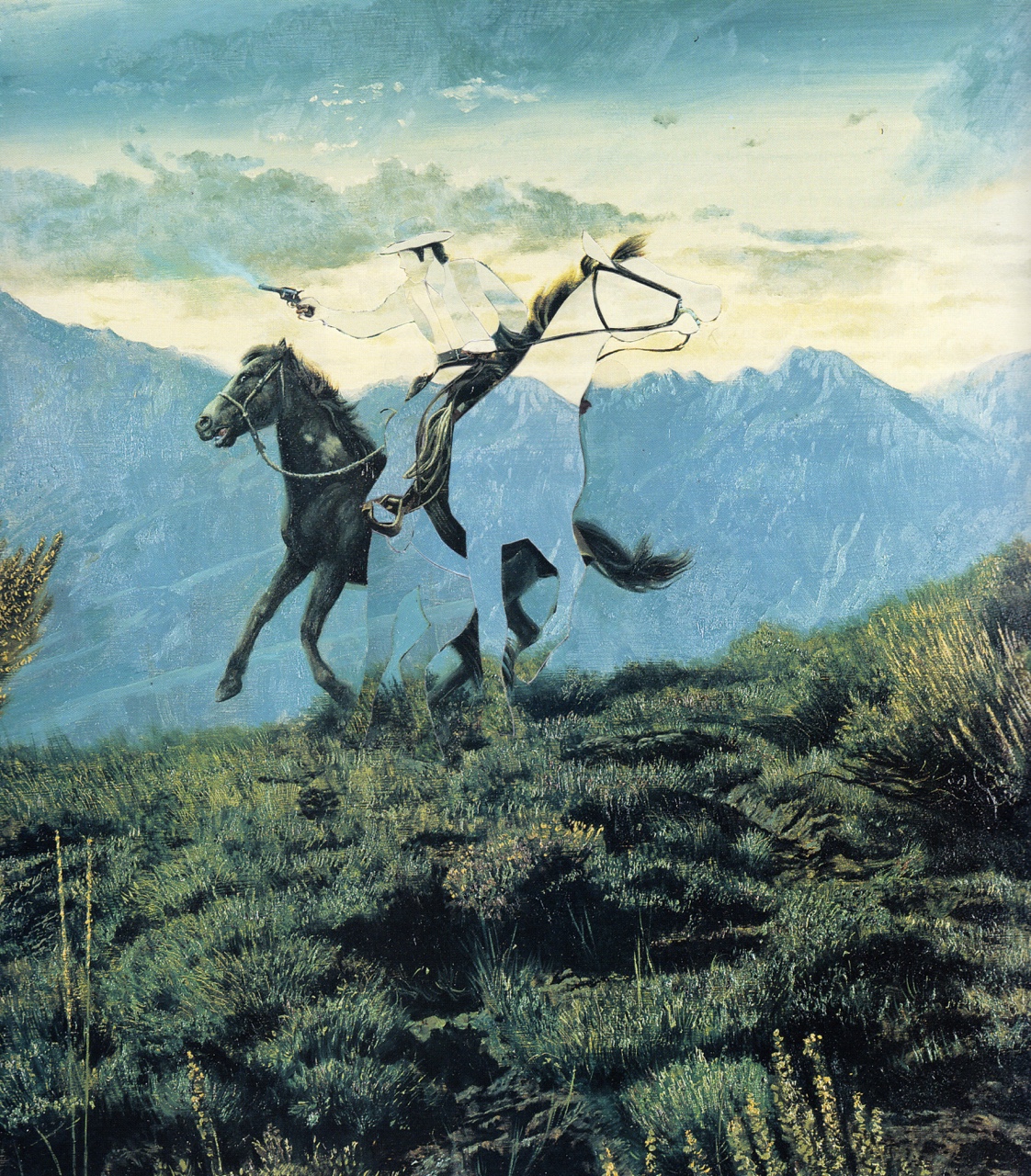Le container et l’algorithme : la logistique dans le capitalisme global
La mondialisation capitaliste est souvent envisagée comme une extension considérable des échanges à l’échelle mondiale, accompagnée par une importante dérégulation et liberté de circulation des capitaux et des marchandises. Cette nouvelle séquence a un envers technologique aujourd’hui incontournable : le développement des industries logistiques. Ainsi, quand on parle de « capitalisme de l’information », il ne faut pas seulement se figurer la prégnance du « travail immatériel », mais aussi tout un réseau d’infrastructures, coordonnées de façon complexe, qui articulent production, circulation et consommation en temps réel. Dans ce texte, Moritz Altenried présente ces nouveaux dispositifs, et livre une image du capitalisme aux antipodes du fantasme d’une production dématérialisée, d’un avenir sans travail et sans travailleurs. Si la logistique moderne a été un puissant moyen d’écraser le monde du travail, elle est peut-être aussi un terrain crucial des luttes d’aujourd’hui et de demain.