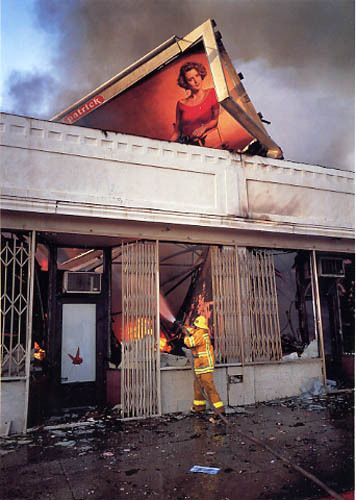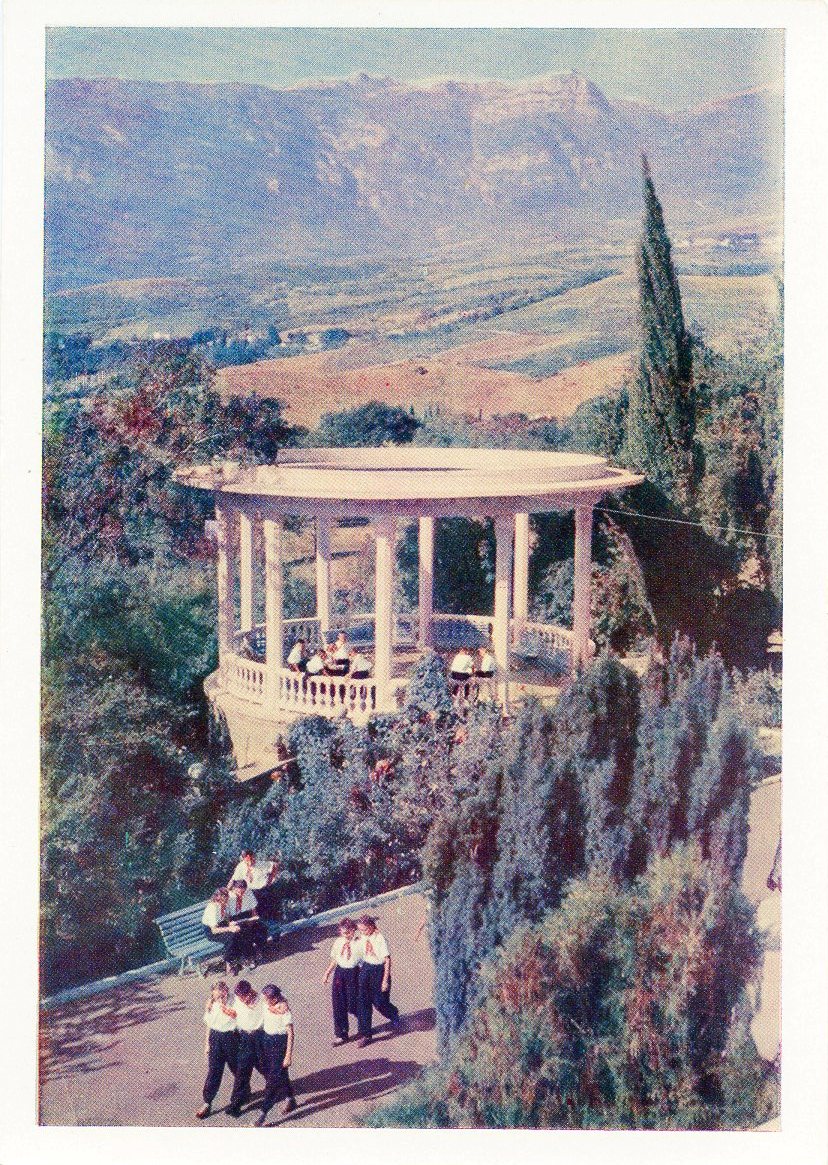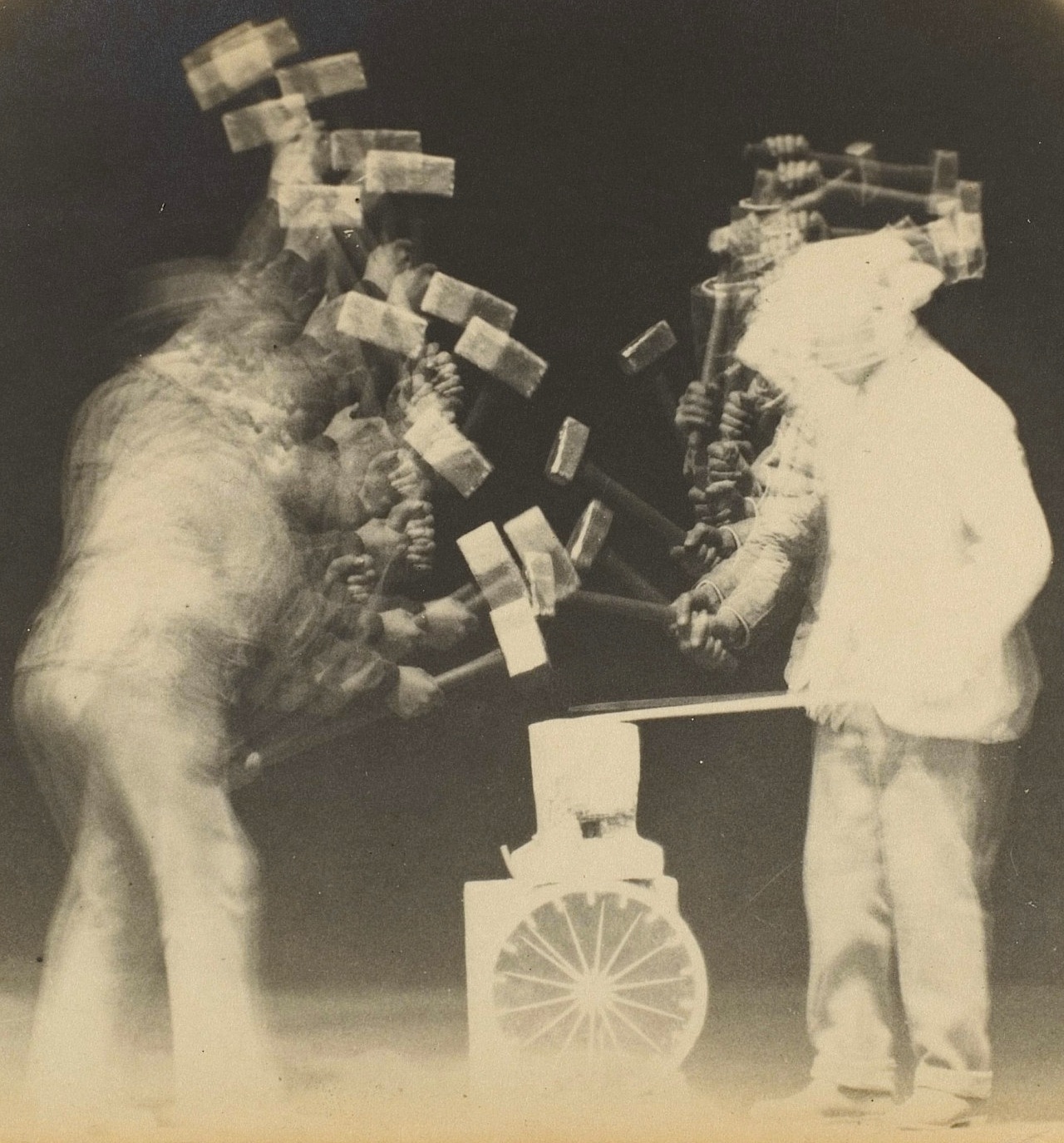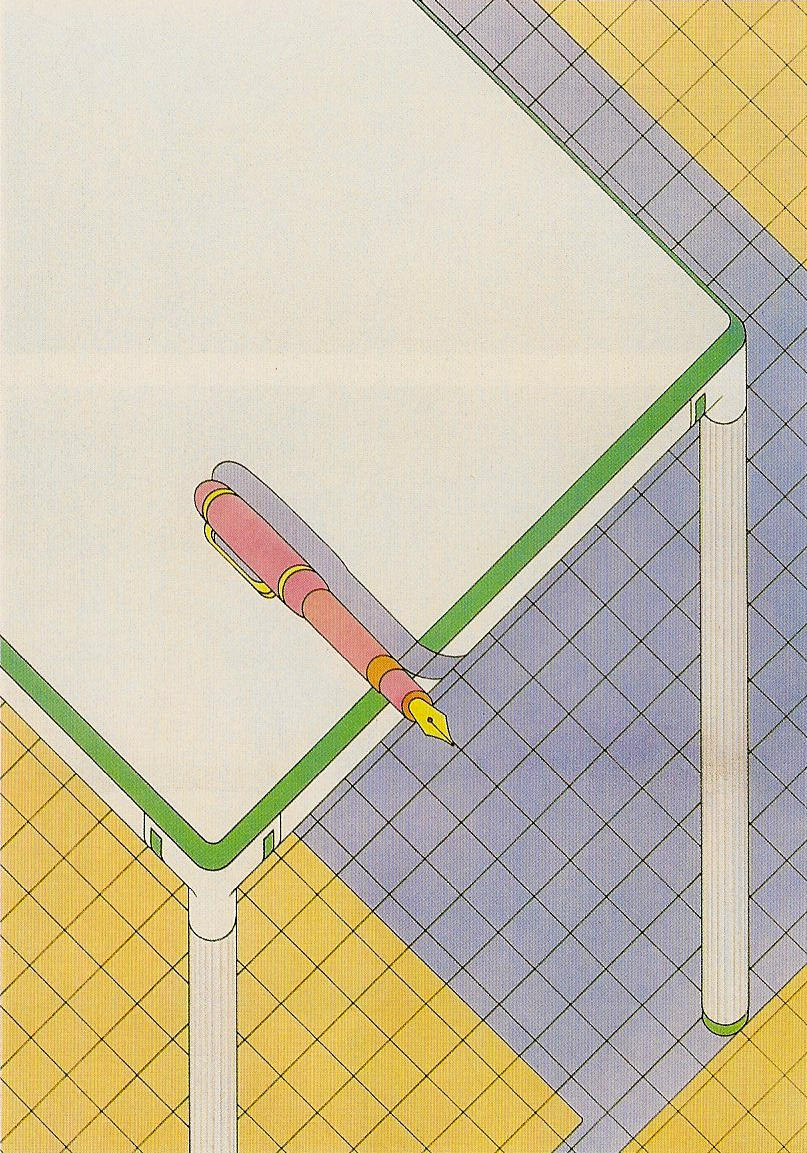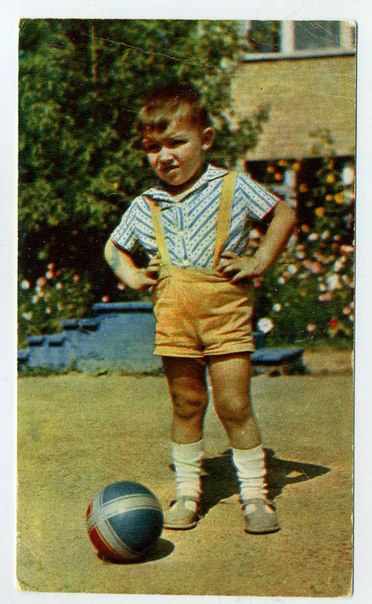Le marxisme a besoin d’une philosophie du langage
Une philosophie marxiste du langage est possible et nécessaire. Dans ce texte, Jean-Jacques Lecercle exprime de façon concise les traits principaux d’une telle philosophie. Son acte fondateur, pensé avec Gramsci, consiste à rompre avec une vision intemporelle, héritée de Saussure, pour laquelle le langage n’est qu’un système clos. Le langage est inséparable de phénomènes extra-langagiers, des rituels et des pratiques inscrites dans des appareils idéologiques d’État. Tirer profit de cette complexité du langage, de son caractère historique, c’est concevoir toute lutte de classe comme lutte dans l’élément du langage, comme processus d’interpellation et de contre-interpellation. C’est concevoir le langage comme praxis.