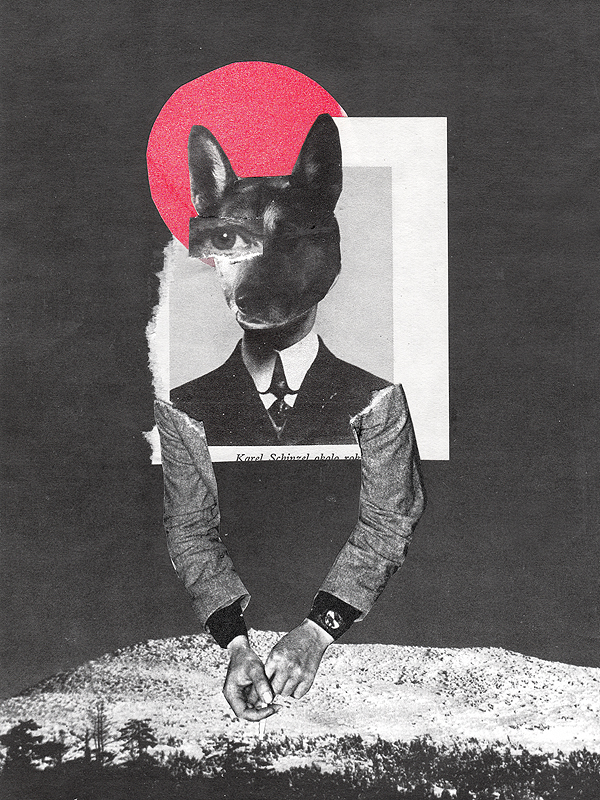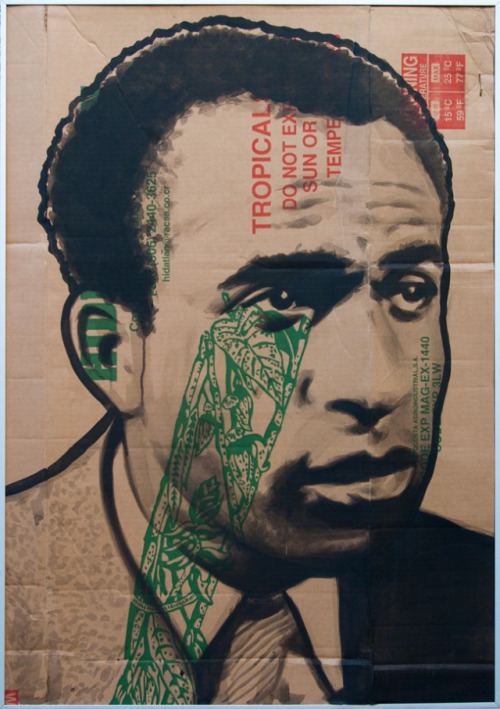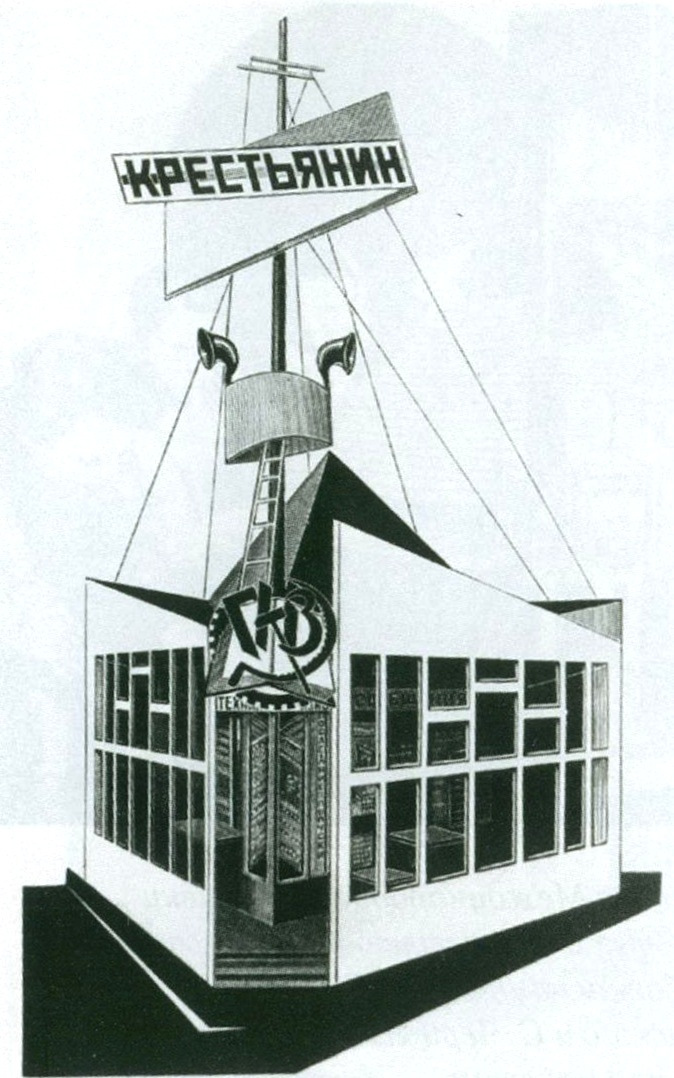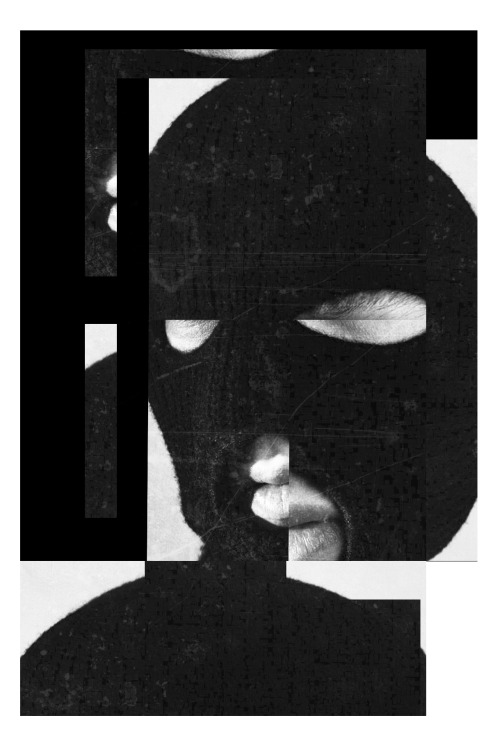La littérature prolétarienne : Tendenz ou prise de parti ?
Littérature partisane ou littérature engagée ? Pour Georg Lukács, l’ébullition littéraire qui a succédé à la révolution bolchévique est restée prisonnière de l’impasse bourgeoise de la Tendenzliteratur, l’idée que l’auteur doit prendre parti contre l’état de choses existant. Polémiquant avec le courant de la littérature prolétarienne, Lukács expose dans ce texte, paru en 1932 et inédit en français, les difficultés d’un art partisan : refuser de séparer le réel et le souhait, ce qui « est » et ce qui devrait être. À ce titre, ses cibles sont aussi variées que les marxistes Franz Mehring et Léon Trotsky, ou encore Kant et Schiller. Pour Lukács, tout réalisme émancipateur doit montrer la réalité telle qu’elle est, une totalité rongée par d’insolubles contradictions. Cette critique corrosive de l’art engagé comme de l’art pour l’art, quelles que soient ses limites, apporte un correctif salutaire à la tentation encore vive d’écrire des « fictions de gauche ».